« Comme nous existons » de Kaoutar HARCHI. Récit de vie, c’est ainsi que l’auteure nomme son ouvrage. Une vie de petite fille d’immigrés dans une ville de l’Est de la France. Avec ses interrogations au raz de l’enfance, ses peurs, ses attentes… Ses regards sur ses parents aimants. Sur elle, sur son corps. Sur les yeux bleu des autres filles…
Récit de vie, avec la sensibilité d’une autobiographie. A fleur de peau. Avec le savoir d’une sociologue que Kaoutar Harchi est devenue.
Chemin de découvertes
Comme tout enfant, Kaoutar est curieuse de la vie. D’abord, de la vie avant sa vie, en regardant inlassablement le film en cassette vidéo du mariage de Hania et de Mohamed, ses parents. Découverte de ces deux êtres qui se sont rencontrés, se sont aimés … C’était en 1984 à Casablanca. Avant qu’elle ne naisse. Où était-elle alors ?
Découverte de son corps. Attente interminable du signe de sang qui fera d’elle une femme.
Découverte du sentiment d’appartenance. A une « race », à une « classe ». Et comment ces deux « choses » dessinent une ligne de partage.
Elle se souvient de la peur
Peur de ses parents qu’il lui arrive quelque chose. Quoi au juste ? Elle sent confusément que c’est la peur que des « garçons arabes » de son quartier lui fasse quelque chose. Quelque chose qui provoque la perte de son honneur. Son honneur, mais aussi/surtout celui de ses parents !
Alors il faut la mettre dans la bonne école, dans le bon collège. Ce sera un établissement catholique au centre-ville. Loin, le plus loin possible du quartier des « grands ensembles » où ils vivent. Et la mère va travailler dur, le père aussi dans une entreprise de nettoyage, pour payer cette école pour Kaoutar.

Rencontre avec les yeux bleus
Dans le bus qui va la mener au centre-ville, pour son premier voyage vers le collège, elle voit quatre filles, des « grandes ». Elles peuvent avoir 14 ou 15 ans. Elles sont là, avec leurs cheveux blonds, leurs yeux clairs, leur élégance, leur assurance. Kaoutar est pétrifiée d’envie, de désir, de rage de ne pas être comme elles. Ce passage est magnifiquement écrit. Nous sommes dans les yeux de Kaoutar à voir ces adolescentes si belles…
(p 32) « Il y avait là, à l’avant de l’autobus, certaines assises, d’autres debout et, formant un petit cercle, quatre ou cinq filles aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Elles arboraient les visages sublimes des comédiennes des série télévisées que j’aimais regarder en fin d’après-midi tandis que Hania et Mohamed discutaient dans la cuisine (…) Et des corps de ces filles plus âgées que moi émanait une impression de pureté. (…) Tant de beauté me fascina. Je fus touchée, au sens de saisie, ravie. Au sens de transpercée, aussi. »
On pense au film suisse « Pain et chocolat »[1]. Un jeune homme italien, immigré en Suisse, aperçoit, au fond d’une sombre forêt, des jeunes du pays se baigner nus, dans une eau claire. Le décor, fait de grands arbres vert foncé, offre un contraste fort. Une scène qui renvoie aux images de propagande du Reich montrant de jeunes nazis grands, blonds, s’ébattant dans la nature des forêts allemandes. Une « forêt noire » en quelque sorte.
Découverte – Réflexivité – Domination
J’ai découvert l’auteure Kaoutar Harchi au cours d’une émission littéraire sur RFI au début de l’année 2024. Elle parlait de son récit. J’ai aimé sa voix et sa façon de parler d’elle. Savante et sensible à la fois. Un court passage a été lu à l’antenne. Ce passage justement dans le bus où Kaoutar découvre ces filles, vit un affront de leur part. J’en ai été touché.
Il y avait des journalistes dans l’émission, femmes et hommes, qui réagissaient aux propos de l’auteure. Un des hommes présent a fait une remarque qui a attiré mon attention. Certes, les filles blondes ont eu un comportement de rejet violent et agressif. Mais, demande-t-il, pourquoi rien n’est dit dans le récit sur ce que ces filles blondes ont pu éprouver d’être regardées, scrutées ainsi par cette petite noiraude aux cheveux noirs et bouclés ? Une accusation de manque de réflexivité dans le récit. Une remarque en riposte à l’évocation de cette scène, en direct à la radio !
Mais, dans la bouche du contradicteur, que vaut la réflexivité si on ne tient pas compte du contexte de domination qui entoure cette scène ? Domination implicite, allant de soi, « naturelle »… Voir la note de lecture de l’ouvrage de Sylvie Laurent « Pauvre petit blanc » ==> ICI
Kaoutar tire de cet épisode une amitié : sa rencontre avec Khadija
Khadija a partagé l’affront humiliant que les blondinettes ont fait aux deux noiraudes. Une immense amitié se noue entre Kaoutar et Khadija. Amitié, lien profond, né de l’épreuve commune de cette expérience enfantine de la « race », dans l’affront, dans l’humiliation. Sentiment d’appartenance, immensément fort.
Fous rires et école buissonnière – Humiliation, encore
En classe, Kaoutar et Khadija bavardent. Elles sont prises régulièrement de fous rires. Qui exaspèrent les professeurs et les autres élèves. Punitions, renvois hors de la classe…
Un professeur découvre, caché au fond de la trousse de Kaoutar, un objet entouré d’un tissus blanc. Il l’ouvre devant toute la classe, et découvre… un minuscule Coran, à la couverture verte avec les lettre écrites en or. C’est sa mère qui a glissé cet objet dans ses affaires, pour la protéger. « Sorcière ! » s’entend-elle dire par le professeur qui jette le Coran dans son tiroir avec les trombones et les pots de colle ! « J’en eu le cœur bafoué. » Que répondre à cette insulte quand on a 12 ans !
L’école, espoir de promotion sociale pour ses parents, se retrouve lieu de douleur pour l’enfant. Les deux filles « sèchent » les cours. Elles goutent à la liberté dans la ville. Et sont souvent absentes. Culpabilité : les parents de Kaoutar travaillent si dur pour payer cette école à leur fille.
Ahmed, le jeune homme de la cité
Pris par la police, torturé, humilié. Il « se suicidera » dans sa cellule après 15 jours de sévices. Les parents du jeune Ahmed sollicitent le comportement solidaire de Mohamed et Hania. Eux qui voulaient s’échapper de cette assignation identitaire et de sa « trappe à pauvreté » par la promotion de leur fille. Ils sont rattrapés par la violence coloniale qui règne encore sur le sol de France. Envers les jeunes hommes arabes, les jeunes hommes noirs.
Le voyage au pays, le temps des vacances
La voiture chargée jusqu’au ciel, la route, les parents qu’on visite. Oui, « tout va bien là-bas en France ». L’humiliation ? L’exploitation ? Tout cela effacé devant les autres. Mensonge d’une totale sincérité !
Et Kaoutar dans tout cela ? Distance d’avec ces lieux, ces gens, qui n’étaient qu’à moitié les siens…
Retour au lycée
Pour les « garçons blancs », le passage du baccalauréat n’était qu’une formalité. Tout l’enjeu était de trouver une bonne école pour s’installer dans la place qui leur était réservée dans la société.
Découverte de la puissance du savoir
Et puis un jour, elle découvre le sociologue Abdelmalek Sayad [2] et son ouvrage majeur : La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré.
C’est un grand choc, elle a 17 ans. « Un éclat terrible dans mon cœur. » Ce qu’elle lit, c’est ce qu’elle a vécu, ce que ces parents ont vécu. « … des choses tenues secrètes m’étaient ainsi révélées. » Elle découvre la pensée. La puissance de la théorie. Qui peut rendre compte de la réalité, l’analyser. Elle découvre « un horizon plus vaste que l’absence de mépris, plus riche que la promesse d’un statut, d’une fonction, d’une place… » (p 90)
Tuer la honte !
Kaoutar Harchi nous livre là des mots d’une grande force, qui concernent tous les immigrés soumis à ces expériences « de race et de classe ». Ils me touchent également au plus profond car ils expriment une partie de ma réalité.
Ainsi, elle a « le souvenir d’avoir été aidée par Abdelmalek Sayad a tuer la honte pour toujours[3], au point de ne plus éprouver la honte, ni la honte d’avoir eu honte, d’éprouver simplement l’amour des miens et des miennes au cœur du grand monde qui est, aussi, le nôtre. »
Avec l’appui d’un professeur, elle sait ce qu’elle va faire : des études de sociologie. Mais elle ne parvient pas à parler de ce projet avec sa mère. Elle qui rêve de statut, de sécurité, de « place concrète » à prendre dans cette société.
Première rentré à l’université
Elle retrouve… les garçons et les filles de son quartier, qu’elle avait quitté pour le lycée privé du centre-ville. Et ces garçons, qui ne lui font pas peur. Cette peur sourde et non nommée que ses parents avaient pour elle, enfant… Son exil prend fin. Sayad l’a vraiment aidée à faire reculer la honte d’elle-même !
Octobre 2005, les quartiers populaires s’embrasent
Ce sont les garçons qui mettent le feu. Deux d’entre eux, en s’enfuyant de la police, sont morts électrocutés. C’en est trop pour une jeunesse des quartiers populaire stigmatisée par la police. Soulèvement, nuits de feu, répression. Une situation teinté d’esprit colonial. Ce sont des jeunes arabes et de jeunes noirs qui sont soumis à cet ostracisme et qui se révoltent. Les banlieues flambent, ces « lieux mis au ban »[4]
Kaoutar et sa mère sortent dans la rue. Les mères vont tenter de calmer les garçons. Kaoutar va rester avec les mères et demande à Hania de rentrer à la maison. Elle assurera la présence.
La mention
Elle progresse dans son enseignement supérieur. Et obtient une mention ! Le sésame qui lui permettra de s’inscrire en cinquième année à Paris La Sorbonne. Elle va partir, laisser Hania et Mohamed, pour vivre sa vie d’étudiante à Paris.
Comme c’est abstrait, la sociologie pour Hania et Mohamed !
Ecrire
Peu à peu, elle découvre que ce qu’elle peut « rendre » à ses parents, c’est ce qu’elle sait faire, ce qu’elle peut faire de mieux. Ecrire ! Ecrire, non pas une thèse, un travail universitaire, mais écrire un récit. Celui de sa vie, celui de la vie de Hania, de Mohamed.
Ces pages où nait le désir impérieux d’écrire sont parmi les plus belles de ce beau récit !
Et c’est ce qu’elle ose faire
Bravant toutes les résistances à faire ce geste. Ecrire comme un impératif, une obligation. (p 128) « Il fallait écrire, rendre compte de tout ce qui avait été vécu, dit, entendu, éprouvé, car ce n’est que pour cela que tout était arrivé. Pour que j’en fasse état, un jour. Et que rien de nous, comme nous existons, ne disparaisse. »
Elle quitte ses parents, sa mère
Cette mère que Kaoutar aime au point de sentir coupable de devoir la quitter. Alors qu’elle va rejoindre Paris et « les études ». Les larmes aux yeux, sa mère l’accompagne du regard.
Kaoutar Harchi, l’éveil des nouvelles générations du Sud
Kaoutar Harchi écrit. Elle écrit pour ses parents, pour toute les générations d’immigrés de France (et d’ailleurs) qui se sont tus. Qui ont baissé la tête, pas vraiment sûrs de leur légitimité à être là, à « exister comme cela ». A la lettre, l’auteure participe de cet éveil qui marque profondément et irréversiblement la société du XXI° siècle. Avec le basculement du monde entre Sud et Nord,. Avec l’arrivée sur la scène mondiales des idées des centaines de millions de jeunes du Sud ayant acquis une formation universitaire. Jeunes du Sud au Sud, et jeunes d’origine du Sud au Nord.
Et parmi ces millions de jeunes, il en est qui prennent la parole, fortement. Qui mettent leurs acquis en éducation moderne pour poser des questions sur l’esclavage, sur le colonialisme,. Sur le pillage des ressources humaines et naturelles. Ils peuvent être rejoints par certains des jeunes du Nord, éveillés sur le thème colonial, qui sont animés par le rejet du système actuel. Un système qui exclue, qui divise, qui hiérarchise, qui détruit les êtres humains et la nature.
Alors, vive le mouvement Woke ! Vive le Wokisme !
Cet état d’éveil qui ne va pas cesser. Personne ne va retourner au sommeil, à la soumission. Cet état d’éveil provoque, va provoquer la rage, la colère, la violence de ces millions de « petits blancs » qui pensent que l’égalité avec les hommes et les femmes du Sud est une déchéance pour eux. On les voit déjà, ces leaders politiques qui attisent cette haine, de Javier Milei, en Argentine, à Trump aux Etats Unis, en passant par Orban en Hongrie, Le Pen en France, et d’autres faiseurs de haine.
& & &
Kaoutar Harchi, née en 1987 à Strasbourg, est une écrivaine et sociologue de la littérature française. (Wikipédia) Elle est élevée à Strasbourg par des parents d’origine marocaine de condition populaire (son père est agent d’entretien et sa mère travaille dans une maison de retraite)1. Elle y suit des études secondaires dans un établissement privé, avant de s’inscrire à l’université.
À 22 ans, elle publie son premier roman, Zone cinglée, chez Sarbacane. Elle publie ensuite deux autres romans, L’Ampleur du saccage en 2011 et À l’origine notre père obscur en 2014, chez Actes Sud.
Sociologue de formation, elle soutient en 2014 sa thèse dirigée par Bruno Péquignot, à l’université Sorbonne-Nouvelle. Celle-ci s’intitule La formation de la croyance en la valeur littéraire en situation coloniale et postcoloniale. Elle y étudie les trajectoires individuelles en France, entre 1950 et 2009, de quatre écrivains algériens francophones, Kamel Daoud, Rachid Boudjedra, Boualem Sansal, Kateb Yacine et une écrivaine, Assia Djebar. Sa thèse devient un essai, publié chez Fayard en 2016 sous le titre Je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne. Il est traduit en anglais sous le nom I Have Only One Language, and It Is Not Mine: A Struggle for Recognition chez Liverpool University Press, en 2023.
La migration comme champ de contradictions, voir ==> ICI
Mouvement Woke : voir ==> ICI
[1] « Pain et Chocolat » raconte l’histoire d’un migrant italien en Suisse qui est, selon l’imagination des émigrés, un pays riche et hospitalier, où il est possible de faire fortune car il y a du travail en abondance pour tout le monde. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[2] Abdelmalek Sayad, né en 1933 à Beni Djellil en Algérie et mort le 13 mars 1998 à Dommartin, est sociologue, directeur de recherche au CNRS et à l’École des hautes études en sciences sociales, assistant, collaborateur et ami de Pierre Bourdieu. Wikipédia. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[3] C’est moi qui souligne.
[4] « Ainsi dès le début, la « banlieue » (le « lieu du ban ») est un mot négatif. Le ban est un territoire d’une lieue autour de la ville, soumis à l’autorité du suzerain. Il désigne rapidement le territoire de l’exclusion, de la relégation et de la marginalisation. La « banlieue » serait donc un lieu mis au ban ; au ban de la ville, au ban de la société, au ban de la république. » Yves Bodart.
Articles similaires
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
« Récitatif » de Toni MORRISSON (note de lecture)
28 février 2024
2 Commentaires
Add comment Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

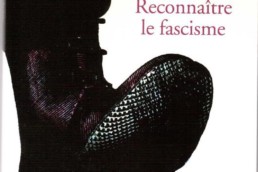
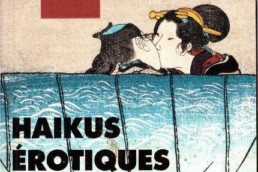
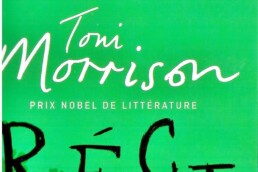

[…] Voir la note de lecture du récit autobiographique de Kaoutar Harchi : Comme nous existons ==> ICI […]
[…] Voir la note de lecture du récit autobiographique de Kaoutar Harchi « Comme nous existons » ==> ICI […]