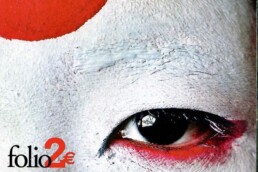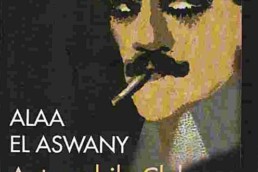« Le Prénom » de El Mouhoub MOUHOUD. Cet ouvrage a pour sous-titre : « Esquisse pour une auto-histoire de l’immigration algérienne ». Une « esquisse » qui prend pour point de départ la nomination de cet homme. Une nomination qui a résulté du heurt complexe entre la tradition kabyle d’attribution des noms, et les règles que l’administration coloniale française a imposé à la population algérienne.
Le récit que nous offre ici El Mouhoub Mouhoud montre, à rebours des vents mauvais qui soufflent sur la société française, toute la richesse des apports venant d’ailleurs. Une richesse aujourd’hui menacée par d’autres « récits » faits de mensonges et de haine.
L’intégration au cœur de la société française sans effacement des origines forme le fil du récit. Avec une présentation sincère, sans détours, des obstacles multiplies que Mouhoub va devoir franchir. Inventant, après la traversée d’une montagne de contradictions à résoudre, une voie pour accéder à une consécration sociale tout en maintenant l’attache à sa famille. Que d’épreuves traversées ! Que « d’arrangements » à imaginer ! Le récit d’El Mouhoub Mouhoud en est une magnifique illustration individuelle. La migration comme « montagne de contradictions » à dépasser ? (voir ==>ICI).
L’illustration de Brouty est tirée de « Jours de Kabylie » de Mouloud Feraoun (éd. du Seuil). Pour accéder à la note de lecture de ce roman, voir ==> ICI
Tous deux économistes
Au sein du petit club d’économistes qui ont travaillé en France sur la Méditerranée dans les trente dernières années, j’ai tout naturellement rencontré El Mouhoub Mouhoud. Nos travaux ont tenté d’éclairer d’un regard exigeant les multiples plans projetés par l’Union européenne sur cette zone. Des plans tous basés sur une méconnaissance de la région. Portés par un apriori idéologique : le libre-échange avec l’Europe allait développer ces pays ! On allait substituer les flux de marchandises aux flux des migrations. Echec total de ces projections de l’Europe sur ces sociétés !
Nous avons également travaillé sur les dynamiques propres aux économies et aux sociétés de ces pays des rives Sud et Est de la Méditerranée. Une mer dont on s’est demandé, chacun avec sa sensibilité et son approche, si elle était trait-d’union ou barrière de séparation. Ou les deux à la fois.
Nous avons cheminé sur ces thèmes, lui dans le cadre universitaire, moi dans le monde des administrations économiques en lien avec les Institutions internationales (Banque mondiale, FMI, UE).
Et nous avons noué des relations professionnelles et personnelles autour de ces sujets d’intérêt partagés. Souvenir d’un séminaire à l’Université Galatasaray, sur les rives du Bosphore. Autour de sujets partagés, mais aussi autour d’une origine commune.
Cette Kabylie qui a, depuis des siècles, vu partir ses hommes et ses femmes pour d’autres destins. Dont nous faisons partie, lui et moi. Avec des trajectoires à l’origine, radicalement, différentes.
Une triple culture de départ
El Mouhoub Mouhoud a connu, profondément, la richesse de trois champs culturels par ailleurs étroitement mêlés. D’abord celui acquis dans sa Kabylie natale. Ses règles d’organisation au sein de la famille, du village. Entre clans et tribus. Ou ce qu’il en restait après la colonisation et la guerre d’indépendance.

Un monde soudé autour de la langue, l’amazigh. Avec ses caractéristiques linguistiques propres et ses emprunts à l’arabe et au français. Une société aux relations complexes tissées au fil d’une histoire faite d’adaptation à un environnement rude. Comme bien des régions de montagne dans le monde. Où la mobilité a joué un rôle important depuis les temps immémoriaux.
Ensuite celui acquis dans la capitale, Alger. Une nation en construction, nouvellement indépendante. Immersion dans le monde arabophone transmis par l’école publique. Et l’apprentissage du parler quotidien, le darija, en dehors de la famille.
Enfin, l’arrivée en France. En suivant son père, venu avec les vagues d’émigration / immigration venant combler les besoins de main d’œuvre des années 1960. Avec l’apprentissage des codes culturels du pays d’arrivé dans ses diverses implantations géographique. Entre banlieue ouvrière et zones ouvertes à la moyenne bourgeoisie. Apprentissage et maitrise très rapide de la langue. Acculturation dans la persistance de l’héritage colonial enfoui au plus profond des mentalités. Et du mépris ressenti pour cela. De l’humiliation.
Avec l’importance d’enseignants dévoués, attentif aux êtres en devenir dont ils avaient la responsabilité. Un hommage à leur engagement. Cet engagement qui a fait la grandeur de l’école de la République. Le tout, dans un élan favorisant l’intégration des étrangers dans la société française. Un élan actuellement retourné en son contraire.
L’éducation, la transmission
Enfant, El Mouhoub a reçu de son père un mandat clair, puissant, déterminant. Celui de « devenir quelqu’un ». Et cette injonction, passait par l’instruction. Sans aucune ambiguïté. Le père qui n’avait pas été scolarisé en langue française reprenait une constante de la culture kabyle qui donne à l’instruction une haute valeur morale et sociale. Pour la famille. Sa survie, sa sauvegarde. Pour son honneur.
Et El Mouhoub Mouhoud a parfaitement aligné ce mandat avec ce que l’école de la République a de meilleur.
Heurs et malheurs de l’adolescent
L’auteur nous décrit avec sincérité sa trajectoire d’entrée dans la société française. Entre réussite scolaire et découverte des préjugés raciaux et sociaux. Et de leur intrication. Orientation scolaire difficile. Et découverte des dimensions culturelles de l’éducation. Le théâtre, la littérature…. Bien sûr, avec des rencontres amicales, amoureuses. Découverte de la différence. L’autre immigré comme lui, mais d’un autre pays. L’autre, français d’origine, mais appartenant à d’autres couches sociales… L’apprentissage de l’autonomie de pensée (« suis-je pour ou contre la peine de mort ? »). Mais d’abord, suis-je autorisé à avoir un avis personnel sur une question aussi importante et lointaine ?
La solidarité avec les immigrés en France. La dure loi appliquée aux « sans-papiers ». La lutte collective… Bref, une adolescence à la fois classique, et fortement marquée par l’origine.
En bruit de fond, la culpabilité
Celle d’avoir laissé derrière lui sa famille à Alger et en Kabylie. Celle d’avoir rompu un temps avec ses « oncles-frères ». Ces oncles du même âge que lui, qui avaient formé une chaleureuse bande amicale et familiale à Alger. La séparation d’avec la grand-mère aimante.
Les engagements
Le choix de se diriger vers des études en économies s’était fondé sur l’idée de contribuer au développement du pays d’origine, l’Algérie. J’avais, quelques années auparavant, partagé cette illusion en m’engageant, également, dans les études semblables. C’était faire du « développement » une affaire d’économie. Alors qu’il résulte d’un bouquet de facteurs sur des terrains multiples, avec pour pivot la science politique et l’engagement.
L’engagement d’El Mouhoub Mouhoud s’est alors déployé, très jeune, dans l’action concrète ici et là-bas. Dans les mouvements d’éducation populaire. En soutien aux émigrés sans papiers. En lutte contre le racisme. Mais aussi en actions solidaires avec les villageois immigrés en France qui ont reconstitué l’assemblée des hommes pour agir sur le village d’origine. Avec ses règles, ses contradictions, ses conflits dépassés. Ses réalisation, finalement.
Les tensions
Il y avait l’injonction des parents à n’épouser qu’une fille du village. A défaut venant de Kabylie, à défaut d’Algérie, à défaut de culture musulmane. Rien de cela ne s’est produit. El Mouhoub Mouhoud a épousé une Française. Première confrontation.
S’est ensuite posé la question du prénom à donner aux enfants. Là encore, le professeur d’université a cherché un arrangement. Qui préservait sa liberté. Qui, dans le même temps, ménageait la demande des parents. Avec la nécessité de composer, d’inventer des compromis. De trouver des compensations… Tout l’art d’emboiter des éléments disparates dans sa trajectoire de vie.
Le seul champ où il n’y a eu aucun recul, sans interruption depuis le début, c’est l’effort au travail. Pour « devenir quelqu’un ». Et ce, par l’instruction poussée aux plus hauts niveaux.
Tensions également dans sa position de responsable d’une institution universitaire face à la mobilisation d’étudiants dénonçant le génocide à Gaza. Entre l’assignation à son origine algérienne, son devoir de protection des étudiants, le déchainement des réseaux sociaux, la prolifération des fake news le concernant… Le tout dans un environnement médiatique fortement orienté vers la négation du génocide…
El Mouhoub Mouhoud cherche, à la fin de son récit, à qualifier avec recul sa démarche de vie
Il réfute avec force l’idée qu’il serait un « transfuge de classe ». Car dans cette expression, il y a l’idée d’avoir fui sa position de départ. D’avoir tenté d’effacer son origine. D’y avoir renoncé. Non ! Ce n’est pas ce que la trajectoire suivie.
El Mouhoub Mouhoud assume ses identités multiples. Des identités complémentaires, y compris dans leurs contradictions. (P274) « (…) non sans douleur, non sans frictions, non sans drames parfois. »
Il revendique son cheminement complexe dans une transition complexe
(P 275) « J’ai trainé avec moi un cortège de contradictions[1] qui n’ont cessé de sédimenter les couches multiples d’identités difficilement définissables. » En illustration de ces contradiction, il ajoute : (p 262) « Cette construction dans la contradiction permanente ne peut exister sereinement que si se réalise le travail de compréhension des liens enchevêtrés entre toutes les strates culturelles, linguistiques, intellectuelles, éthiques, affectives, qu’il faut pour mieux poursuivre leur superposition, leur assemblage (…). »
Dans toute cette trajectoire, l’invariant, le fil conducteur, c’est l’acquisition de savoirs. C’est l’instruction. En une cohérence totale entre fidélité à son père et promesses d’émancipation par l’école de la République.
Des « négociations permanentes »
Au total, Mouhoub rassemble les composantes principales qui ont jalonné son cheminement au travers de « ‘négociations permanentes’ avec ma famille, les arrangement et la compréhension des codes de la société française, la chance inouïe d’avoir rencontré des professeurs remarquables tout au long de ma scolarité, leur engagement incroyable pour l’égalité et pour le progrès pour tous, l’amitié et l’amour, m’ont permis à la fois de réaliser mes désirs et le mandant de mes parents. » (P 274)
Une belle illustration d’une réussite individuelle, tout le contraire du renoncement, dans l’intégration avec la richesse assumée de ses origines. Salut à toi, El Mouhoub !
& & &
El Mouhoub Mouhoud est un économiste franco-algérien, spécialiste de la mondialisation et ses effets, des délocalisations et relocalisations des activités, des migrations internationales et des relations euro-méditerranéennes.
Il a été le premier économiste en France à mettre en évidence et à analyser tant sur le plan théorique qu’empirique, le phénomène de relocalisation industrielle. Il est actuellement professeur d’économie, président de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) depuis le 17 décembre 2024 et chercheur au Laboratoire d’Économie de Dauphine – PSL (LEDa), CNRS et IRD.
Pour en savoir plus sur l’auteur, voir ==> ICI
[1] C’est moi qui souligne.