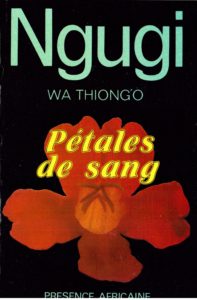Le Kenya post Indépendance
« Pétales de sang » de NGUGI wa THIONG’O (note de lecture). Quatre personnages vivent intensément ce moment d’après l’Indépendance dans la mémoire de la domination coloniale et des luttes de libération. Munira l’instituteur déprimé. Karega le jeune syndicaliste plein de rêves d’émancipation sociale. Abdulla qui a perdu une jambe dans les maquis Mau-Mau de la lutte contre l’Anglais. Et Wanja la femme ingénieuse et séductrice. Ils sont venus, chacun pour des raisons différentes, dans un village perdu dans l’intérieur du pays, Ilmorog, loin de la capitale.
Un village où on tire sa subsistance en grattant la terre, en élevant des chèvres et quelques vaches. Où la sécheresse plane. Une menace permanente sur la vie des gens. Où le savoir ancien se mêle à la magie pour faire tenir, comme depuis des siècles, ce morceau de société prise dans l’immensité rurale du Continent. L’ouverture sur le monde s’est faite par les guerres qui ont mobilisé les jeunes aux quatre coins du monde, sous la bannière britannique.
Les rêves d’une libération sociale au sortir du joug colonial ont tourné court
Des bourgeois locaux se sont glissés aux bonnes places, associés aux investisseurs du Nord. Assurant ainsi la continuité de la domination post-coloniale par l’économie. La trame du roman se construit autour de ce thème mille fois rencontré : lutte nationale et/ou lutte sociale ? Comment articuler les deux ? Comment éviter le retour de la domination des grandes masses paysannes de la population par les nouveaux maîtres noirs qui ont réussi à s’imposer après l’Indépendance ? Bafouant les sacrifices et les espoirs de ceux qui avaient eu l’audace de se dresser contre le colon et son armée. La narration évoque, en creux, la révolte des Mau-Mau contre l’autorité britannique des années 1950. Et sa répression sanglante qui laissa dans le pays de durables divisions.
Le roman déclencha une forte répression des autorités kényanes vis-à-vis de l’auteur. Prison et exil s’en suivirent.
Le village étouffe sous la chaleur et la sécheresse. Les espoirs de pluie se sont dissipés
Que faire ? Nos quatre personnages entraînent alors l’ensemble des villageois dans une aventure inouïe. Ils montent à la capitale, affamés, assoiffés, pour rencontrer le député de leur circonscription. Lui qui leur promet tant et tant avant chaque élection. Les villageois découvrent la grande ville. Les promesses mensongères des politiciens contre la réalité du rural. C’est l’histoire mille fois recommencée ici et partout ailleurs de la duperie des ruraux par les urbains, rompus au verbe.
Mais cette « expédition » produira des effets décisifs
Associé au percement d’une grande route transafricaine et à la subtile exploitation d’une boisson traditionnelle enivrante relancée par Wanja, le village commence à attirer des consommateurs. Un commissariat, une église sont construits. Les banques s’installent, et avec elles un foudroyant mouvement de « développement » qui dépasse les villageois. Ce mouvement se concrétise d’abord par l’éviction des paysans et des éleveurs de leurs accès à la terre. Un accès qui se faisait sans droits de propriété formels. Comme cela se fait depuis la nuit des temps sur la majorité du Continent. Tout cela s’achève dans une grande transformation qui introduit la « modernité » et le « développement ». Sur la ruine des équilibres et des régulations traditionnels, et sur l’exode rural.
La curieuse construction littéraire du roman
Comment parler de la trame de ce récit ? Un récit qui rend compte de la complexité des situations, mais aussi de celle des hommes et des femmes qui s’y meuvent. L’image qui me vient à l’esprit est celle d’un mille-feuille qui serait torsadé en un cordon sans fin. Un cordon formé des liens complexes qui relient entre eux les protagonistes sur l’histoire longue de leur vie, entre présent et passé. Des histoires de domination. Celle des parents sur les enfants, des Blancs sur les Noirs, des urbains sur les ruraux, des hommes sur les femmes, des « modernes » sur les anciens… Histoire tissée de regrets, de douleurs passées. Une narration par petites touches, sans continuité chronologique, déroutante.
Sans trop savoir comment, je pense à la narration hautement déconcertante d’Ulysse de James Joyce, roman interminable sur la mémoire et l’identité questionnée.
Sur « Ulysse » voir ==> ICI
Le fil du récit mobilise les souvenirs et les évocations des histoires singulières et enchevêtrées de nos quatre héros. Amitiés, amours, rivalités, révélations des liens dissimulés, rebonds dans les rencontres… s’enroulent le long de ce cordon. A vous faire perdre le fil de l’histoire. Mais on se laisse porter par enchaînement singulier de la lecture.
Les « bienfaits » de la modernité, du développement ?
Le cordon finit par se rompre sous les coups de boutoir de cette « modernité », qui disloque les liens antérieurs avec le « développement » du village d’Ilmorog en « Ville nouvelle ». Qui broie les croyances pour les remplacer par l’amour de l’argent et la méfiance envers l’autre. Qui organise la concurrence de soi contre tous : « manger ou être mangé ? ». Une modernité qui met les acteurs du récit devant des questionnements sans réponse possible. Sur l’engagement, sur le sens de leur lutte acharnée pour l’Indépendance. Sur les espoirs bafoués du retour à la liberté…
Ce questionnement du « développement » rejoint en de multiples points les analyses faites dans mon livre « SUD ! Un tout autre regard sur la marche des sociétés du Sud » Voir ==> ICI
Extraits du texte
Les extraits ci-dessous rendent compte des multiples facettes de cette transformation sociale radicale et irrépressible telle qu’elle est rapportée dans le roman. Une transformation profondément ambivalente.
(P 22) Le travail (manuel) signe d’un statut inférieur
« L’ambition de Njuguna avait toujours été de pouvoir un jour porter des ngome [bijoux] à ses doigts, pour montrer qu’il avait dit kwaheri [avait dit non] aux travaux salissants. Il serait alors comme un de ces seigneurs de mbari de sa jeunesse. Certains, dans les maisons illustres, possédaient une telle fortune en vaches et en chèvres qu’ils avaient des ahoi et des domestiques pour travailler à leur place.
Voir « L’ongle de l’auriculaire » ==> ICI
« Les ahoi et les ndungata espéraient évidemment recevoir une chèvre en paiement et partir s’installer sur des terres tribales vierges ou les pâturages libres. D’autres chefs de grandes familles, de clans et de mbari avaient eu assez de femmes et de fils pour faire le travail, et assez de filles pour leur apporter encore plus de richesse. »
(p 33) L’opposition millénaire entre cultivateurs et éleveurs
« Il aimait particulièrement le moment où les bergers des plaines venaient dans la boutique d’Abdulla. Ils plantaient leur lance devant la porte, commandaient à boire et parlaient de leurs vaches en se moquant de ceux qui vivaient comme des taupes à creuser la terre. Les fermiers d’Ilmorog, même s’ils étaient inquiets du retard des pluies, étaient prêts à défendre leur profession. Et une discussion passionnée suivait entre les cultivateurs et les bergers pour décider de ce qui était le plus important. Le bétail ou les récoltes.
Pour les bergers…
« Les troupeaux étaient la richesse, la seule richesse. N’était-ce pas l’ambition de tout homme digne de ce nom de posséder des vaches et des chèvres ? On voyait souvent des hommes sans chèvres planter des champs et des champs de patates douces, de mil, de vigne, d’igname, de canne à sucre ou de bananiers. En fin de compte, il essayait de vendre tous ces produits contre une chèvre – un seul chevreau même. Et n’était-il pas de notoriété publique que certains se louaient comme ndungata dans l’espoir de recevoir un jour une chèvre ? Les gens vendaient leur fille contre des chèvres, pas contre des récoltes. Les forgerons, les vanniers, les potiers, les artisans en ornements (…) échangeaient leurs productions uniquement contre des « choses de sang » [des animaux]. (…)
Pour les cultivateurs…
« Mais les autres rétorquaient que les chèvres et les vaches n’étaient pas la richesse. (…) La richesse était dans les terres et les récoltes produites par la main de l’homme. (…) Regardez les Blancs. Ils ont d’abord pris nos terres, puis notre jeunesse, et seulement ensuite les vaches et les moutons. »
(p 103). Le processus de colonisation par la prise de la terre
« D’abord un colon blanc, lord Freeze-Billy et sa dévote épouse (…). C’était probablement un de ces aristocrates voyageurs. Mais un aristocrate désargenté. Qui voulait réussir quelque chose de nouveau dans ce qui lui apparaissait comme une Nouvelle Frontière. Transformer le désert d’Ilmorog en un domaine civilisé et productif qui rendrait des millions d’épis et des milliers de livres sterling alors qu’on n’avait semé qu’une seule graine et investi une seule livre. C’était faire œuvre de Dieu. Et pour cela, il avait besoin de la sueur des autres.
« Il se servait de la puissance magique de l’administration, du langage et du pouvoir de son fusil pour enrôler de force la main d’œuvre. Il essaya le blé, sans tenir compte de la mine sombre des éleveurs qui avaient survécu aux précédents massacres perpétrés au nom de la pacification chrétienne par les soldats du roi [d’Angleterre]. Et de nouveau, il se fia à son fusil, qu’il portait toujours sur l’épaule. Certains éleveurs et les paysans furent transformés en journaliers munis de leur kipande [carte d’identité] réglementaire sur des terres qui avaient été les leurs. »
La bataille d’Ilmorog au XIX° siècle
« Tous observèrent le ballet gracile des petites pousses de blé dans le vent et attendirent leur heure. (…) Pendant la nuit, sur la crête d’Ilmorog, les chefs se rassemblèrent et prirent une décision. Ils mirent le feu au champ tout entier et s’enfuirent aux confins extérieurs de la plaine, se préparant à de terribles conséquences. (…) Les représailles ne se firent pas attendre. La bataille d’Ilmorog, au début de ce siècle [du XX° siècle] fut une des plus sanglante de toutes les guerres de conquête et de résistance du Kenya. »
(p 122) Les jeunes quittent les campagnes
« Je ne comprends pas les jeunes d’aujourd’hui. De notre temps, nous étions forcés de travailler pour ces étrangers qui nous opprimaient. Et même alors, après avoir gagné de quoi payer les impôts et les amendes, nous retournions à nos shambas… Aujourd’hui, prenez mes fils. Je ne sais même pas où ils sont. Il y en a un qui est allé travailler à Nairobi. Un autre à Kisumu. Un autre à Monbasa. Et ils ne reviennent presque jamais.
J’ai les ongles cassés d’avoir travaillé la terre pour de si faibles résultats
« (…) Ils se turent encore une fois pendant quelques secondes comme si en esprit ils suivaient les pérégrinations de leurs fils et réfléchissaient sur les malheurs qui frappaient leur terre. Puis Njuguna toussota, en regardant dans le vide. – Vous avez raison de parler des terres qui se font rares. Je me rappelle ce que m’a dit mon plus jeune fils avant de partir pour la ville. C’était juste après une récolte comme celle que nous avons eu ces deux dernières années. Il m’a dit : -J’ai travaillé cette terre pendant toute une année. J’ai les ongles cassés. Et regarde le résultat. C’est une injure à la vigueur de mes bras. Dis-moi, père, quand le percepteur viendra, qu’auras-tu à lui donner ?
« Quand je vais à Ruwa-ini et que je vois les beaux vêtements dans le magasins, je me demande où je trouverai l’argent pour payer le marchand. Il faut que j’aille à la ville pour tenter ma chance comme mes frères. -Que lui répondre ? »
Que s’est-il passé ?
« Autrefois, les terres étaient fertiles. Les pluies ne faisaient pas défaut. Qu’est ce qui s’est passé ? C’est Muturi qui répondit : -Vous oubliez qu’à cette époque, il n’était pas question d’acheter la terre. Elle était simplement là pour qu’on l’utilise. Et il y en avait en abondance. (…) Ajoute à cela que le pays était couvert de forêts et que les forêts appellent la pluie. (…) Mais la forêt a été dévorée par le chemin de fer. Vous vous rappelez comment on venait chercher le bois jusqu’ici pour nourrir la bête de fer ? Ah, ils savaient s’y prendre pour tout nous manger. Pour tout emporter. Mais à cette époque-là c’étaient des étranger. Des Blancs. »
(p 130) L’indigène se convertit à la religion du colonisateur
« Son père avait été l’un des premiers convertis à la foi chrétienne. Il est facile d’imaginer cette rencontre fatidique de l’indigène et de l’étranger. Le missionnaire avait traversé les mers et les forêts armé de son appétit de profit qui était sa foi et sa lumière, et de son fusil qui était sa protection.
« Il portait la Bible. Le soldat avait le fusil. L’administrateur et le colon, l’argent. Christianisme, Commerce, Civilisation. La Bible, l’Argent, le Fusil : la Sainte Trinité. L’indigène faisait paître ses troupeaux, rêvant d’actions guerrières et des récoltes qu’il arrachait lentement à la terre, à la force de ses bras, grâce au mariage de la magie et du labeur qui forçait les lois de la nature à se plier à la volonté et aux efforts des hommes. Le soir il dansait le muthunguci, le ndumo, le mumburo dans un esprit de fête, ou bien il priait et offrait des sacrifices propitiatoires à la nature.
L’homme et la nature
« Oui, l’indigène craignait encore la nature. Mais il respectait la vie de l’homme autant que la nature. La vie humaine était le feu sacré de Dieu dont on ne devait pas laisser s’éteindre la flamme en quelque point de la lignée, depuis les ancêtres jusqu’aux enfants, et aux générations encore à naître. »
(p 160) L’instituteur africain veut donner aux enfants la conscience de l’Afrique
« Il s’inquiétait de constater que les enfants ne connaissaient rien du monde en dehors d’Ilmorog. Ils croyaient que le Kenya était une ville ou un gros village quelque part au-delà d’Ilmorog. Comment faire pour élargir le champ de leur perception, afin qu’ils prennent conscience d’eux-mêmes, d’Ilmorog et du Kenya comme parties d’un ensemble plus vaste, un territoire plus grand, englobant l’histoire de tous les Africains et de leurs luttes ? »
(p 166) Faut-il appliquer à un âne le traitement traditionnel appliqué aux chèvres pour éloigner le malheur qui affecte le village ?
« Nous chassons cet âne. Nous sacrifions une chèvre. Personne n’aurait le front de rétorquer quoi que ce soit à Mwati wa Mugo. Vous savez qu’il est le glaive dont se sert Dieu pour défendre notre terre. Vous savez que depuis la fameuse bataille d’Ilmorog, il y a déjà bien longtemps, nous n’avons pas connu de nombreux fléaux. (…)
Comment procéder ? « S’il s’agissait d’une chèvre, il nous faudrait la fouetter, puis la chasser pour qu’elle transmette la malédiction à d’autres. »
(p 178) Incorporation des jeunes dans l’armée britannique pour faire la guerre aux Allemands
« Ilmorog devint un centre de recrutement, et les jeunes furent poussés dans cette guerre à coups de crosse. Ils s’en allèrent pour ouvrir les routes dans les plaines d’Ilmorog en direction de la frontière du Tanganyika pour débusquer les Allemands. Surprise des surprises ! Les Wazungu [les Blancs] s’entretuaient pour une raison que les indigènes ne comprenaient pas très bien. Comment pourraient-ils savoir que la finalité de la guerre n’était autre qu’eux-mêmes et l’accaparement de leur terre et de leur travail ? »
Au retour, le refus de travailler la terre
« Quand Munoru [un des jeunes parti faire la guerre] revint, c’était une loque. Il parlait de Voi, de Darasalama, du Mozambika, de Morogoro, de Warusha, de Moshi, et d’autres lieux aux sonorités très lointaines. Mais ce n’était plus qu’un cadavre ambulant, vivant de souvenirs imaginaires. D’autres, aussi à leur retour, avaient perdu le goût de travailler la terre de leur mains, comme l’avaient fait les fondateurs. »
Introduction de la monnaie
« Un métal plus funeste [les pièces de monnaie] que celui de cet engin roulant [le chemin de fer] avait rongé leur cœur. Pour l’obtenir, afin de payer leurs impôts mais aussi pour acheter aux Européens des objets inutiles, ils partirent travailler dans les fermes qui avaient été volées au peuple kenyan (…). Ilmorog, centre naguère florissant d’une communauté qui ne craignait pas de vivre à la sueur de son front, entra dans son déclin et se dépeupla. »
(p 200) Comment les antilopes se créent
« Njuguna taquina Niakinyua au sujet des antilopes dont on disait qu’elles étaient les chèvres des femmes, revenues sauvages parce que celles-ci n’avaient pas su en prendre soin. »
(p 227) Où être le mieux pour le villageois ? Dans son village ou transplanté dans la ville ?
« Dans l’autobus il essaya d’exprimer ses émotions à Wanja, puis il changea d’avis et se contenta de regarder les taudis, les enfants qui jouaient dans les ruelles étroites, en se demandant : qui a la meilleure part ? Le paysan d’un village oublié ou le citadin jeté sur ces tas d’immondices qu’on appelle lotissements ? »
(p 281) La peur sourde et indicible du changement
« Ils [les villageois d’Ilmorog] sentaient tous le ferment d’une nouvelle naissance, portée sur les ailes de la peur et de l’espoir. Les villageois avaient abandonné leur certitude ancienne. Ils savaient que les forces autres que la sécheresse représentaient une menace d’un type nouveau, mais personne n’osait vraiment exprimer cette peur nouvelle. »
(p 324) L’argent, le vrais secret de la puissance des Blancs
« Je vais te dire le vrai secret de la puissance des Blancs. C’est l’argent. L’argent mène le monde, l’argent, c’est le temps. L’argent, c’est la beauté, l’argent, c’est l’élégance. Et l’argent, c’est le pouvoir. Avec de l’argent, je peux même m’acheter la Princesse d’Angleterre. Celle qui est venue ici il n’y a pas longtemps. L’argent, c’est la liberté. Avec de l’argent, je peux acheter la liberté de tout notre peuple.
« Au lieu de ces discours suicides sur les pistolets, les fusils et les serments, sur l’union des Noirs pour chasser les Blancs, nous devrions apprendre d’eux comment gagner de l’argent. Avec de l’argent, on peut transformer la nuit en lumière. Avec de l’argent, on peut se libérer de ses peurs et des ses superstitions. Plus de sornettes sur Ndamathia qui a créé notre ombre. Plus de superstitions sur les animaux de la terre qui vomissent du feu. (…) Donne moi de l’argent et j’achèterai la sainteté, la bonté, la charité. En fait, je m’achèterai une place au paradis et les portes sacrées s’ouvriront toutes grandes dès que j’arriverai. Voilà la puissance que je veux. »
(p 366) Esprit réaliste contre rêve visionnaire : l’auteur esquisse ici l’avantage pratique et organisationnel du Nord
« Et ainsi la route fut construite, non pas pour donner corps et réalité au rêve visionnaire d’un continent, mais pour suivre les recommandations pratiques d’un esprit réaliste venu de l’étranger. Ce maître, architecte habile de ce morcellement à l’infini, dieu hostile à l’unification d’un continent, se mit alors à approuver et à applaudir, à avancer les fonds destinés à faire venir les experts et les équipements étrangers. Et ainsi, détournée de cette grande idée d’unité, de ce rêve de combat collectif des peuples africains, la route n’apporta qu’une unité de surface.
Chaque recoin du continent est maintenant à portée de la rapine et de l’exploitation capitaliste internationale. »
(p 383) Emprunter… pour perdre sa terre
« De nombreux paysans et bergers du vieil Ilmorog qui avaient mordu à l’appât avaient fait des emprunts, clôturé leur terre, acheté des engrais importés et, incapables de rembourser, se retrouvaient dans la même situation. Sans main-d’œuvre appropriée, sans outillage, sans information et conservant leurs anciennes traditions, ils n’avaient pas su faire rendre à la terre assez pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs prêts. Certains avaient utilisé l’argent [emprunté] pour payer des frais scolaires. Et maintenant, la puissance inexorable de la loi de l’argent les chassait de leur terre. »
(p 384) Par quelle pouvoir (magique?) la banque réussit elle à déraciner des existences millénaires ?
« Ils ne comprenaient pas. Comment une banque pouvait-elle vendre leur terre ? Une banque, ce n’était pas un gouvernement. Alors, d’où tenait-elle son pouvoir ? Ou alors, suggérèrent d’autres, c’était peut être le gouvernement, un gouvernement invisible ? Ils se tournèrent vers Munira. Mais il fut incapable de répondre à leurs questions. Il ne put leur parler que d’un papier qu’ils avaient tous signé, et du titre de propriété, un autre papier marqué de rouge qu’ils avaient remis à la banque. Mais il ne sut calmer le scepticisme amer de leurs voix et de leurs yeux. Quel sorte de monstre était cette banque, assez puissante pour être capable de déraciner à elle seule des existence millénaires ? »
(p 390) L’urbanisation accompagne le « développement »
« Il y avait plusieurs Ilmorog. L’un était le quartier résidentiel des régisseurs d’exploitation, des fonctionnaires du Conseil d’Arrondissement, fonctionnaires des services publics, directeurs des Banques Barclays, Standard Bank, Banque d’Economie Africaine et autres serviteurs de l’Etat et du capital. C’était le quartier que l’on appelait Cap Town. L’autre, appelé la Nouvelle Jérusalem, était un bidonville de migrants et d’ouvriers temporaires, de chômeurs, de prostituées et de petits trafiquants en ferraille et métaux divers. Entre la Nouvelle Jérusalem et Cap Town, non loin de l’endroit où avait vécu Mwathi, gardien des secrets des fondeurs et des guérisseurs de jadis, s’élevait l’église de Tous les Saints, dirigée par le Révérent Jerrod Brown. Et aussi quelque part, entre ces deux zones, se situait la Sunshine Lodge [le bordel] de Wanja, presque aussi célèbre que l’église. »
[JOA : on notera que dans ce schéma spatial, il n’y a pas de place pour la « classe moyenne ». Cette situation s’est maintenue globalement jusqu’à ce jour. Cependant, l’éducation de masse a fini par créer un embryon de classe intermédiaire, portée par des jeunes diplômés urbains. Mais ce mouvement reste minoritaire, et laisse exclue la grande masse des jeunes, ruraux et urbains. Les pressions migratoires, intra africaines et vers l’Europe témoignent de ce « mal-développement »]
(p 408) Triomphe du néo-colonialisme !
« C’était cela la société qu’ils avaient construite depuis l’Indépendance. Une société dans laquelle quelques Noirs, alliés aux intérêts de l’Europe, continuaient la pratique coloniale en spoliant la masse des fruits de sa sueur, en lui refusant le droit de faire éclore les fleurs dans la lumière et le soleil. »
(p 419-420) Les deux faces du colonialisme : pillage d’un côté, exploration et valorisation de la culture du colonisé de l’autre
« Après tout, autrefois, les magnats britannique du commerce et leurs missionnaires prophètes avaient colonisé et humilié la Chine en obligeant les Chinois à acheter et à fumer l’opium, les matraquaient quand ceux-ci refusaient d’importer ce poison, tandis que les savants britanniques exaltaient les grandes civilisations féodales de la Chine et en dérobaient les témoignages en emportant à Londres l’or, les objets d’art, les parchemins. L’Egypte aussi. Et il en allait pareillement de l’Inde, de la Syrie, de l’Irak… Même la Palestine, berceau de Dieu… »
[JOA : En fait, une seule face : cette exploration de la culture de l’autre s’est toujours effectuée dans l’espace intellectuel du Nord, au profit des grands découvreurs et scientifiques du Nord (Champolion par exemple). Sur la base d’objets enlevés sans égards pour les sociétés du Sud (les cariatides de l’Acropole à Athènes par exemple)]
(p 422) Le rêve, l’espoir humaniste
« La vraie leçon de l’histoire est celle-ci. Les pauvres, les opprimés, les masses avaient toujours lutté avec des lances et des flèches, avec leur mains nues et des chants de courage et d’espoir pour mettre un terme à l’exploitation et à l’oppression. Ils continueraient leur lutte jusqu’à l’avènement du royaume de l’homme.
Un monde où la générosité, la beauté, la force et le courage ne se mesureraient pas à la ruse dont on était capable ni à l’aptitude à opprimer, mais seulement à la part apportée par chacun à la construction d’un monde plus humain ou le génie inventif de l’homme, le patrimoine de culture et de savoir ne seraient plus l’apanage de quelques-uns mais seraient ouverts à tous pour que les fleurs de toutes les couleurs puissent s’épanouir et produire fruits et semences. »
& & &
Pour en savoir plus sur l’auteur ==> ICI
Articles similaires
« Notre histoire » de Rao PINGRU (note de lecture)
22 juillet 2017
Le tourisme glauque
12 mars 2016
« Zoufri »
4 août 2017