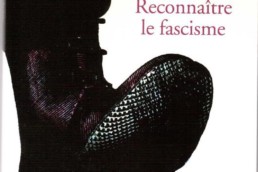« Le premier accroc coûte deux cents francs » d’Elsa TRIOLET (note de lecture) – Un recueil de trois nouvelles écrites en 1943 et 1944 par Elsa Triolet dans la France sous Occupation des troupes allemandes. Le titre « Le premier accroc coûte deux cents francs » vient d’une de ces phrases mystérieuses énoncées par la radio de la Résistance. Radio Londres transmettait ainsi les consignes aux réseaux actifs dans la France occupée [1].
L’émotion dans l’écriture
Les trois nouvelles sont servies par une écriture qui fait passer une immense émotion. D’abord pour avoir été écrites par une résistante, en période d’Occupation, sous la menace réelle d’une arrestation par la milice, la police de Vichy ou la Gestapo. Avec les violences qui accompagnaient l’arrestation par l’une de ces forces hostiles.
Mais l’émotion passe aussi par l’écriture elle-même. Elsa Triolet, d’origine russe, fait preuve d’une maitrise parfaite de la langue française qu’elle apprend à l’âge de six ans, ainsi que l’allemand. Une écriture d’une immense créativité, d’une grande audace. D’un réalisme tranché. « Le Rhône pâle et tragique comme la manche vide d’un amputé. » (p 95).
Elsa Triolet montre une impressionnante capacité de description. Elle a une plume de peintre. Sensible aux formes, aux couleurs. Aux ambiances dégagées par la vue des paysages, des bâtiments. Des plus somptueux aux plus sordides. Elle décrit un paysage en Russie : « … une petite église avec les oignons dorés de ses coupoles et les croix qui accrochaient le soleil. » (p 299).
Elle nous parle de la ville de Lyon. Une ville dont elle déteste la fermeture, la saleté, la tristesse, la froideur. « … cette ville, désolante comme un poussiéreux bureau de notaire… » (p 10). Mais elle nous décrit aussi la campagne française. Dans sa magnificence comme dans ses aspects les plus banals, une campagne « terne et raisonnable ». Elle y reconnait le travail des paysans.
Et dans ces paysages, les personnages
Sa plume de peintre, elle l’applique aussi aux situations humaines. Dans l’intimité de la vie privée. Ou au jeu des êtres humains sur la scène sociale. Dans le train en 3° classe. Ou dans les familles qui l’hébergent. Là où il faut faire comme si on était autre chose que ce qu’on est. Clandestinité oblige. Où on écoute, sans intervenir, les échanges à propos de la situation présente. L’Occupation comme une chance pour redresser la société française décadente, pour les uns. Comme ennemi irréductible et menace totale, pour d’autres. Et toutes les positions intermédiaires que la peur, la lâcheté, l’ignorance, les intérêts matériels ou la dissimulation peuvent alimenter.
Elle nous parle également de la faim, des restrictions. De la disparition des aliments dans les épiceries, les restaurants. Leur rétention dans les campagnes. Une tartine de beurre et de miel au petit déjeuner. Le luxe d’une table de paysan un matin d’hiver !
Elle nous parle des faux semblants au sein de la Résistance. Les mouvements qui la composent ne sont pas à l’abri du jeu social qui s’y déploie, là comme ailleurs. Elle évoque les conflits politiques. Et les rapports de force qui s’insinuent dans les relations.
La Guerre va-t-elle se terminer ?
Aujourd’hui, nous savons quelle a été la fin de l’Histoire. Mais pendant la Guerre, au jour le jour, dans le froid, les privations, le marché noir, toutes les options étaient possibles. Ce fil court tout au long des trois nouvelles. Et la peur quand on agit pour la Résistance. Arrestations, évasions, sont dans les esprits avec l’angoisse. Le moindre retard à un rendez-vous est source d’une folle inquiétude. Que lui est-il arrivé ?
L’attente de la fin de la Guerre. L’horizon de la défaite allemande alimente l’espoir. Quand serons-nous délivrés ? La radio de Londres qu’on écoute en se cachant, à la tombée du jour, chez des voisins.
La ténacité de l’armée soviétique
C’était elle qui constitue, en 1943, l’essentiel des forces qui combattent l’armée allemande. Au prix de pertes immenses. C’est sur elle que repose toutes les espérances. Les nouvelles du front arrivent parcellaires, fragmentées, contradictoires. Peut-on les croire ? Moscou n’est pas tombée devant la poussée allemande. La ville de Stalingrad résiste à l’encerclement par les troupes du Reich… Puis vient le débarquement des Alliés en Sicile puis en Provence…
On pense à Victor Serge dans son Journal [2] qui nous livre, au jour le jour, ses espoirs et désespoirs. Ses analyses, ses supputations sur l’issue de la guerre. Au gré des informations qui arrivent jusqu’à lui au Mexique où il s’est exilé au milieu des réfugiés Républicains de la Guerre d’Espagne. Des milieux infestés d’espions et d’agents de Moscou. L’un d’entre eux prendra la vie à Léon Trotsky avec qui Victor Serge communique. Il arrivera au Mexique au terme d’un voyage en bateau parti de Marseille. Un bateau qui fera escale à Oran où il ne descend pas. Même pour quelques heures. De peur d’être pris par les forces françaises de Vichy.
Une histoire de Résistance et d’amour
La première nouvelle « Les Amants d’Avignon » raconte l’histoire de Juliette, une dactylo, toute destinée à une « vie banale ». Mais elle s’engage dans la Résistance. Elle s’y engage totalement. Elle vit seule et circule dans la France occupée en laissant son fils adoptif à la garde de sa mère âgée. Juliette accepte les missions les plus dures, les plus dangereuses. Parcourir seule, en hiver, la campagne de la Drôme pour identifier les fermiers qui acceptent d’accueillir et de cacher des résistants et des parachutistes alliés. Prévenir d’une arrestation certaine par la Gestapo un réseau en Avignon pour sauver six ouvriers résistants qui ont été dénoncés.
Elle vit à Lyon sous une fausse identité et apprend à circuler dans les traboules[3]. Ces traverses sombres qui sillonnent les vieux quartiers de cours d’immeubles en passages souterrains. En mission dans la Drôme, elle habite seule une maison perdue, dans la campagne glacée. Elle parcourt discrètement le pays à la rencontre des paysans isolés…
Un amour comme une flambée soudaine, éphémère, dans le froid et la nuit
Lors de sa mission en Avignon, Juliette rencontre Célestin un Chef de réseau de la Résistance. Elle est là pour lui porter le message qui va sauver les six résistants. Une étrange histoire d’amour se noue. Totalement réelle et terriblement irréelle dans ce moment de clandestinité où on n’arrête pas de faire comme si on était une autre personne. Dans le temps limité de la mission. Avec la peur au ventre.
(p 71) « [Juliette]… – Je vais vous proposer un jeu… On va jouer comme si on s’aimait… [Lui] – Comment joue-t-on à ce jeu ? [Elle] – Comme on jouait d’aller en visite, ou au médecin…Tout est comme si, vous savez bien. »
Arrêtée à Lyon, Juliette échappe à la surveillance des deux policiers collaborateurs qui veulent l’utiliser pour piéger un cadre de la Résistance. Sa course dans les traboules lui permet de semer ses poursuivants.
Elsa Triolet nous fait partager l’immense admiration qu’elle éprouve pour Juliette. Ce personnage déterminé qui agit dans la peur mais qui agit. Et qui se laisse toucher par l’amour dans le cadre de sa mission. Une mission qu’elle mènera à bien. C’est elle qui prend en main le cours des choses ! Elle qui parvient à vivre et à contenir son élan pour cet homme.
On ne parvient pas à distinguer ce qui est autobiographique et ce qui est romancé. Elsa est Juliette. Et pourtant, il reste une part de la liberté de la romancière dans l’écriture de ces nouvelles.
Une histoire de peintre mélancolique, passablement misanthrope
La seconde nouvelle intitulée « La vie privée » nous entraine dans les errements d’un peintre talentueux et reconnu, Slavsky, et d’Henriette sa compagne. Henriette est l’ange gardien de Slavsky. Celui-ci ne pense qu’à la fin de cette période de privations, de peur, d’incertitudes. Il ne cherche que les conditions de tranquillité pour peindre. La seule activité qui l’apaise… Même s’il se laisse émouvoir par une jeune femme qui redonne à sa vie des couleurs.
Lyon est là aussi le théâtre triste de leurs vies. L’argent qui lui arrive par son agent réfugié à New York les mets à l’abri des difficultés matérielles. Mais l’isolement, la perte du Paris de Montparnasse où ils avaient vécu avant-guerre comme des bohèmes argentés, leur manque.
Des souvenirs d’enfant
Dans la troisième nouvelles « Cahiers enterrés sous un pêcher » Elsa Triolet nous fait part de ses souvenirs d’enfance. On est sorti de l’œuvre d’imagination. On est là dans le « journal » tenu au jour le jour par une femme qui se débat avec l’angoisse, la peur pour son amoureux, Jean. L’ennui de son isolement forcé sous une fausse identité, la crainte de la dénonciation… Les situations sont brouillées pour des raisons de sécurité. Et si la police française ou la Gestapo trouvaient ces cahiers ?
Elle s’est réfugiée sous de faux papiers dans un village isolé du centre de la France. Les souvenirs l’assaillent. Elle nous parle de la Russie où elle a passé une partie de sa jeunesse, dans une famille riche et cultivée. En hiver, ses traversées de Moscou pour aller à l’école dans un traineau, sous d’épaisses fourrures. « Nous glissions sur la neige idéale de notre rue. Le froid. L’odeur d’une fumée invisible. L’air éclatant. » (p 306) « … ainsi, traverser la Moscova est toujours un conte de fées » (p 307.
L’univers de sa jeunesse en Russie
Son amour pour sa sœur ainée. Son absence de jalousie vis-à-vis de cette sœur d’une si grande beauté. Elle qui était lourde et disgracieuse. Cette absence de jalousie énoncée dans la nouvelle comme dénégation ? Elle évoque ses premiers émois amoureux. « Je voudrai une fois vous embrasser tout mon saoul, et puis mourir… » (p 314).
Son mariage sans amour. Ses parents lointains, occupés à tant de choses importantes. Son attache à Paris où elle vit dans une maison de maître Rue de l’Université. Ses années d’errance au bout des nuits du Paris du luxe et de l’inconsistance. Ses rencontres avant celle qu’elle fera avec Louis Aragon. Il deviendra l’homme de sa vie.
Elle évoque dans cette troisième nouvelle son amour pour Jean, un intellectuel communiste avec qui elle visite l’URSS. Elle parle le russe. Il connait mieux qu’elle l’histoire du pays en tant que militant politique. Elsa Triolet écrit son bonheur avec Jean, dans cette période juste avant la Guerre.
En 1940, Jean revient à Paris après la Débâcle et reprend ses cours à la Faculté. Mais très vite, il doit plonger dans la clandestinité. Elle craint pour sa vie. Elle ne sait jamais où il est. Ses nouvelles lui parviennent sporadiquement. « La vie passe à se quitter, à quitter, à sombrer dans l’attente et l’absence… » (p 291). C’est la guerre et ils y sont totalement engagés. C’est un choix assumé. Jean est Louis Aragon dans la vie d’Elsa Triolet.
L’auteur rencontre les personnages de ses nouvelles
Qui sont les personnages réels ? Qui sont les personnages inventés ? Qui est qui dans la vraie vie ? La clandestinité et les mesures de sécurité obligent à brouiller les pistes. Elsa Triolet nous fait partager cette contrainte qu’elle transforme en formidable instrument littéraire. Le roman comme « mentir-vrai ». Encore plus quand est dans cette situation : écrire dans la clandestinité. Changer les noms. Brouiller les pistes des noms de lieux. Dans la peur d’être prise. De mourir seule.
Au fond, cette confusion contrainte et assumée sur l’identité constitue un des fils qui parcours les nouvelles un et trois. La seconde qui parle du peintre mélancolique est un peu à part… Sauf que dans la troisième nouvelle, l’auteure rencontre le peintre et sa femme.
Reportage dans le maquis
Avant la Guerre, Elsa Triolet parcourait le monde comme journaliste. En une courte séquence, l’auteure nous fait partager sa vie de reporter dans un maquis. Des souvenirs de ses reportage dans l’Espagne en guerre civile lui reviennent.
Nous n’avons aucun nom de lieu dans ce texte écrit en 1944. Seulement des descriptions de montagnes, de villages, de la vie campagnarde en fond de vie de maquisard.
Campagnes traversées en trombe dans une voiture noire volée à la Gestapo. Révolvers et mitraillettes aux mains de ses guides et camarades. Nuits dans des fermes. La sentinelle à l’orée de la clairière. Douze jeunes hommes passés au maquis s’entrainent dans la montagne. Ils sont beaux, courageux. Une émotion la traverse, qu’elle nous fait partager. Le village est complice des Résistants… Une certaine désorganisation de ces soldats improvisés. Leur manque d’armes…
Après le débarquement de juin 1944, la guerre n’est pas finie
Elle nous rapporte aussi la perception dans la population et dans les maquis de l’annonce du débarquement de Normandie en juin 1944. Immense espoir ! Mais aussi grande confusion dans les esprits et dans la société. « Tout est dans le plus grand désordre ; les chemins de fer, les sentiments, le ravitaillement… » (p 409).
La liberté n’est pas encore là. L’Allemagne n’est pas (encore) battue. Son armée est toujours présente en France. Elle montrera par des actes terribles qu’elle reste dangereuse. Les massacres de résistants et de populations dans le Vercors se seront perpétrés en juillet 1944 ! Le débarquement ? « Ce n’est pas la victoire, voyons, c’est le début d’une grande bagarre ! » (p 410).
Voir à propos de la Résistance dans le Vercors et la présence d’immigrés en son sein ==> ICI
L’administration de Vichy est toujours là. Même si on commence à sentir des fléchissements. Les collaborateurs sont aussi présents. Ils commencent à douter, mais ne lâchent pas prise. « L’air a un fond de rumeurs ponctué d’explosions. » (p 408).
Un parachutage, dans la nuit
L’auteur décrit l’épisode d’un parachutage de cadres militaires et d’armes pour les Résistants dans un village de montagne. C’est l’été, il fait chaud. Là aussi, on ne saura pas où exactement. Mais la situation est décrite avec finesse et précision dans les émotions, les sentiments. Reportage et fiction se mêlent.
La nuit est totalement noire, les hommes sont répartis aux quatre coins du champ, avec des torches. On attend l’avion qui vient d’Alger. Soudain, dans la nuit silencieuse, le ronronnement d’un moteur. Qui enfle. Les torches s’allument. « L’ombre grondante de l’avion plane au-dessus du champ muet, obscur. » (p 427). Des parachutes sont visibles. Comme de grandes fleurs blanches dans la nuit. On va ensuite à la recherche des paquets largués au-dessous des grands parachutes. Les paquets sont saisis rapidement. Emmenés dans des camionnettes vers des caches déjà prêtes. Les armes sont triées et rangées avant l’aube. Il y a aussi du chocolat parmi l’acier des armes. Avec la toile des parachutes, on fera des chemises et des robes. Avec le filins, on tricotera des chaussettes.
Au matin, les soldats allemands arrivent au village. Tandis que les avions mitraillent tout ce qui bouge. Fuir, fuir dans la montagne, au couvert. 1500 soldats allemands montent à l’assaut des villages. Ils tuent hommes, femmes et enfants. Ils sont ivres. Ils tuent le bétail. C’est un grand saccage. Ils redescendent dans leur caserne emportant meubles, fromages, radio, bouteilles de vin et d’alcool. Et des otages. Comme butin de guerre.
« Le village meurtri, saccagé, pillé, est amolli par la peur. Il lui restait juste assez de force pour maudire. » (p 434).
Solitude, peur, angoisse… Et le « coup du marin »
Dans cette troisième nouvelle écrite en 1944, Elsa Triolet exprime son désarroi. La victoire semble proche. Mais elle tarde. Elle est toujours reculée. Pas de nouvelles de Jean. Elle apprend que l’équipe technique qui tenait l’imprimerie de Lyon a été prise par la Gestapo. La peur augmente. « Il n’y a pas d’aujourd’hui, il n’y a que la douceur des jours passés et un lendemain incertain » (p 291). Et si je mourrais avant de connaitre la délivrance ? « Je meurs de peur de ne pas arriver au bout, ne plus revoir Jean ! J’ai peur, j’ai peur… » (p375).
Elsa Triolet parle alors de son désir d’un homme qui apaisera son angoisse. Le premier fera l’affaire. C’est le « coup du marin ». « On m’a toujours dit que pour enrayer le mal de mer, il suffisait d’embrasser le premier marin venu » (p 375). Et ça marche ! écrit-elle.
Dans les dernière lignes de la nouvelle écrite en avril 1944, l’auteure nous apprend que son héroïne a été capturée, déportée en Allemagne, et exécutée. Au travers les fils volontairement embrouillés de l’histoire, émane une émotion immense.
Il y a bien sûr de l’épopée dans le récit. Une exaltation devant l’héroïsme des jeunes résistants dans les dernières lignes de l’ouvrage. De la haine aussi, à l’adresse des « Boches ». Mêlée à la peur, au découragement, à l’angoisse de l’incertain. En cette période si étrange où ceux qui avaient posé leur botte sur la société, ceux qui étaient les maitres absolus… sont menacés, ébranlés. Ils savent qu’ils vont perdre. Elsa Triolet nous fait partager ces moments d’espoir et de doute. « Les maisons qui s’écroulent, les trains qui déraillent, les pylônes, les usines, les ponts qui sautent, les hommes qui tombent, les cœurs qui battent, les armes qui sortent de toutes les cachettes… » (p 441).
Et cette fin du texte, toute en humanisme : « Car les Boches ne nous auront rien épargné, même pas l’horrible devoir d’humilier l’homme par l’homme. D’avoir à piétiner ce pour et par quoi nous avons souffert : la dignité humaine. » (p 442).
& & & &
Pour en savoir plus sur Elsa Triolet ==> ICI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elsa_Triolet
[1] A l’origine, cette phrase est écrite sur un écriteau apposé dans les salles de billard où les joueurs maladroits peuvent déchirer le tapis vert. Elle n’a évidemment aucune relation avec le contenu réel du message utilisé par la Résistance.
[2] Carnets (1936-1947), Agone, coll. « mémoires sociales », Éditions de la rue Dorion, 2012. Sur Victor Serge, voir ==> ICI
[3] Sur les traboules de Lyon ==> voir ICI