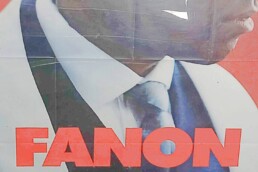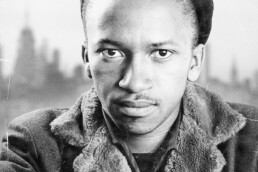« Chronique des années de braise » de Mohamed LAKHDAR HAMINA. Une somptueuse illustration cinématographique du processus colonial. Dans sa violence, sa cruauté, son cynisme. Un processus qui a conduit à la Guerre de libération, au terme de plus d’un siècle de domination. Celle-ci s’est traduite par la capture par le pouvoir colonial des meilleures terres et de l’essentiel des ressources en eau [1]. Et par une humiliation permanente. Accompagnée d’une répression sans faille à la moindre contestation. Les braises couvaient sous la cendre depuis si longtemps !
Le processus colonial ainsi décrit en 1975 nous fait immanquablement penser à la situation présente en Palestine occupée par Israël. Les mécanismes sont semblables y compris dans leurs sanglantes conséquences.
Le film montre les différents fléaux qui s’abattent sur la population
Celle-ci, aux confins du Sahara du sud algérien, subit une sécheresse qui décime les troupeaux. Puis le typhus qui fait de même avec les hommes, les femmes et les enfants « indigènes ». Les Européens ont quitté la ville mise en quarantaine. Ensuite la conscription obligatoire pour partir à la guerre. C’est la Seconde Guerre Mondiale, et les paysans s’interrogent sur ce conflit qui n’est pas le leur. La France de Pétain ? L’Allemagne de Hitler ? Les Américains qui débarquent en Afrique du Nord ?
 Puis les massacres du 8 mai 1945
Puis les massacres du 8 mai 1945
Jour de victoire en Europe. Jour de mort en Algérie. Après que des jeunes ont brandi à Sétif un drapeau algérien lors de la commémoration de la défaite de l’Allemagne nazie à laquelle nombre d’Algériens avaient contribué. La police française tire sur les porteurs de drapeau. La population de l’Est de l’Algérie se révolte. Une centaine de colons est tuée par la foule en colère. La répression est féroce. Plusieurs dizaines de milliers de paysans sont massacrés, des villages rasés par l’aviation et la marine.
Comment agir face à la domination coloniale ?
Quand la faible étincelle de la lutte jaillit au début des années 1950, le peuple algérien met du temps à imaginer que la situation peut changer. Vaincre l’armée française parait impossible. Mais la défaite de 1939 ouvre les esprits.
Les débats politiques sont portés dans le film. Ils opposent les notables, la poitrine couverte de décorations françaises, qui collaborent ouvertement avec les autorités coloniales. Ceux qu’on pourrait appeler « réformistes » qui veulent utiliser les élections pour accéder aux mêmes droits que les français. Et la force qui émerge, ceux qui comprennent qu’il faut en passer par la lutte armée.
Ici, Franz Fanon nous aide à comprendre ce passage obligé par la violence pour se libérer du joug colonial. Sa nécessité. Ses dangers pour l’après.
Algérie coloniale en 1945. Gaza colonial aujourd’hui
Le parallèle s’impose avec les tueries de masse que l’armée d’occupation abat sur la population de Gaza. Avec les mêmes mensonges de la puissance dominante. Voir « Femmes blanches, enceintes, éventrées : le monstrueux fantasme colonial » ==> ICI
La beauté, la majesté du film
Il faut aller voir cette magnifique fresque cinématographique filmée au milieu des années 1970. Une fresque porte l’héroïsme de la population mais aussi ses contradictions. Avec l’immense beauté des paysages, dans leur aridité. Avec celle de la foule innombrable des hommes dans leurs burnous clairs et leurs turbans. Beaucoup d’émotion se dégage des scènes intimes comme de celles mobilisant des centaines de personnages. Ces êtres qui vivent, qui travaillent dans des conditions adverses. Qui subissent la domination et le mépris. Des hommes qui s’interrogent. Qui se révoltent.
& & &
Mohammed Lakhdar-Hamina, né en 1934 à M’Sila (Algérie) et mort le 23 mai 2025 à Alger, est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste algérien. Il remporte la Palme d’or en 1975 pour son film Chronique des années de braise. Il est le premier réalisateur maghrébin et africain à remporter ce prix. Pour en savoir plus sur le réalisateur, voir ==> ICI
« Chronique des années de braise » (en arabe : وقائع سنين الجمر) est un film algérien réalisé par Mohammed Lakhdar-Hamina, sorti en 1975. Il remporte la Palme d’or de la 28° édition du Festival de Cannes.
Synopsis (d’après Wikipédia)
Ahmed, berger des hauts plateaux d’Algérie, quitte son village avec sa femme et ses deux fils après une sécheresse qui a fait décimé son troupeau. Il s’en va à la ville rejoindre son cousin Kouider. En ville, un épisode de typhus emporte toute sa famille. Lui et son fils Smail survivent. Il rencontre Miloud, fou visionnaire et poète, qui vit dans le cimetière en bonne intelligence avec les morts.
 Ahmed se fait embaucher dans une carrière où il découvre l’exploitation et l’injustice. Il intervient pour empêcher un conflit entre tribus pour l’accès à l’eau. Revenu au village, Ahmed détruit un barrage afin de répandre l’eau sur les terres asséchées des paysans affamés. Par mesure de répression, l’armée française enrôle Ahmed en compagnie de son cousin Saïd pour aller faire la guerre en Europe.
Ahmed se fait embaucher dans une carrière où il découvre l’exploitation et l’injustice. Il intervient pour empêcher un conflit entre tribus pour l’accès à l’eau. Revenu au village, Ahmed détruit un barrage afin de répandre l’eau sur les terres asséchées des paysans affamés. Par mesure de répression, l’armée française enrôle Ahmed en compagnie de son cousin Saïd pour aller faire la guerre en Europe.

Lorsqu’il revient, il est seul : Saïd a été tué sur le front. Devenu forgeron, Ahmed assiste à la naissance de la résistance algérienne anticoloniale. Il se range aux idées de Si Larbi, militant indépendantiste qui prêche la révolte armée. Les élections de 1948 s’achèvent par un bain de sang. Si Larbi est tué. Ahmed envoyé au bagne. Évadé, reconnu comme un héros national, il va rejoindre les maquis dans les montagnes et va mourir en héros.
La lutte armée a été déclenchée ce 1er novembre 1954. L’heure de la Libération a sonné. Au village, Miloud expire en léguant au fils d’Ahmed la mémoire populaire. Le jeune Smaïl court vers l’avenir de son pays libre.

[1] Voir « Algérie politique, histoire et société » de Jean Claude VATIN. On lira avec intérêt la note de lecture que j’en ai faite ==> ICI
Articles similaires
Alger années 50… tout est écrit en français
23 juin 2016
« Fanon » film de Jean-Claude BARNY
14 mai 2025
« Ernest COLE » film de Raoul PECK (critique de film)
4 janvier 2025