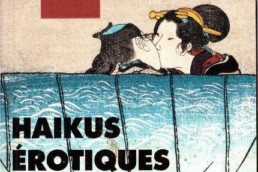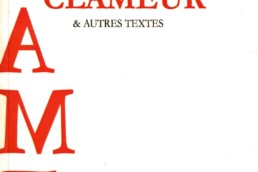« En attendant les barbares » de J. M. COETZEE. Avec ce texte d’une grande audace, l’auteur tresse dans un même récit plusieurs thèmes puissants. Celui de l’Empire et de sa frontière avec l’Autre, le « barbare ». Celui de la vieillesse et de l’érosion des capacités physiques. Celui, plus profond encore, de l’accès à l’Autre, à l’étranger. Comment percer le mystère de l’altérité ?
Et peut être le thème qui traverse tous les autres : comment tenir une position « humaniste progressiste » dans une société qui domine un autre peuple ? Dans un environnement où montent en puissance le rejet de l’autre, le refus de l’échange, de l’écoute. Le piétinement des valeurs humaines fondamentales, jusqu’à la déshumanisation. Une situation où la domination par la force s’impose comme une évidence « tranquille » …
Cette position « d’humaniste progressiste » ne manque pas d’ambiguïté, d’ambivalence… finalement de faiblesse. C’est le tourment du magistrat !
Ce dernier thème est, malheureusement, d’une cruelle actualité !
A la frontière de l’Empire
Depuis la capitale, loin de la frontière, on a construit une peur collective où le « Barbare » occupe la place centrale. Cette peur se fonde sur la menace d’un envahissement de l’Empire par ces Barbares qui s’agitent en des mouvements incompris, de l’autre côté des limites du territoire. De l’autre côté du limes [1]. Sur cette peur, un militaire envoyé par le Centre compose une posture d’agression contre « l’ennemi extérieur » en menant des incursions « chez les Barbares ». En en ramenant des prisonniers. En les torturant sauvagement pour leur extirper des renseignements sur cette prétendue agression qui menace. Le processus de violence se fonde sur une déshumanisation de l’autre, qui est à la fois considéré comme « sous-homme » et comme une menace majeure. Mais cette « qualification » de sous-homme autorise les pires violences, les pires outrages ! !
De l’autre côté, le magistrat, fonctionnaire civil de l’Empire, vit dans la ville frontière. Il connait les Barbares et même a favorisé et régulé le troc entre eux et les habitants de la ville. A la suite du passage du militaire, il recueille dans sa ville-garnison les prisonniers après qu’ils ont été torturés. Il recueille notamment une femme que le militaire et ses hommes ont sauvagement mutilé.
Selon lui, les Barbares n’ont aucune intention d’envahir l’Empire. Ils vivent depuis des siècles en nomades entre plaines et montagnes, loin, très loin de la frontière. Et souhaitent maintenir leur mode de vie d’éleveurs. Mais, selon le magistrat, ils croient qu’un jour viendra où les envahisseurs repartiront et qu’ils retrouveront une totale liberté de circulation sur un territoire qu’ils estiment leur appartenir. Les envahisseurs partiront comme ils sont arrivés. Sans crier gare. C’est leur secret espoir.
Le magistrat s’interroge sur son corps en déclin
Il prend de l’âge, et l’intrusion violente et destructrice du militaire a dérangé sa tranquillité. La jeune femme qu’il a recueillie accroit son trouble. Il est profondément horrifié par les tortures qu’elle a subies. Ses tortionnaires l’ont rendue à moitié aveugle. Ils ont brisé les os de ses pieds à coups de marteau. Elle a vu son père mourir sous ses yeux.
Le magistrat l’amène chez lui, et prend soin, longuement, de son corps meurtri. Il s’étonne de ses propres gestes qui ne sont pas portés par le désir. Il dort à ses côtés, iI la touche. Elle se laisse faire, passive. Quand il arrête de la caresser, elle se retourne et s’endort. Mais rien ne vient réveiller son sexe qui reste comme un appendice, mou.
Pour se rassurer, il va passer des moments avec une jeune femme de l’auberge qu’il rétribue. Il retrouve alors sa virilité dans la sexualité, on pourrait dire, banale.
« En attendant les barbares » de J. M. COETZEE met en scène l’insondable mystère de l’altérité
Au fond, il cherche à percer le mystère de cette femme. Cette captive. Que comprend-elle des gestes de compassion de cet homme de pouvoir ? A sa façon, il veut saisir la vérité de cette femme.
D’une façon atrocement violente, les tortionnaires eux aussi ont voulu saisir la vérité de cette femme. L’une et l’autre démarche sont vaines.
La femme parle, mais ne dévoile rien. Non pas par résistance explicite. C’est autre chose qui résiste. Autre chose que l’auteur tente de comprendre et de nous faire comprendre.
C’est un des sujets majeurs de cet ouvrage où l’auteur nous entraine. Dans un texte dense, où le récit de ses rêves vient croiser la perception consciente du magistrat.
Celui-ci ne sait que faire de cette jeune femme qui dort dans son lit. Il décide de la ramener aux siens, au terme d’une longue et douloureuse expédition.

La marche dans le froid, le vent et le sel
Le magistrat mobilise alors deux soldats et un guide. Avec la jeune femme, ils partent avec 7 chevaux, lourdement chargés car ils savent qu’ils ne trouveront rien pour se nourrir ni se chauffer dans ces terres désertiques à la lisière de l’Empire. Des terres qui appartiennent aux Barbares qui y vivent depuis toujours d’élevage. En nomades.
La marche est très éprouvante, dans le froid, dans le sable, dans la poussière. Les chevaux sont à la peine. L’herbe est très rare. L’eau saumâtre. La tête, les oreilles, sont envahis par un vent incessant. Un vent puissant, glacé.
Une tempête les surprend. Le ciel s’est assombri. Le souffle du vent emporte une des deux tentes. Un cheval, terrifié, s’enfuie. En s’apaisant, la tempête laisse hommes et bêtes épuisés, perdus dans la solitude de ce désert.
La rencontre avec l’Autre
Au bout de 10 jours de cette marche éprouvante, ils aperçoivent des Barbares. Douze hommes à cheval qui reculent à mesure que leur petite troupe avance. Au début, impossible de réduire l’écart entre eux. Comme s’ils étaient attirés toujours plus loin. Puis les douze hommes s’arrêtent et font face aux soldats, au magistrat et à la jeune femme. Ils sont menaçants avec leurs vieux fusils et leurs arcs et flèches.
Mise devant un choix, la jeune femme prend le parti de rester et de rejoindre les Barbares. Presque aucun mot n’a été échangé. La rencontre a été réduite au minimum.
Retour à la ville frontière
La route est longue mais le chemin connu. A quelques kilomètres des remparts, une escouade de soldat vient à leur rencontre et « saisissent » la petite troupe. Le magistrat est incarcéré. Il est accusé de trahison, d’intelligence avec l’ennemi.
Les soldats sont revenus nombreux depuis la capitale. Pour préparer une expédition contre les Barbares. Le militaire s’est vu confirmer cette mission par les dirigeants de l’Empire.
La détention dans une cellule où les prisonniers ont été torturés
Le magistrat est hanté par ce qu’il imagine des tortures qui se sont déroulées dans cette pièce aux murs sombres. Traité avec le minimum d’humanité, il croupi dans la saleté, la faim, le froid, la soif. La jeune fille barbare occupe ses pensées, dans une grande confusion.
Un jour, il profite d’une occasion pour s’échapper. Il franchit les limites de la ville et se cache dans les roseaux qui bordent le lac. Mais la faim et le froid ont raison de lui. Il décide de rentrer dans la ville. Son gardien, terrifié, le reçoit et lui demande de cacher cette escapade. Ce que le magistrat accepte.
Il retourne dans le cachot. Sa vie devient végétative autour des fonctions élémentaires, animales. Manger, dormir, déféquer… Mais un bruit le tire de sa léthargie.
Le retour de la troupe qui a fait une incursion punitive (punis de quoi ?) dans l’espace des Barbares
La troupe revient, triomphante. Elle ramène 12 barbares prisonniers qui défilent dans la ville, nus et enchainés, entourés des soldats « vainqueurs ». Les prisonniers sont maintenus d’une façon horrible. Leurs mains et leurs joues sont reliées étroitement par un fil de fer. Ramenés au centre de la ville, ils sont fouettés en public. La foule se déchaine qui veut aussi participer à cette punition.
Le magistrat s’échappe de nouveau de sa cellule pour assister, effondré, à ce retour
En haillons, sale, hirsute, il assiste à ce désastre de cruauté. En public ! Il prend la parole pour tenter de stopper cette torture. Violement battu, sans soutien de la foule, il est ramené manu militari dans sa cellule. Blessé, humilié.
Le doute
A ce moment, l’auteur nous livre les errements dans la pensée du magistrat. Celui-ci s’interroge sur le sens de ses actes. Depuis son geste pour tirer la jeune barbare prisonnière de la mendicité. Sa relation impossible avec elle. Et pourquoi était-elle impossible ? Son refus viscéral de la violence de l’armée contre les « Barbares ». La haine envers l’officier qui commande la troupe… Quel sens sa propre révolte a-t-elle ? Lui qui vit ses dernières années de carrière dans cette ville frontière jusque-là endormie ?
(p 176) « Qu’est ce que je défends, en somme, outre un code archaïque de noblesse à l’égard des ennemis capturés ? Qu’est-ce que j’affronte, sinon cette science nouvelle de l’avilissement qui tue des gens qu’on a mis à genoux, qu’on a réduit à l’hébétement et humiliés à leurs propres yeux ? Aurais-je osé, face à la foule, demander justice pour ces grotesques prisonniers, barbares aux derrières levés en l’air ?
Justice : une fois que ce mot a été prononcé, à quoi mène-t-il ? Il est plus facile de crier Non ! Il est plus facile d’être roué de coups et de devenir un martyr. [et cette phrase précise et terrible, comme un aveux] Il est plus facile de poser ma tête sur le billot que de défendre la cause de la justice pour les barbares. Car à quoi aboutit cette position, sinon à rendre les armes et à ouvrir les portes de la ville à ceux dont nous avons ravi la terre ? »
Que signifie le mot « justice » dans cette situation, se demande l’auteur par la voix du magistrat
On entend alors d’autres situations où la loi du plus fort se déploie en (presque) toute impunité. Les Palestiniens ne vivent-ils pas sous cette Loi du plus fort, cette domination, depuis plus de 70 ans. Et tout particulièrement en ces années 2023-2024 ? Comme avant eux, les Algériens qui luttaient pour leur indépendance dans les années 1950-60 ? Et bien d’autres encore… Encore une fois, le recours à Franz Fanon nous est précieux. Pour les colonisés, déshumanisés par essence même, la violence n’est pas une option. C’est le passage obligé pour une libération. Au niveau d’un groupe humain. Au niveau individuel.
Au-delà de ce mot, comment penser une position « progressiste-humaniste » dans le rapport à l’autre dominé ?
Coetzee a vécu dans l’Afrique du Sud de l’apartheid. « La société d’apartheid était une société de maître et d’esclaves, où les maîtres eux-mêmes n’étaient pas libres » écrit-il. Et il ajoute : « Je ne suis pas le représentant d’une communauté ou quoi que ce soit d’autre. Je suis juste quelqu’un qui, comme tout prisonnier enchaîné, a des intuitions de liberté et qui construit des représentations de gens laissant tomber ces chaînes et tournant leurs visages vers la lumière » (Wikipédia).
Il a connu la libération de la société de ce régime « du plus fort » dominait avec une extrême violence. C’est une situation qu’il connait. Il affronte avec courage, par la voix du magistrat, les terribles contradictions que cela entraine. Notamment à l’échelle des individus. (p 219) « Contrairement à ce qu’il me plaisait de penser, je n’étais pas l’inverse du colonel [le tortionnaire], aussi complaisant et bon vivant qu’il était froid et rigide. J’étais le mensonge que l’Empire se raconte quand les temps sont favorables. Et lui, la vérité que l’Empire proclame quand souffle des vents mauvais. Deux faces du pouvoir impérial. Rien de plus, rien de moins. »
Ces lignes, écrites en 1980, sont rares. Les humanistes-progressistes des pays du Nord sont peu nombreux à avoir cette clairvoyance sur eux-mêmes. A ce sujet, on lira avec intérêt « L’angle mort des penseurs du Nord sur le Sud » » ==>ICI
JOA : L’échec de la pensée progressiste
Cette difficulté pour les progressistes appartenant à une société dominante à penser l’autre dominé est au cœur de l’échec de la « gauche » occidentale depuis plusieurs années (voir « Nous avons perdu » ==>ICI).
Cet échec trouve sa source dans l’impuissance des forces progressistes à offrir des réponses crédibles aux sociétés, soumises à des agressions sociales et identitaires depuis plusieurs décennies. Des agressions provoquées par la mondialisation libérale.
Celle-ci a en effet brisé les rêves de progrès social des classes populaires et moyennes (principalement rurales) dans les pays du Nord. Avec le recul des services publics, la fermeture de la progression au mérite par l’école publique, et la criminalisation des mouvements sociaux. C’est la Tropicalisation du monde à l’œuvre[2].
Le tout couronné par une humiliation de classe portée à l’encontre de ces classes populaires et moyennes (que l’on pourrait approcher par la notion de « petits blancs ») par les classes urbaines, instruites, multiculturelles, ouvertes sur les approches de genre et la mondialisation. Ces classes dominantes (au moins culturellement) ont été théorisées par le sociologue Richard Florida sous le nom de « creative class »[3].
C’est là qu’intervient le rapport à l’autre dominé. Cette humiliation identitaire est corrélée étroitement avec la montée en puissance des sociétés du Sud (concurrence industrielle) et la progression en capacités des migrants venant du Sud au cœur des cités du Nord. Autant de bouleversements des imaginaires de ces classes moyennes des sociétés développées que nul penseur ou politicien progressiste, eux-mêmes aveuglés, ne prend en compte.
Voir aussi l’ouvrage de Sylvie Laurent Pauvre petit blanc ==>ICI
Retour au roman. Sur le terrain, la situation tourne à la catastrophe
Après avoir été atrocement torturé et humilié en public, le magistrat est « libéré ». Les militaires ne veulent surtout pas qu’un procès étale au grand jour la situation présente. Il erre, en mendiant, dans la ville. La faim éprouve son corps meurtri. Progressivement, il remarque des signes de sympathie. On lui donne volontiers à manger.
L’expédition militaire s’éternise sur les terres barbares. Aucune nouvelle ne revient du « front ». Dans la ville-frontière, les soldats restés à l’arrière se comportent comme des soudards. Alors qu’une partie des habitants a fui vers la capitale, poussés par la peur, ils fracturent les portes des maisons abandonnées et pillent en toute impunité.
Un jour, arrive du désert un cavalier bien droit sur sa selle
C’est un mort. Mort depuis plusieurs jours. Les Barbares l’ont attaché à sa monture et l’expédient vers la ville d’où est venue l’expédition militaire. Celle-ci a été décimée par la faim, la soif, l’épuisement. A la poursuite toujours plus loin des Barbares qui reculent pour les enfoncer et les perdre dans ces contrées hostiles.
L’arrivée du cadavre sur son cheval terrifie la population. Mais surtout la brigade de soldats laissés dans la ville. Ceux-ci plient bagage dans la précipitation, pillant ce qu’ils n’avaient pas déjà pris dans la ville.
Le magistrat recouvre sa maison, son lit. Des habits. La propreté. L’intégrité de son corps. Il retrouve aussi, face au vide, son statut de responsable de fait de la ville-frontière. Et organise la survie de la population après le départ des soldats. Avec la crainte, cette fois avérée, de l’arrivée des Barbares.
Le magistrat s’enfonce dans ses doutes
Comment comprendre la situation que lui et sa ville ont vécu pendant ces derniers mois ? Sur le plan militaire, la décision de mener une expédition punitive contre une prétendue menace barbare a entrainé désastres sur désastres pour la cité-frontière. Pour ses habitants. Pour l’armée elle-même et, au-delà, pour la réputation de l’Empire. Mais aussi pour lui-même qui a subi dans son corps la violence, la flétrissure, l’humiliation.
Il s’interroge aussi sur sa relation avec la jeune femme barbare. Par une confidence avec une autre jeune femme de la ville, il entend qu’elle n’a pas compris ce qu’il attendait d’elle. Entre sensualité sans érotisme, demandes sans suites, silences… Et puis cette expédition pour la « rendre » aux siens !
« En attendant les barbares », l’hiver arrive de nouveau
Qui s’abat sur une ville désemparée. Vaincue sans combat. De l’intérieur. Avec l’hiver, la neige. Le froid. Les vents de sable. Le silence du désert. Et au loin, la menace qui plane, incertaine, mystérieuse.
& & &
John Maxwell Coetzee est un romancier et professeur en littérature australien, d’origine sud-africaine, et d’expression anglaise, né en 1940 au Cap en Afrique du Sud. Il est lauréat de nombreux prix littéraires dont le prix Nobel de littérature en 2003. Marquée par le thème de l’ambiguïté, la violence et la servitude, son œuvre juxtapose réalité politique et allégorie afin d’explorer les phobies et les névroses de l’individu, à la fois victime et complice d’un système corrompu qui anéantit son langage. Wikipédia. Pour en savoir plus sur l’auteur, voir ==> ICI
Du même auteur, voir la note de lecture de Disgrâce ==> ICI
[1] Le limes était la zone frontière de l’Empire romain1. En latin, limes signifie simplement chemin de patrouille à la frontière. Dans la terminologie militaire du Ier siècle ap. J.-C., le limes désignait les routes qui s’enfonçaient dans les territoires hostiles situés en avant des terres d’Empire, qui étaient jalonnées de postes fortifiés et dirigées vers l’extérieur. Leur but était de faciliter les offensives en pays barbare.
Le terme change de sens lorsque l’empereur Hadrien renonce aux conquêtes. Les routes deviennent alors des routes fortifiées qui, là où manque la coupure géographique d’un fleuve, séparent le territoire romain de celui des barbares, et sont destinées à relier les différents secteurs frontaliers de manière continue.
Le terme limes, qui définit une frontière établie par l’homme, s’oppose à celui de ripa qui désigne une frontière naturelle. Par extension, limes finira par désigner toute zone frontière, naturelle comme artificielle, ou à un ensemble de routes fortifiées formant une zone défendue derrière une frontière de l’Empire. (D’après Wikipédia)
[2][2] La tropicalisation du monde de Xavier Ricard Lanata. Voir ==>ICI
Sur cet auteur singulier et vigoureux, voir ==>ICI
[3] Sur Richard Florida et les creative class : voir ==>ICI Elles représenteraient 30% de la force de travail aux USA selon le sociologue.
Articles similaires
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
« Clameur » de Hocine TANDJAOUI (note de lecture)
27 janvier 2022
« Notre histoire » de Rao PINGRU (note de lecture)
22 juillet 2017