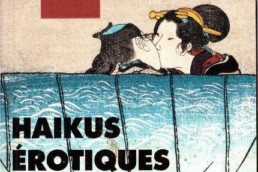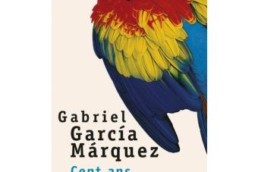« Pas de lettre pour le colonel » de Gabriel GARCIA MARQUEZ (note de lecture). Ce second roman de l’auteur, écrit à Paris en 1957 et publié en 1961, constitue un bijou de la littérature mondiale. En un texte très court, d’une écriture fine, l’auteur révèle ses talents d’écrivain. Où l’humour grinçant dépeint jusque dans le détail la misère d’un vieux colonel à la retraite qui attend, chaque semaine, la lettre qui lui attribuera enfin la retraite à laquelle il a droit. Cela fait quinze ans que le colonel attend. Et chaque semaine, à l’embarcadère qui amène le courrier, il entend la même phrase du postier : « Pas de lettre pour le colonel ».
Le colonel, sa femme … et le coq de combat
L’histoire se déroule entre le colonel, qui au fond, a renoncé à lutter contre l’arbitraire bureaucratique, son épouse, malade et consciente de la réalité de leur vie sordide… et un coq de combat. Tous trois ont perdu Agustin, le fils tué quelques mois avant, dans la répression sanglante que le régime dictatorial fait peser sur la société. Agustin s’occupait du coq qu’il préparait aux plus hauts succès dans l’arène. Les parents ont perdu leur fils unique.
La faim tenaille le vieux couple, torture les intestins du colonel
Mais il faut se débrouiller pour maintenir le coq en bonne santé en lui donnant ses graines quotidiennes. En janvier, les combats reprendront dans l’enclos. Et le colonel devrait y trouver quelques pesos. Ces combats déchainent les passions dans le village !
Nous sommes en octobre, la pluie ne cesse de tomber. Tristes tropiques écrasés de chaleur et d’eau ! Le colonel tente sans conviction de vendre une horloge, un tableau… et même le coq. La faible quantité de nourriture que le couple peut acheter met au défi les talents de la femme pour préparer des repas mangeables avec si peu. Et il faut garder des graines de maïs pour le coq.
Comment emprunter pour acheter le minimum en promettant le remboursement sur la pension du colonel qui devrait arriver… depuis quinze ans ? Le village perdu où le colonel, sa femme et le coq vivent dans l’attente, n’est relié à la capitale que par le fleuve et ses gabares hebdomadaires [1].

On sent le poids de la répression que la dictature corrompue fait peser sur la société
Avec les rafles de la répression, où police et milice se confondent. Avec le couvre-feu implacable à 11 heures du soir. Et les cloches de l’église qui accordent au film du cinéma local une note de moralité. Douze coups signalent un film « à ne pas voir ». Et depuis plusieurs années, les cloches sonnent toujours douze fois !
Les amis d’Agustin continuent de faire passer au colonel des tracts subversifs que le colonel diffuse sous le manteau dans son cercle étroit. L’atelier du tailleur. Le salon du médecin. La boutique du riche marchand diabétique. Et le bazar du « Turc » [2] qui baragouine un espagnol mêlé d’arabe, en face de l’embarcadère. A eux tous, ils composent le petit monde où le trio survit en attendant….
En attendant la fin de la pluie. La reprise des combats de coq… Et la lettre pour le colonel venant de la capitale.
& &
Par le hasard des lectures, j’ai lu « Pas de lettre pour le colonel » juste après « Monné, outrages et défis » d’Ahmadou Kourouma. Voir ==> ICI
Deux ouvrages qui nous donnent à voir les tropiques d’Afrique et d’Amérique Latine où règnent arbitraire, domination, répression. Mais sous deux point de vue tout à l’opposé.
- Ahmadou Kourouma nous entraîne dans une fresque historique qui nous montre sa société vue du haut, dans ses heurts et malheurs flamboyants, féroces et cruels. Pleine de courages et de lâchetés devant la domination coloniale. Enserrée dans ses innombrables croyances, « dures comme le fer », que la puissance rationnelle du colonisateur va à peine ébranler.
- A l’opposé, Gabriel García Márquez nous offre de sa société une vue au ras du sol. Au pied du meuble de cuisine où le colonel attache le coq, devant sa gamelle, chaque nuit. Les croyances se sont dissoutes dans le renoncement à vaincre les inégalités, la corruption, l’étouffement des libertés, la répression sanglante. Les regards sont vides, « avec une tristesse de crapaud dans les yeux». Une immense torpeur se dégage des personnages dans leur vie rétrécie, minuscule, sans horizon.
Gabriel García Márquez nous arrache des sourires à suivre les dialogues que le vieux colonel entretien avec son épouse et ses amis du village
(p 39) La femme confectionne des vêtements pour son mari avec de pièces de vieux habits : « J’ai le cerveau raide comme un piquet. – Tu l’as toujours eu comme ça, dit le colonel, mais il se pris alors à regarder le corps de sa femme tout recouvert de pièces et de morceaux bariolés. Tu ressembles à une perruche de prestigiateur. -Il faut être à moitié prestigiateur pour t’habiller, dit-elle. »
(p 114 – 115) Le colonel est devant l’embarcadère. La gabare vient d’arriver. « C’est alors qu’il découvrit le cirque. Il reconnut la tente rapiécée sur le pont de la gabare du courrier, au milieu d’un amoncellement d’objets de toutes les couleurs. Il perdit de vue un instant l’employé des postes pour chercher les fauves parmi les caisses entassées sur les autres gabares. Il ne les trouva pas. – C’est un cirque, dit le colonel. C’est le premier à venir ici depuis 10 ans.
Le Syrien Moïse vérifia la nouvelle en s’adressant à sa femme dans un mélange d’arabe et d’espagnol. (…) Il fit un commentaire pour lui-même et traduisit ensuite sa préoccupation au colonel. – Cache ton chat, colonel. Les gosses les volent pour les revendre au cirque. Le colonel s’apprêtait à emboiter le pas à l’employé des postes. – Ce n’est pas un cirque de fauves, dit-il. – C’est pareil, dit le Syrien. Les acrobates mangent du chat pour ne pas se rompre les os. »
(p 121) Le colonel et sa femme ne parviennent pas à dormir. « – La pension va bientôt arriver, dit le colonel. – Tu dis la même chose depuis quinze ans. – C’est pour ça, dit le colonel. Elle ne peut plus tarder bien longtemps. »
(p 122) « – Tu est un inconsidéré, dit-elle. Le colonel ne dit rien. – Tu es un capricieux, une tête de mule et un inconsidéré, répéta-t-elle. Elle croisa les couverts sur son assiette, mais aussitôt, par superstition, rectifia leur position. – Toute une vie à manger de la terre pour en arriver maintenant à ce que tu me considère moins qu’un coq. – C’est différent, dit le colonel. – C’est la même chose, répliqua sa femme. Tu aurais dû te rendre compte que je suis en train de mourir et que ce que j’ai, ce n’est pas une maladie mais une agonie. »
& & &
Pour en savoir plus sur Gabriel García Márquez, Prix Nobel de Littérature en 1982, voir ==> ICI
Voir l’article « Conservateurs et Libéraux dans « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez » ==>ICI
& & &
[1] La gabare ou gabarre (de l’occitan gabarra) est un type de bateau traditionnel destiné au transport de marchandises. Deux types de navires sont désignés par ce mot : les gabares fluviales et les gabares maritimes. (Wikipedia)
[2] Les immigrés venant de Syrie ou du Liban, nombreux sur en Amérique Latine, étaient souvent appelés les « Turcs ».
Articles similaires
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
« Notre histoire » de Rao PINGRU (note de lecture)
22 juillet 2017