de p« Les dames de Kimoto » de Sawako ARIYOSHI. Le roman commence au début du XX° siècle. Le Japon est en pleine révolution de l’ère Meiji [1]. Celle-ci fait faire à la société un pas gigantesque et précipité. Forçant le passage d’une ère féodale à l’ère que l’on pourrait appeler « moderne ». Le Japon adopte des méthodes qui ont tant réussi à l’Europe. Laquelle domine désormais le monde. Un évènement vient couronner ce processus : la victoire du Japon contre la Russie [2] en 1905. Le nationalisme le plus dur va enflamer une partie de la société japonaise.
La « modernité » s’invite dans toutes ses strates. Et notamment, point de passage obligé en tous lieux, dans les relations entre hommes et femmes. Ces dernières cherchent à s’émanciper du poids du patriarcat.
Dans « Les dames de Kimoto », Sawako Ariyoshi nous fait part de ces mouvements, avec intelligence et délicatesse, au travers quatre générations. Ce sont « Les dames de Kimoto » qui évoluent dans un environnement fortement marqué par les traditions. La seconde guerre mondiale, avec ses illusions nationalistes, la lourde défaite et la reconstruction, va bouleverser et accélérer cette rupture avec le monde ancien. Ces mouvements nous sont livrés dans leur complexité et avec leurs contradictions. Dans un grand geste d’humanité !
Le mariage de Hana
La jeune femme, élevée avec amour et attention par sa grand-mère Toyono, va épouser l’homme que Toyono lui a choisi avec grand soin. Et après plusieurs refus d’autres propositions venant d’autres familles. Ce choix s’est fait sur des critères sociaux exigeants et une valorisation des codes traditionnels qui organisent la société dans un coin du Japon rural. Notamment des rapports de force qui s’y déploient. Toyono porte une attention extrême au maintien du rang de sa famille. Mais aussi à la réputation de la famille du jeune homme, à qui Hana va se lier pour la vie. A qui Hana va littéralement « appartenir ».
Le mariage est somptueux. Cinq barques accompagnent la mariée dans son palanquin, et les neuf coffres de présents dans la descente du fleuve Ki. Celui-ci rythme toute la vie rurale de la région autour de la culture du riz.
L’auteure nous livre amples détails sur les tenues de la mariée. Dans la signification sociale de leur esthétique. Dans le faste que les notables étaient capables d’étaler pour assoir leur statut au sein des sociétés rurales.
La jeune mariée s’intègre dans sa nouvelle famille
Nous découvrons le poids des traditions qui entourent la délicate ingénierie sociale des mariages. Notamment l’importance des droits d’ainesse qui attribuent au premier enfant mâle la totalité de l’héritage des biens et des titres familiaux. Les cadets sont alors à la recherche de femmes qui n’ayant pas de frère, vont se faire adopter par la famille de la mariée. Et en devenir l’héritier principal, comme mâle unique. En l’absence de ce genre de solution, l’alternative est d’accepter un déclassement notable.
Hana a épousé Keisaku, l’ainé de la famille Matani, propriètaire terrien, disposant de terres dans les « montagnes » et dans les « rizières ». Keisaku a des ambitions politiques locales et se montre ouvert aux influences modernistes qui arrivent depuis la capitale. Hana, quant à elle, dispose des avantages du statut de son mari. Elle s’intègre avec habileté et générosité dans sa nouvelle famille. Et fait preuve d’un grand savoir sur les relations sociales de ce monde féodal, où maitres, servants et servantes sont en forte interaction.
L’ensemble de la famille se heurte aux frustrations du frère cadet de Keisaku, le colérique et ombrageux Kôsaku.
Les enfants d’Hana
Son premier enfant est un garçon, Seiichirô. Keisaku, le père, projette sur lui tout un avenir politique dans le prolongement de son action locale. Quand arrive la petite Fumio, le père « regrette que ce ne soit pas un garçon ». Il avait dessiné un avenir avec deux fils pour le soutenir dans sa carrière et prendre la relève.
Seiichirô n’aura jamais grande ambition. Surtout, il ne jouera pas le rôle assigné de chef de famille, chef de la « Maison Matani », quand son père disparaitra. Hana en sera profondément affectée.
En grandissant, Fumio s’affirme comme une jeune fille volontaire
Elle revendique son émancipation des règles traditionnelles. Et conteste l’autorité dans son école. Hana temporise ses excès auprès des enseignants.
La modernité s’insinue dans les plis de la société. Ce sont des jeunes qui soutiennent ces transformations. Lesquelles se portent beaucoup sur les pratiques vestimentaires qui composent une immense part dans la sociabilité traditionnelle au Japon. Avec des habits strictement dédiés aux différentes circonstances de la vie. Mais aussi comme marqueur de la hiérarchie sociale dont la lecture doit être sans ambiguïté.
Les provocations de Fumio ne manquent pas d’humour. (p 124) « Ce hakama [3] vert, qu’elle arborait depuis un an malgré toutes les oppositions, était rendu encore plus scandaleux par l’adjonction d’une vingtaine de bébés miniatures en celluloïd accrochés le long du liséré blanc. Fumio avait adopté cette décoration à la suite d’un incident du même ordre que le précédent : une des ses condisciples avait eu maille à partir avec un professeur pour avoir accroché un de ces bébés au bout de sa ceinture. Une fois encore, Fumio semblait demander : ‘Où, dans les règlements, est-ce interdit ?’ ».
 Après le lycée, Fumio demande à suivre ses études à l’université de Tokyo. Très loin de Wakayama, dans la région où vivent les famille Kimoto et Matani depuis des siècles. Hors de portée de l’autorité de sa mère. Fumio est totalement décidée. Hana finit par céder, le cœur lourd.
Après le lycée, Fumio demande à suivre ses études à l’université de Tokyo. Très loin de Wakayama, dans la région où vivent les famille Kimoto et Matani depuis des siècles. Hors de portée de l’autorité de sa mère. Fumio est totalement décidée. Hana finit par céder, le cœur lourd.
Fumio l’insoumise
C’est la troisième dans la chaine des générations, après Toyono et Hana. Mais Fumio se pose en rupture avec tout ce qui a constitué l’univers de sa mère. Bienveillance, retenue, soumission, respect absolu des règles, du protocole… toutes valeurs issues de l’éducation traditionnelle des jeunes filles japonaises de bonne famille. Des futures femmes. C’est avec cela que Fumio veut rompre.
Et c’est elle qui s’engage pour son mariage avec un jeune homme, hors du contrôle de sa mère. Elle ira même jusqu’à lui renvoyer tous les cadeaux traditionnels attribués aux mariés, que Hana avait constitué avec patience et amour. Des kimonos pour vingt années pour Fumio. Des meubles pour le couple.
Les scènes d’affrontement entre mère et fille sont écrites avec finesse et sensibilité.
La résistance de Hana
Hana va finir par céder progressivement. D’abord par la distance que Fumio et son mari mettent avec elle qui est restée dans sa province. Tokyo, la Chine à Shanghai, l’Equateur, l’Indonésie suivant les nominations du mari de Fumio… Ensuite, avec les naissances de ses enfants.
La famille est touchée par des décès dus à la maladie. Hana perd ainsi deux petits-enfants. Son mari, Keisaku, qui a été élu député à la Diète, meurt brusquement d’une crise cardiaque à Tokyo. Hana n’a pas le temps de partager ses derniers moments. Elle qui avait mis toute son énergie familiale et sociale aux succès politiques de son mari. Elle de qui ses enfants sont maintenant éloignés. Qui a définitivement perdu le contrôle sur sa fille ainée…. Que lui reste-t-il ?
Une narration au plus près de la complexité des individus
Les qualités sociales de Hana, qu’elle tire de son éducation traditionnelle, sont mises en avant dans le dialogue houleux qu’elle entretient avec Fumio. Mais les contradictions de celle-ci également. Elle n’hésite pas à profiter de la richesse de ses parents …
De même la relation entre Hana et son beau-frère, faite d’attirance et de rejets, au grès des humeurs de Kôsaku, sont-elles présentées avec finesse. Et quand ils se rapprochent autour de l’amour de l’oncle pour les enfants de Hana, puis quand Keisaku décède… Sawako Ariyoshi nous entraine au plus près des sentiments d’Hana. Des évolutions de toute une vie d’action, de questionnements, de réflexions…
Hors le cercle familial, la situation se dégrade dans l’Asie de l’Est
Au Japon, la crise du pouvoir s’aiguise avec les difficultés militaires extérieures. La Russie du Tzar a été vaincue en 1905. Mais l’URSS des années 1930 résiste aux ambitions impériales et impérialistes du Japon. Qui veut la Mandchourie. Qui veut prendre plus du côté de la Mongolie. Et qui se heurte à l’Armée Rouge. Dans l’illusion de la supériorité inspirée par l’idéologie nationaliste qui se répand, le Japon est défait en 1939 par l’armée de l’URSS pourtant laminée par les purges staliniennes[4]. Ce qui va projeter les illusions militaires du Japon vers le Pacifique et ses îles. Cela conduira à l’attaque de Pearl Harbour en décembre 1941.
Le pouvoir oscille entre l’armée, la marine et l’Empereur dans un jeu complexe qui échappe à Hana et à bien des Japonais. Mais l’inquiétude monte. Et une atmosphère d’unité nationale derrière les forces armées se développe. Fumio, dont la révolte, l’insoumission, n’ont jamais été inscrites dans un cadre politique, s’enrôle dans le mouvement de soutien à l’effort de guerre. Elle est prise dans cette enthousiasme nationaliste et s’active avec une partie de la société civile dans cet appui.
La terrible défaite, la dévastation de la société, la reconstruction
On connait l’histoire de la fin de cette Guerre mondiale en Asie. Les bombes atomiques. La reddition inconditionnelle du Japon. L’emprise américaine. La reconstruction à marche forcée. L’industrialisation accélérée qui détruit la nature.
Une grande misère s’abat sur la population dans les années qui suivent la défaite. La faim affecte toute la population, surtout celle des villes qui troquent des biens contre du riz.
La famille Matani a perdu de son lustre, de sa puissance
La guerre a bouleversé les relations sociales et familiales. Le récit se poursuit avec Hanako. C’est la fille de Fumio. La petite fille de Hana. L’arrière-petite-fille … de Toyono. Quatre générations de femmes qui traversent l’histoire. Qui traversent le récit de Sawako Ariyoshi. C’est au cours de promenades dans la nature entre filles et mères, filles et grand-mères, que l’histoire de la « famille » Matani se transmet.
Hanako a été élevée dans la maison familiale par Hana pendant les terribles années de guerre. Tokyo recevait quotidiennement des bombes dévastatrices. La maison de Fumio y a été réduite en cendres. Hanako est très attachée à sa grand-mère. Et à cette maison familiale du village de Musota, près de Wakayama. Une maison maintenant décrépie.
Hana est très âgée. Ses forces ont diminué. Elle parle à Hanako de sa vie. Elle la confond avec Fumio dans ses évocations des années difficiles qu’elles ont vécu. Dans la relation mère-fille. Et dans les épreuves des disparitions, de la guerre, des privations. Des bouleversements que la modernité a imposés.
La ville de Wakayama s’est considérablement étendue. Un gigantesque complexe industriel chimique s’est construit à l’embouchure du fleuve Ki. Brutalisant la ruralité. Le triomphe de l’économie a écrasé la nature.
& & &
Sawako Ariyoshi (有吉佐和子?), née en 1931 à Wakayama, au Japon, et morte en 1984 à Tokyo, est une écrivaine japonaise. Elle commence sa carrière littéraire au début des années 1950, après des études de littérature anglaise, à l’université chrétienne de Tokyo. Ses œuvres principales sont les chroniques historiques Les Dames de Kimoto (publié en 1959), Kae ou les deux rivales (en 1967) et Les Années du crépuscule (en 1972) (d’après Wikipédia). Pour en savoir plus sur l’auteure, voir ==> ICI
On lira avec intérêt des romans qui présentent une saga familiale où les femmes jouent un rôle majeur. Avec les œuvres d’Aki Shimazaki. Voir ==> ICI
[1] L’ère Meiji (明治時代) (1868 – 1912) symbolise la fin de la politique d’isolement volontaire appelée sakoku et le début d’une politique de modernisation du Japon. Elle se caractérise également par un basculement du système féodal vers un système industriel à l’occidentale. Ces bouleversements sociaux, politiques et culturels déboucheront sur diverses avancées dans les domaines de l’industrie, de l’économie, de l’agriculture et en matière d’échanges commerciaux. L’empereur Mutsuhito (睦仁) prit à l’occasion de son accession au trône, selon la tradition impériale japonaise, le nom posthume de Meiji (明治) qui signifie « gouvernement éclairé » (composé de « lumière/clarté » (明) et « gouvernement » (治) (d’après Wikipédia). Pour en savoir plus sur cet évènement fondateur du Japon d’aujourd’hui, voir ==> ICI
[2] La guerre russo-japonaise (japonais : 日露戦争 ; russe : ру́сско-япóнская войнá) se déroule du 8 février 1904 au 5 septembre 1905. Elle oppose l’Empire russe à l’empire du Japon. Ce dernier, victorieux, gagna par le traité de Portsmouth la péninsule du Guandong et la moitié méridionale de l’île de Sakhaline.
Sur le plan militaire, ce conflit préfigure les guerres du XXe siècle par sa durée, par les forces engagées, les pertes ainsi que par l’emploi des techniques les plus modernes de l’art de la guerre. Sur le plan politique, la victoire du Japon, pays non européen, pays du Sud, a constitué un des premiers signes qu’il était possible de défaire l’Occident. La Russie étant considérée comme en faisant partie. Pour en savoir plus la guerre russo-japonaise, voir ==> ICI
A noter. D’autres signes de la non-invincibilité des armées occidentales ont été données à cette période. La victoire de l’Ethiopie à Adoua en 1896 contre les troupes italiennes. Mais aussi la série de victoires d’Abdelkrim el Khattabi (1882-1963) contre les troupes espagnoles qui colonisaient le Nord du Maroc. Notamment la bataille d’Anoual en 1921. Abdelkrim el Khattabi a été porteur d’un mouvement de modernisation de la société de sa région. Il créé la République du Rif en 1922. La France vient alors à la rescousse du pouvoir espagnol. Les deux armées réussissent finalement à écraser la révolte d’Abdelkrim el Khattabi. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[3] Le hakama (袴) est un type de vêtement traditionnel japonais. C’est un pantalon large plissé (sept plis, trois devant à gauche, deux devant à droite et deux derrière), muni d’un dosseret rigide (koshi ita). C’était la tenue traditionnelle des nobles du Japon médiéval, et notamment les samouraïs. Il prend sa forme actuelle durant la période Edo. De nos jours, hommes et femmes portent le hakama (d’après Wikipédia).
[4] Quand on décrit le Pacte Germano-Soviétique, signé en aout 1939, on oublie souvent que l’URSS était aux prises avec les poussées impériales du Japon, tout au loin sur sa frontière Est. Cette menace de prise en étau a pu jouer un rôle dans la signature de ce Pacte.
1 Commentaire
Add comment Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.


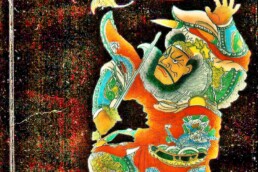
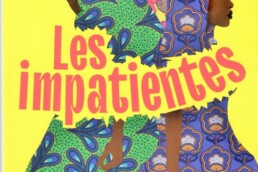
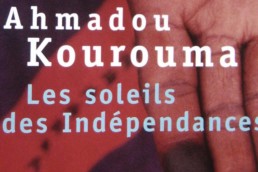
[…] Je viens de terminer la lecture du roman de Sawako Ariyoshi « Les dames de Kimoto ». Un livre qui m’a procuré de riches enseignements sur la société japonaise avant et pendant la poussée ultra-nationaliste qui a conduit au désastre de la guerre et à la défaite. Mais aussi un immense plaisir à sa lecture pour l’intelligence des sentiments humains qui y sont exposés. Voir sa note de lecture ==> ICI. […]