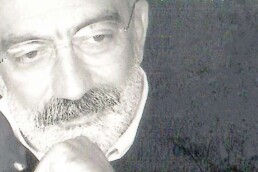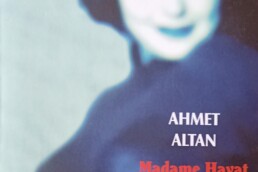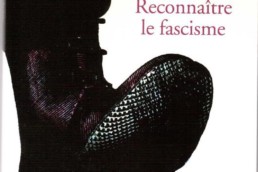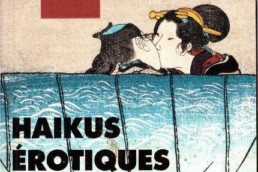« L’amour au temps des révoltes » d’Ahmet ALTAN. Ce texte prolonge le précédent roman « Comme une blessure de sabre ». Un roman qui, déjà, avait entremêlé déclin de l’Empire Ottoman et histoires d’amour (voir ==> ICI). Dans le présent roman, l’auteur poursuit son œuvre en démontrant sa profonde maitrise dans l’écriture des sentiments qui agitent hommes et femmes autour de l’amour. Ces histoires forment autant de tableaux d’un vaste paysage fait de luttes politiques sanglantes. Sur fond de révolte précédant la chute irréversible du système impérial.
Un pouvoir de tous temps adossé aux deux forces de l’Empire : la classe des mollahs, et celle des officiers. La scène politique du roman voit ces deux forces s’opposer violement. Les officiers dits « Unionistes » se sont emparé de pans de la modernité occidentale pour mettre à bas le pouvoir du Sultan. Ils sont divisés. Ils n’offrent pas une alternative crédible, étant sans culture démocratique. En face, les mollahs s’appuient sur les couches pauvres des villes et invoquent la défense de l’Islam. La religion bafouée selon eux par les giaours (les « infidèles », les non musulmans). Ils défendent farouchement le pouvoir du Sultan.
Le parcours de ces héros nous fait traverser les différentes couches dominantes de la société turque. Au moment où vacille l’Empire Ottoman. La modernité frappe à la porte des empires, et tout particulièrement à la Sublime Porte qui tente de maintenir sous sa férule un immense territoire[1]. Un espace où se mêlent aux Anatoliens Bulgares, Grecs, Circassiens,[2]Kurdes, Tsiganes, Arméniens, Abyssins, Arabes de Syrie, du Liban, d’Arabie, du Yémen, d’Egypte, de Tunisie… des Albanais et toute la mosaïque des peuples des Balkans…
Les jeunes officiers modernistes veulent introduire des éléments démocratiques dans la conduite de l’Empire en constitutionalisant le pouvoir. C’est ignorer l’incompatibilité fondamentale entre empire et démocratie.
« L’amour au temps des révoltes » porte bien son nom. Le roman montre la maitrise d’Ahmet Altan dans l’écriture des relations amoureuses dans leur infinie subtilité. Au fond, Altan est amoureux de l’amour. Et il met se penchant dans une immense maitrise dans l’écriture des sentiments, des relations où passions et assignations se mêlent. Pour nous donner de magnifiques pages à lire. Dans cette note de lecture, nous produisons quelques touches de ce beau roman d’amour et de révolte.
L’amour par-delà les conventions
Dès le premier chapitre, l’auteur nous entraine dans la relation qui se noue entre Hikmet Bey et une religieuse française. L’homme est soigné dans l’hôpital des sœurs de ses blessures provoquées par son suicide manqué. C’est l’infidélité de son épouse, Mehpare Hanim, qui a plongé Hikmet Bey dans le désespoir. Son engagement au sein des Unionistes[3] n’a pas été un rempart contre ce geste. Et d’avoir raté son suicide l’humilie au plus haut point.
Avec Sœur Clémentine, la relation est toute en subtilité, en propos allusifs, en regards à peine portés. La retenue est de mise. La religieuses accède à la chambre du malade comme infirmière. Dans l’intimité de sa présence, les mots s’échangent. Hikmet maitrise le français qu’il a appris à Paris où il a fini ses études. Il réussit, un court instant, à ébranler la religieuse qui a quitté la vie parisienne. Mais elle se reprend et l’homme quitte l’hôpital, rétabli, avec la sensation d’avoir été capable d’aimer après l’immense désespoir qui l’a conduit à ce geste.
Le fier soldat capitule devant la femme dominatrice
Ragip Bey, officier supérieur, affronte le froid et la neige de l’hiver à Istanbul. Dans les tourbillons de vent glacé sur les rives du Bosphore, il sauve d’une agression une femme de la haute société stambouliote, Dilara Hanim, veuve d’un important pacha. Une femme où la richesse et l’éducation le disputent à l’élégance et le raffinement. Ragip Bey, habitué à la rude vie de combat où il a fait preuve d’héroïsme, n’a jamais rencontré une telle femme. L’officier, profondément malheureux dans son ménage, se laisse happer par elle dans l’aveuglement d’une relation qui s’engage.
Mais l’amour entre les deux êtres va se révéler dans la tourmente mortelle de la révolte qui s’abat sur Istanbul.
Le « cadeau » du père à son fils
Hikmet Bey retrouve son père à Istanbul. L’humiliation de son suicide raté reste un silence entre père et fils. Mais Resit Pacha accueille Hikmet avec bienveillance, bien qu’ils soient, de fait, dans les camps opposés. Resit Pacha le médecin personnel du Sultan soutien son maitre. Tandis que Hikmet Bey reste proche des Unioniste même s’il a pris ses distance depuis quelques temps.
A son arrivée à Istanbul, dans la maison de son père qui l’accueille, Hikmet reçoit, à sa surprise, une jeune femme en cadeau. Elle est Circassienne, n’a jamais connu d’homme et a reçu la meilleure éducation. Elle se donne à lui, y compris en lui demandant de la nommer. Hikmet lui donne le prénom de Hediyé. Dans cet étrange espace relationnel, fait de domination, une relation profonde va se nouer.
La balade du Sultan dans son jardin privé
Le pouvoir du Sultan s’est effrité, tandis que les Unionistes se déchirent dans leur impuissance à diriger l’immense empire. Leur impuissance et leurs divergences : faut-il maintenir l’Empire tel qu’il est ? Comment répondre aux aspirations nationalistes des minorités qui le composent ? Quid de la démocratie ?
A cet instant, le Sultan ne joue plus de rôle majeur. Sa tyrannie s’arrête avec son pouvoir. Avec Resit Pacha, le père de Hikmet Bey, médecin personnel du Sultan et confident, il parcourt son jardin où évoluent des animaux sauvages qu’il a fait venir des bouts du monde.
La révolte se répand dans la ville, autour des ministères et du Palais
Nous sommes en 1908. Les soldats, les officiers sortis du rang se laissent entrainer par les mollahs contre la caste des officiers de haut rang qui forme l’essentiel des effectifs des Unionistes. Toute leur humiliation passée du fait de ces officiers supérieurs ressurgit dans cette révolte qui va prendre une tournure d’une extrême violence. Des officiers sont molestés. Tués par la troupe alliée à une partie de la population.
L’obéissance a disparu dans les rangs de l’armée qui donne tous les signes de désagrégation. Des groupes de soldats de la marine errent dans la ville sous l’emprise de l’alcool, en pourchassant les femmes sans voile au nom de la « Charia ». La 1ère Armée semble entièrement avoir basculé dans le camp de l’insurrection qui éclate. Dénonçant les « officiers giaours »[4] inféodés aux idées occidentales, les mollahs dictent les mots d’ordre : « Restauration de la Charia », « Retour du pouvoir au Sultan », « Abolition de la Constitution ».
Le Sultan, qui soutient sans le dire les insurgés, joue de la confusion qui s’est installée dans la ville. Il adopte une attitude ambigüe faite d’attentisme. Tandis qu’à Salonique, les Unionistes se regroupent avec la 3ème Armée qu’ils réorganisent rapidement pour marcher sur la capitale et restaurer l’ordre.
Nous suivons les personnages du roman dans les bouleversements qui agitent la capitale
- Mehpare Hanim, prend conscience du danger que courent ses enfants qu’elle a laissé à Istanbul en se réfugiant chez son amant à Salonique. Elle découvre dans la douleur et l’inquiétude la joie de l’amour maternel. Elle revient à Istanbul.
- S’arrachant des bras de Dilara Hanim, Ragip Bey a rejoint le ministère de la Guerre cerné par les émeutiers. En l’absence de directives politiques claires, une grande confusion y règne. Ahmet Altan explore là la difficile relation entre le politique et le militaire. Un thème toujours actuel en Turquie. Ragip Bey prône la fermeté et propose au Chef de l’armée de réduire l’insurrection par la force. Mais le Chef attend des ordres du gouvernement, du Sultan. C’est la politique qui commande. Même si une partie du jeu reste sous la table, avec la forte suspicion d’influences étrangères sur les évènements qui agitent l’Empire. L’Allemagne, la Grande Bretagne, la Russie ont des intérêts dans cette région que l’Empire Ottoman a de plus en plus de mal à dominer.
- Devant tant d’indécision, la révolte gagne du terrain. L’officier Ragip et les officiers supérieurs encore présents à Istanbul vont partir pour rejoindre Salonique et la 3ème Armée qui va marcher sur la capitale pour rétablir l’ordre… Et destituer le Sultan. Son frère, militant actif des Unionistes à l’étranger, rentre au pays.
- La mère de Hikmet Bey, Mihrisah Hanim, ex-femme de Resit Pacha, est revenue de Paris juste avant la révolte, avec les enfants que son fils a eus avec Mehpare. En grande pompe, avec ses dames de compagnie françaises, elle mène à grand train une vie de fête qu’elle interrompt avec l’éclatement des violences dans la ville.
- Dans le calme du couvent soufi le long de la Corne d’Or, le Cheik Effendi offre à nos personnages un espace de paix et de recueillement, en même temps qu’une protection dans ces moments troublés. Il dispense une voix de paix, soutenu par la transcendance de sa profonde croyance. En tant que Soufi, il ne soutient pas l’insurrection conduite par l’alliance entre mollahs incultes et soldats débridés.
- Hikmet Bey traine sa mélancolie dans sa grande maison où il se retrouve seul. Seul avec son humiliation d’avoir été abandonné par sa femme et d’avoir raté son suicide. Il s’éprend de Dilevser, la fille de Dilara Hanim qui est venue se réfugier chez lui avec sa mère lors des émeutes qui ont ébranlé Istanbul. A la toute fin du roman, Hediye l’esclave, va faire le geste fatal qui l’affranchira de sa condition.
& & &
[1] L’Empire ottoman, connu historiquement en Europe de l’Ouest comme l’Empire turc[ la Turquie, ou bien la Turquie ottomane, est un empire fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l’Anatolie, dans la commune de Söğüt (actuelle province de Bilecik), par le chef tribal oghouze Osman Ier, fondateur de la dynastie ottomane. Après 1354, les Ottomans entrèrent en Europe. Avec la conquête des Balkans, le Beylik ottoman se transforma en un empire transcontinental. Après avoir encerclé puis réduit sa capitale en lambeaux, les Ottomans mirent fin à l’Empire byzantin en 1453 par la conquête de Constantinople sous le règne du sultan Mehmed II.
Aux XVe et XVIe siècles, sous le règne de Soliman Ier le Magnifique, l’Empire ottoman était un empire multinational contrôlant une grande partie de l’Europe du Sud-Est, des parties de l’Europe centrale, de l’Europe de l’Est, et de l’Asie occidentale, du Caucase et de l’Afrique du Nord. Au début du XVIIe siècle, l’Empire comprenait trente-deux provinces et de nombreux États vassaux.
Avec Constantinople comme capitale, et le contrôle des terres autour du bassin méditerranéen, l’Empire ottoman fut au centre des interactions entre les mondes oriental et occidental pendant six siècles. L’Empire continua à maintenir une économie, une société et une armée puissantes tout au long du XVIIe et d’une grande partie du XVIIIe siècle.
Les Ottomans subirent de graves défaites militaires à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Cela les amena à entamer un vaste processus de réforme et de modernisation connu sous le nom de Tanzimat. Ainsi, au cours du XIXe siècle, l’État ottoman était devenu beaucoup plus puissant et organisé malgré de nouvelles pertes territoriales. En particulier dans les Balkans. L’Empire s’allia à l’Allemagne au début du XXe siècle, espérant échapper à l’isolement diplomatique qui avait contribué à ses récentes pertes territoriales. Il s’engagea ainsi dans la Première Guerre mondiale du côté des puissances centrales. Peu préparé à participer à une guerre moderne, l’empire dut également affronter d’importantes tensions internes. En particulier dans ses possessions arabes, avec la révolte arabe de 1916-1918. Pendant ce temps, des exactions furent commises par le gouvernement ottoman, dont certaines de nature génocidaire contre les Arméniens, les Assyriens, les Grecs, et les Libanais.
La défaite de l’Empire et l’occupation d’une partie de son territoire par les alliées au lendemain de la 1ère Guerre mondiale entraînèrent sa partition. La perte de ses territoires du Moyen-Orient divisés entre le Royaume-Uni et la France, selon des mandats de la SDN, dans l’attente de l’indépendance des territoires considérés. Palestine, Mésopotamie (futur Irak), Syrie et Liban. Le succès de la guerre d’indépendance turque contre les occupants alliés conduisit à l’émergence de la république de Turquie, proclamée le 29 octobre 1923, et à l’abolition de la monarchie ottomane.
L’Empire ottoman a duré de 1299 à 1923 (soit plus de six siècles). Il a été longtemps un petit beylicat autonome, puis indépendant de fait du sultanat seldjoukide, alors en pleine décadence. Il s’étendit ensuite durant trois siècles des portes de Vienne au golfe Persique, d’Oran en Algérie à Bakou sur la mer Caspienne. Et des steppes de l’actuelle Ukraine aux marais du Nil dans l’actuel Soudan et aux montagnes de l’actuel Yémen.
Dans le cadre de ses relations internationales, l’Empire ottoman était appelé « Sublime Porte», du nom de la porte d’honneur du grand vizirat, siège du gouvernement du sultan. (d’après Wikipédia).
[2] Les Tcherkesses ou Circassiens, qui se nomment eux-mêmes Adyguéens, sont un peuple du nord-ouest du Caucase. L’ensemble des Adyguéens forme une population fractionnée de quelque 800 000 personnes, auxquelles s’ajoute une très importante diaspora (d’après Wikipédia).
[3] « Jeunes-Turcs » est le nom donné à un mouvement politique nationaliste, moderniste et réformateur ottoman, officiellement connu sous le nom de Comité Union et Progrès. Ses chefs ont mené une rébellion contre le sultan Abdülhamid II (renversé en 1909), planifié le génocide arménien et mis en œuvre la turquisation de l’Anatolie.
Le mouvement jeune-turc est né le 14 juillet 1889, jour du centenaire de la prise de la Bastille, au sein de l’École de médecine militaire de Constantinople. Les étudiants y réclament le rétablissement de la Constitution de 1876 supprimée par le sultan Abdülhamid II en 1878. Au début, les Jeunes-Turcs se recrutent principalement dans les écoles supérieures militaires. Ils gagneront ensuite le soutien des hauts-fonctionnaires, des oulémas, et des cheikhs. Les formalités d’admission étaient inspirées du rituel maçonnique. Il devait prêter serment en posant la main successivement sur le Coran et sur une épée. Il jurait d’assurer un meilleur avenir au pays, en obéissant aveuglément à tous les ordres venant de l’association.
Au cours des années 1895-97, le mouvement s’étend à l’ensemble de l’Empire ottoman, mais aussi auprès des cercles d’exilés. Comme à Paris où Ahmed Riza, fervent adepte du positivisme d’Auguste Comte, fait figure de chef. Le premier congrès des Jeunes-Turcs se tient à Paris en 1902. Il rassemble une cinquantaine d’opposants divisés en deux factions, occidentaliste et turquiste. Les Jeunes-Turcs sont particulièrement actifs en Macédoine. Où, en 1907, le comité de Salonique fusionne avec celui de Paris pour former le Comité Union et Progrès (CUP).
Le parti compte alors trois grands courants idéologiques. L’un occidentaliste et libéral, favorable à un État décentralisé (c’est le cas notamment des militants arméniens du parti Dachnak) et proposait des réformes radicales dans le pays en délaissant l’islam. L’autre de tendance islamique, proposait de moderniser l’Empire en respectant la culture et les valeurs islamiques. Il s’agissait alors de reprendre le savoir technique de l’Occident, en délaissant le savoir moral. Enfin, la tendance turquiste, nationaliste, emmenée par Ahmed Riza. Celui-ci défendait un centralisme autoritaire chargé de maintenir l’intégrité territoriale de l’Empire. Néanmoins, les trois grands courants étaient unanimes dans les critiques faites au Sultan. Notamment son incapacité à résister aux pressions étrangères. Ainsi que son autoritarisme et sa brutalité. Enfin, ils s’accordent tous sur la nécessité de rétablir la Constitution, et décident de s’appuyer sur l’armée pour y parvenir.
La plupart des Jeunes-Turcs se rattachaient à des courants européens parfois contradictoires. Ainsi, comme le note l’historien franco-turc Hamit Bozarslan, parmi plus francophiles des membres du Comité, l’on pouvait trouver des sympathisants du socialisme réformiste et républicain porté par Jean Jaurès. Ou des enthousiastes du nationalisme intégral porté par Charles Maurras, certains se réclamant des deux à la fois.
Le mouvement était principalement constitué de Turcs, mais s’allia à des partis nationalistes réformistes d’autres peuples ottomans comme les Arméniens. Puis se retourna contre eux pour promouvoir l’avènement d’un État turc homogène d’un point de vue ethnique et religieux. La traduction concrète en fut la déportation et l’extermination des Arméniens en 1915. Il dirigea à plusieurs reprises le gouvernement de l’Empire ottoman entre 1908 et la fin de la Première Guerre mondiale en 1918.
[4] Terme péjoratif utilisé par les Turcs pour désigner une personne non musulmane, considérée comme infidèle ou mécréante.
Surla fin de l’Empire Ottoman, on peut aussi lire ==> ICI
Articles similaires
« Madame Hayat » de Ahmet ALTAN (note de lecture)
20 octobre 2024
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019