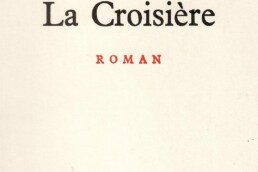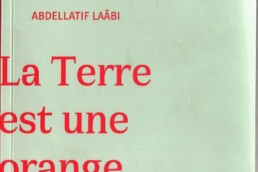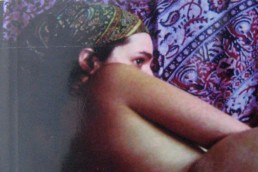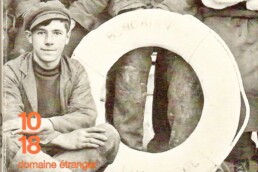« La petite fille » de Bernhard SCHLINK. Un récit plein d’amour et de mélancolie sur fond de fracture entre Est et Ouest et de montée des groupes néo-nazis en Allemagne. Un récit qui nous renvoie une image sombre de ce pays. Et notamment de cette réunification qui a totalement écrasé ce que la vie à l’Est, avec ses limitations, ses interdictions, ses contraintes, sa tristesse, avait d’authentique, par-delà le récit qui a dominé.
L’emprise des idées néo-nazies sur une partie de la population de la partie Est de l’Allemagne, après la réunification. Le mépris dont sont l’objet ces gens par ceux de l’Ouest. Et le vécu de cette emprise et de ce mépris, à l’échelle d’un individu, sur « la petite fille ». Dans son rapport complexe avec celui qu’elle reconnait comme son grand-père.
Une histoire d’amour. Avec, tracé au couteau par la violence de l’histoire, la séparation entre Est et Ouest vécue dans la chair de personnages humiliés.
Le roman commence avec la mort de Birgit
C’est son compagnon, Kaspar, qui la retrouve dans l’appartement qu’ils partagent dans l’Allemagne désormais réunifiée. Une boite de somnifères est vidée à côté d’elle, dans la baignoire où l’eau a refroidi quand Kaspar la découvre.
Birgit s’était enfoncée dans l’alcool et la dépression depuis plusieurs années. Ecrasée par un secret que Kaspar va découvrir progressivement, en lisant le manuscrit d’un roman qu’il découvre dans ses affaires. Un roman qu’elle écrivait en secret depuis des années et ne parvenait ni à afficher, ni à achever.
Il découvre que Birgit a laissé derrière elle une enfant qu’elle a abandonné quelque part à l’Est. Son départ avec lui à l’Ouest a coïncidé avec cet abandon. Sans que le lien soit clair entre les deux actes. Il découvre qu’elle ne cesse de vouloir retrouver cette enfant. Cette petite fille. « La petite fille ».
On trouve dans le roman de l’auteur le manuscrit de Birgit découvert par Kaspar. S’ajoute la voix de Kaspar qui raconte à la première personne. Qui s’interroge sur cette part de Birgit qu’il ne soupçonnait pas. Sur son amour et sur le sens de ce secret non partagé qui a, finalement, miné leur relation. Et eu raison de la raison et de la vie même de Birgit.
Birgit et Kaspar, l’Est et l’Ouest réunis
Birgit raconte sa relation d’amour, avant la réunification, dans son roman inachevé. Une rencontre, dans la partie Est de Berlin, entre étudiants des deux parties de l’Allemagne. Les interrogations des uns sur les autres. L’amour, la politique, les études… La volonté de savoir, et la fraicheur de la jeunesse dans ces découvertes mutuelles. Elle, Birgit, est de l’Est. Lui, Kaspar, vient à Berlin depuis l’Ouest.
Bernhard Schlink nous livre ici, avec délicatesse et profondeur, des mots sur le thème mille fois traité de la rencontre amoureuse. Mais c’est une rencontre où la question du Mur joue un rôle central. Ce Mur qui divise Berlin en deux parties presque totalement étanches. Ce Mur qui rend les mouvements des deux amoureux asymétriques. Kaspar peut entrer à Belin Est (sans pouvoir y passer la nuit). Birgit ne peut pas aller à l’Ouest. Point.
Ils se découvrent Tombent amoureux.
Birgit et Kaspar : deux dilemmes pour une rencontre
Lui est prêt à s’installer à l’Est pour vivre avec elle. Il n’en est pas question pour Birgit. Alors Kaspar lui promet qu’il la fera sortir, par des voies clandestines. Mais se joue un autre dilemme pour Birgit et elle seule à le vivre. Elle est enceinte de Léo, son compagnon avec qui elle vient de rompre. Il lui a proposé de prendre l’enfant et de l’élever avec sa nouvelle compagne. Birgit est ulcérée par cette proposition qu’elle juge monstrueuse.
Elle ne peut plus avorter, sa grossesse est trop avancée. Elle décide, avec l’aide de Paula, une amie d’enfance, d’abandonner le bébé dans une institution publique juste avant de quitter l’Est pour rejoindre clandestinement Kaspar à l’Ouest. Birgit ne se retourne pas dans ce geste. Sur le moment.
Mais le regret l’envahi alors qu’elle vit depuis des années avec Kaspar
Alors qu’elle vit avec ce secret. Elle veut retrouver cette enfant perdue. Perdue dans les méandres de l’Allemagne de l’Est qui a maintenant disparu avec la réunification. Perdue dans un monde lui-même perdu. Elle n’en dit rien à Kaspar, ni à quiconque. Mais elle est écrasée par cette dissimulation (p 109) « Malheur à ce qu’on cache. Malheur à ce qu’on tait. » Seule Paula sait. Mais le lien avec cette amie s’est rompu avec le temps.
Le rêve d’un monde nouveau ? Effacé !
Bernhard Schlink aborde l’histoire de l’Allemagne divisée avec une grande humanité. Pour Birgit, son choix de quitter la RDA (République Démocratique Allemande, l’ancien nom de l’Allemagne de l’Est), est irrévocable. Mais pour autant, faut-il écraser les rêves de la création d’un homme nouveau, d’une vie nouvelle ? Qui ont mobilisé des millions d’Allemands après la Guerre ? Faut-il piétiner ce rêve et les gens qui l’ont porté ? Malgré les désillusions. Malgré la répression et les horreurs bureaucratiques du pouvoir ?
Dans le manuscrit de son roman, Birgit écrit : (p 66) « La RDA me rend triste. L’enthousiasme pour l’époque nouvelle, l’espoir d’un pays neuf et d’un homme nouveau, l’engagement et les sacrifices des premières années – même si rien n’est resté de ce début, ce fut pourtant un début. Même si rien ne reste des tentatives pour faire avancer le pays en dépit du système et contre lui [1]. Rien de l’insistance à marquer que socialisme et liberté vont de pair. Et que l’avenir appartient aux deux ensemble. Ce fut un moment et ce fut réel et une bonne réalité, contre la mauvaise du socialisme réel. »
Elle évoque là les tentatives d’opposition au système pour construire ensemble socialisme et liberté. On ne peut effacer totalement ce rêve. Il était légitime ! Elle souffre de cet effacement total. (p 67) « Le pays et le rêve sont perdus irrémédiablement. »
Birgit en quête de…
Nous sommes toujours dans la lecture du manuscrit de Birgit. Arrivée dans l’Ouest avec Kaspar, elle s’inscrit à l’université, mais ne se sent pas accueillie dans ce milieu. Elle est épinglée comme « différente ». Une différence prise dans l’idéologie de la revanche sur l’Est de la part de ceux qui la stigmatisent.
Birgit quitte l’université. Elle part en Inde rejoindre un ashram [2]. Là encore, elle se rend compte que les participants occidentaux veulent se débarrasser de leurs réflexes d’occidentaux. Ce n’est pas son problème. (p 138) « Pendant ces mois à l’ashram, je m’étais laissé contaminer par le désir nostalgique qu’avaient les autres d’une vie sans rationalisme ni matérialisme, sans cupidité, ni angoisse, sans égo. Ce désir nostalgique n’était pas le mien. Je ne croyais pas à la rationalité et je ne croyais pas aux choses matérielles. Je n’avais pas d’ambition ni d’angoisse de perdre, je n’avais pas à être libérée de cela. »
Elle revient en Allemagne rejoindre Kaspar. Birgit apprend la bijouterie. Puis la cuisine. Qu’est ce qui ferait plaisir à sa fille à qui elle ne cesse de penser, secrètement ? Un cadeau en bijoux ? Un bon repas ? Toujours dans la dissimulation, elle reste au seuil de cette recherche. Sans s’y engager vraiment.
Dans les dernières lignes du manuscrit inachevé, elle écrit la reconnaissance de l’amour que Kaspar lui porte.
Le roman reprend avec le récit de Kaspar
Après la lecture du manuscrit, Kaspar s’interroge sur l’amour de Birgit. Elle ne l’a pas aimé comme il l’a aimé. Prise dans son secret, elle a gardé une part d’amour secrète. Une part « confisquée » par son fantasme sur sa fille.
Il s’interroge. Finalement, il décide de partir à la recherche de cette fille, qui est maintenant une femme d’une quarantaine d’années.
Sur les traces de Svenja…
Kaspar retourne dans les anciennes terres de l’Est. Il commence par retrouver Paula à qui Birgit avait confié le soin de déposer le bébé sur le seuil d’une institution. Paula le reçoit avec bienveillance et lui donne le nom de la fille, Svenja. Mais elle n’a pas fait ce que voulait Birgit. Tout au contraire, elle a confié le bébé à Léo, son père.
Alors Kaspar va rencontrer Léo et Svenja. Léo lui raconte l’adolescence agitée de celle-ci. Il l’a placée dans un établissement de redressement très sévère. Nous sommes en RDA. Rien n’a été réglé de ses addictions et autres troubles de comportement.
Plus tard, après la réunification, l’Allemagne n’a pas traité avec générosité la jeunesse de l’Est. Ainsi, les formations acquises à l’Est n’ont pas été reconnues. C’est Paula qui parle : (p 162) « … ce qu’ils avaient appris et fait en RDA ne valait souvent plus rien. Mais quand on est jeune et qu’on n’a rien alors qu’on vient de faire des efforts pour avoir une formation, ca vous flanque facilement par terre. »
La rencontre
Kaspar finit par retrouver Svenja dans un petit village de l’Est. Elle et Björn, son mari, l’accueillent assez froidement. Avant que Björn ne comprenne qu’il y a un héritage en jeu. Mais l’accès à cet héritage ne va pas de soi. Selon la loi, Svenja n’est pas la fille de Birgit. Björn mélange menaces et distance. Svenja le soutient en silence. Leur fille de 14 ans, Sigrun, adopte immédiatement Kaspar comme son « grand-père ». Mais elle a des idées très arrêtées.
Le soir, c’est fête au village. Chants nationalistes et folkloriques magnifiant la terre allemande, la langue allemande. Bière et saucisses. Le mouvement völkisch [3] est très présent et affiche sa volonté de renforcer la communauté allemande. Ferme par ferme. Village par village.
Kaspar est mal à l’aise, mais il ne veut pas heurter le couple. Et surtout Sigrun qui va venir passer chez lui quelques jours, à Berlin, lors des prochaines vacances.
Avec Sigrun à Berlin
C’est une adolescente très vive, intelligente, volontaire, potentiellement dominatrice. Qui lit beaucoup. Chante avec les jeunes du village. Gagne les compétitions sportives comme un garçon… Qui sait quelles sont ses idoles. Herman Hess bras droit d’Hitler qui a cherché à négocier une paix séparée avec la Grande Bretagne en 1941. Irma Grese, une femme nazie responsable de 30.000 détenues dans le camp d’Auschwitz.
Kaspar sait qu’il va avoir fort à faire avec « la petite fille ». Il prépare un programme précis de concerts et de théâtre à Berlin. Lui fait découvrir la ville. Sigrun est ravie. Mais ne démord pas de ses positions. Elle tient tête à Kaspar. Elle le bat aux échecs. C’est une combattante !
Néo-nazie et féministe
Lors d’un second séjour à Berlin, Sigrun insiste pour voir une amie, accompagnée par Kaspar. Dans les marges sinistres de la ville, elle revoit Irmtraud. Une jeune femme très engagée dans les mouvements néo-nazis, mais du côté féministe.
Elle revendique l’autonomie des femmes dans la violence. On n’a pas besoin des hommes, fussent-ils néo-nazis, pour attaquer la police, pour incendier un foyer d’immigrés… L’attitude de Sigrun marque une certaine ambivalence vis-à-vis de ces propos.
L’emprise des idées néo-nazies
Kaspar prend la mesure de l’influence envahissante des idées néo-nazies sur l’esprit de Sigrun. A propos d’un livre qu’il lui a donné à lire sur Rudolf Hess, elle dit : (p 243) « Il est plein de mensonges. Tous ces livres, ici, sont pleins de mensonges. Hitler ne voulait pas la guerre, il voulait la paix. Et les Allemands n’ont pas tué les Juifs. » Au Journal d’Anne Frank, Sigrun oppose un autre ouvrage La vérité sur le Journal d’Anne Frank qu’elle a lu.
Sur la croix gammée, elle raconte. (p 271) « Tu penses que j’ai honte de la croix gammée ? Elle se redressa et toisa Kaspar. Ma première, je l’ai peinte en 1988 sur le mur de la Maison de la Culture. J’en suis fière. Nous étions les seuls à ne pas jouer le jeu des autres. Le jeu où le socialisme est pour la paix et n’exploite personne. Et aime les gens. Et que nous sommes tous unis. Le Parti et les bourgeois libéraux et les chrétiens et les Eglises. Tous ceux qui sont de bonne volonté. Comme j’ai détesté ça, ce bavardage mensonger (…). »
Ces propos sont assez peu vraisemblables dans la bouche d’une adolescente de 14 ans, fut-elle intelligente. Mais l’essentiel est le message que Bernhard Schlink nous transmet dans ces lignes.
Sigrun a voulu visiter le camp de concentration de Ravensbrück. Encore avec Kaspar. Sur les photos exposées, elle remarque que les gardiennes avaient un visage souriant, sympathique. Les détenues ? Des ennemies des Allemands, des criminelles, puisqu’elles étaient internées ! Rien ne l’écarte de ces pensées révisionnistes.
Et elle n’a pas de mot trop durs pour stigmatiser ce qu’elle estime être la lâcheté de Kaspar. (p 278) « Vous avez oublié et désappris ça : le combat, le grand but et la victoire. Et la joie de la dureté. (…) Tu ne te bas même pas contre moi. Ce que je dis ne te va pas, mais tu n’y opposes rien. Non tu prends un air compréhensif, peut être soucieux, peut être triste. »
La vision
Sigrun expose sa vision de l’évolution de la société allemande et sur les efforts pour se préparer au combat. Elle s’adresse à Kaspar. (p 258) « Vous vous bouchez les yeux. Mais tout le monde peut voir que les musulmans veulent conquérir l’Allemagne (…). Nous pouvons nous soumettre ou nous défendre. Si nous voulons vaincre, nous devons être les plus forts. Nous devons sous y préparer. (…) C’est une loi éternelle. Vous l’avez oubliée. Père ne l’a pas oubliée et nous la rappelle sans cesse. »
La logique est imparable. Le danger est à nos portes, nous devons aiguiser nos couteaux, nous défendre par la force. La violence est inscrite comme conséquence inéluctable du mensonge de départ !
Le mépris
Elle a conscience de la distance qui existe entre Kaspar et ses parents. S’adressant à Kaspar, elle dit : (p 253) « Pour toi, nous ne valons rien. Tu trouves qu’on est bêtes, qu’on a tout faux. Qu’on ne peut pas parler avec nous. Tu penses que tu vaux mieux que nous. »
Sigrun exprime ici le sentiment d’être l’objet d’un mépris de classe. On retrouve cette même idées dans le roman d’un auteur turc, dans un contexte totalement différent : « Neige » d’Orhan Pamuk. Dans cet ouvrage, on assiste au dialogue entre un intellectuel turc ancien militant de la gauche laïque, et un jeune islamiste marginalisé. Ce dernier, humilié par l’intellectuel, trouve dans l’Islam un recours, un secours contre ce mépris. Non pas comme ressource spirituelle, mais comme entrée dans une communauté, la communauté solidaire des méprisés. Avec le raidissement raciste qui l’accompagne. L’islamisme se rattache vraiment l’extrême droite. Le jeune crache sa rage d’être humilié : « On n’est pas idiots ! On est seulement pauvres ! » Voir la note de lecture de l’ouvrage ==> ICI
La musique
Sigrun voit chez Kaspar le piano sur lequel Birgit, sa grand-mère, a longtemps joué. Elle s’y met, et démontre un grand intérêt pour l’instrument et pour la musique en général. Une complicité s’établit avec Kaspar sur ce terrain. Avec la découverte des grands compositeurs allemands. Allemands et … étrangers. Kaspar valorise les dispositions de Sigrun pour la musique. La petite fille est ravie.
Avant de repartir chez ses parents, elle accepte l’idée d’un voyage pendant les vacances d’été. Et même de passer un an à l’étranger. Mais ses parents accepteront-ils ? Surtout son père qu’elle vénère. Qu’elle défend contre ce qu’elle prend pour le mépris de Kaspar. Dont elle admire et craint la violence.
L’échange se rompt brutalement
Un grand silence s’établit entre Sigrun, retournée dans sa famille, et Kaspar. Un jour, elle l’appelle brièvement et lui demande de venir. Plein d’appréhension, il débarque dans la famille.
Björn, le père, est fou furieux. Il comprend que Kaspar a cherché à détacher Sigrun des idées dans lesquelles lui et Svenja l’élèvent. Il l’insulte et le chasse violement. Svenja rete silencieuse. Sigrun est en pleurs.
Bernhard Schlink met dans la bouche de Björn les propos suivants adressés à Kaspar. (p 344) « Je t’ai fait confiance [en permettant à Sigrun de passer du temps chez toi]. Je savais que tu lis la presse qui ment. Que tu as le culte de la culpabilité [sur la responsabilité de l’Allemagne dans la Shoa]. Et que tu es du côté des baratineurs prônant l’accueil [des immigrés et réfugiés]. Tu détestes l’Allemagne. C’est de la haine de soi. C’est une maladie. Tu n‘as pas d’honneur en toi. Mais je pensais que tu avais le respect de la famille. C’est quelque chose entre père, mère et enfants. On n’y touche pas. Et on ne s’y insinue pas pour la ronger.
(…) Vous ne respectez rien. Ni l’Allemagne. Ni ceux qui servent l’Allemagne, les enseignants et les fonctionnaires, le soldats et les paysans. Vous vous moquez d’eux. Tout ce que vous êtes capables de faire, c’est vous réaliser vous-mêmes. Vous prenez du hasch et de la coke. Vous vous êtes baladés dans les institutions et vous avez raflé les postes et l’argent. La famille ? Oui quand c’est une famille monoparentale, une famille rafistolée, une famille de pédés. Sinon : amour libre. Des familles saines, vous n’en connaissez pas. Tu t’es dit allons voir. Allons voir si on ne peut pas empoisonner cette famille. Rendre malade une famille saine. Malade comme tu es malade. »
Kaspar vit mal cette perte
Il rentre à Berlin, totalement désemparé. Il se sent lâche de s’être tu devant l’avalanche d’insultes proférée par Björn devant Svenja et surtout devant Sigrun « la petite fille ». Kaspar prend conscience de la place qu’elle a occupé dans sa vie. Une place désormais vide. Plus de piano dans la maison. Plus de petits déjeuners préparés soigneusement par elle. Fini les sorties au concert ou en randonnée…
Il mêle sa nostalgie de Sigrun sa petite fille à celle de Birgit. Il n’a pas donné suite à des esquisses de séduction avec des femmes plus jeunes. L’énergie à dépenser dans la connaissance mutuelle pour digérer les quantités de vies que chacun a vécu lui a semblé trop importante. Au-dessus de ses forces.
Surtout, il s’interroge sur Sigrun qu’il sent en danger. Que doit-il faire ? L’attendre au sortir du lycée ? Lui envoyer des lettres, des cadeaux ? Il n’en fait rien et se replie dans l’anxiété.
Deux ans passent. Sigrun ressurgit brutalement
Elle revient une nuit. Elle est en fuite et demande de passer la nuit chez lui, après une grave « bêtise ». Sigrun a rejoint son amie Irmtraud dans la « zone ». Elle s’est teint les cheveux en noir. Et porte du rouge à lèvres noir également. Avec son groupe nationaliste, elle a participé à des descentes violentes. Notamment en brulant des voitures d’élus de gauche. Ou en attaquant des restaurants tenus par des arabes…
Ce soir, l’action a mal tournée. Un jeune « antifa »[4] a été tué d’une balle de révolver par un de membres de son groupe.
Que va faire Kaspar ?
Il l’accueille, mais lui demande d’aller à la police. A tout le moins d’écouter les conseils d’un avocat, un ami à lui.
Sigrun pleure. Elle ne sait plus quoi penser, quoi faire. Elle se met au piano. Un moment d’apaisement pour elle. Alors qu’elle n’en faisait plus chez ses parents. Une pratique « trop de l’Ouest » pour eux !
La disparition
Finalement, Sigrun convient d’aller chez le procureur. Tout est préparé pour cela. Kaspar a mis à sa disposition les feuillets du manuscrit de Birgit. Mais au matin, pendant que Kaspar est dans sa librairie, elle disparait. Elle lui a laissé une lettre. Elle ne veut pas trahir son groupe d’amis. En partant, elle a pris dans le tiroir de Kaspar quelques billets et sa carte de crédit. Plus quelques livres et les vêtements qu’il a acheté pour elle.
Svenja vient le voir à Berlin. Elle craint pour sa fille. Elle explique que Sigrun n’a pas voulu rester à la ferme comme son père le voulait. Mais rien ne se passe de vrai entre elle et Kaspar. Svenja ne veut pas lire le manuscrit laissé par sa mère. Elle est comme éteinte. C’est Björn qui l’a sauvée de sa détresse à la fin de l’adolescence. Cela, elle le sait et le remercie. Elle lui doit beaucoup.
Loin, loin, l’Australie
Kaspar découvre, par les relevés sur sa carte bancaire, que Svenja est partie pour l’Australie. Il suit son déplacement et ses achats. Quelques restaurants bon marché. Des meubles achetés dans une vente de charité. Des partitions de musique… La carte perd sa validité dans quelques semaines. Le lien se coupe.
Il ne reste que les espoirs. Que l’imagination, les rêves. Svenja devenu musicienne. Kaspar va la découvrir comme pianiste dans un concert là-bas, loin, loin…
Comme une revanche !
Un fil courre tout au long du roman. Celui d’une méprise des populations de l’Est après la réunification par ceux de l’Ouest. Il fallait marquer qu’on avait gagné. Qu’on avait bien eu raison contre les horreurs de l’Est… La preuve ? Tous ces gens qui cherchaient à fuir de l’Est vers l’Ouest. Par le Mur. Ou par d’autres chemins. Voir à ce sujet le beau livre de Kapka Kassabova « Lisière » ==> ICI
Ce mépris a joué un rôle majeur dans le basculement vers l’extrême droite d’une partie de ces populations de l’ex-RDA. Et ce phénomène n’est pas réservé à la société allemande !
& & &
Bernhard Schlink, né en 1944 à Bielefeld (Allemagne), est un écrivain allemand.
Il grandit à Heidelberg dans une famille allemande protestante. Son père Edmund Schlink (1903-1984), pasteur et professeur de théologie à l’université a été relevé de ses fonctions par le régime nazi et n’a retrouvé sa chaire qu’à la fin de la guerre.
Schlink étudie le droit à l’université de Heidelberg, puis à l’université libre de Berlin. Depuis 1992, il est professeur de droit public et de philosophie du droit à l’université Humboldt de Berlin. De 1987 à 2006, il est également devenu juge au tribunal constitutionnel du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Schlink est membre du Parti social-démocrate d’Allemagne.
Il amorce sa carrière comme écrivain par plusieurs romans policiers. L’un de ses romans, Le Nœud gordien (Die gordische Schleife, 1988) a obtenu le prix Glauser en 1989.
En 1995, il publie Der Vorleser (publié en France en 1996 sous le titre Le Liseur), un roman partiellement autobiographique. Le Liseur fait entendre la voix des Allemands nés dans l’immédiat après-guerre. Le livre est à la fois un roman d’amour et un roman qui pose des problèmes d’éthique, ceux de la culpabilité et du rapport entre comprendre et juger et des relations entre gens de classes sociales différentes. Pour en savoir plus sur l’auteur, voir ==> ICI
[1] C’est moi qui souligne.
[2] Un ashram (devanagari : आश्रम) était, dans l’Inde ancienne un ermitage en un lieu isolé, dans la forêt ou la montagne, où, dans une grande austérité de vie, un sage vivait et cherchait l’union à Dieu dans la solitude et la paix intérieure. Loin des distractions et agitations du monde. Si le lieu servait à la pénitence, il était aussi utilisé pour la formation religieuse.
Ce mot est employé encore aujourd’hui dans l’hindouisme pour une institution animée par un guru où des élèves séjournent pour suivre les enseignements du maître. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[3] Le mouvement völkisch est un courant intellectuel et politique, apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Son projet est de donner à l’ensemble des Allemands une religion païenne. Ce courant d’idées puise ses sources dans le romantisme allemand des années 1840 et dans les désillusions de la période 1849-1862, entre l’écrasement du printemps des peuples et l’arrivée de Bismarck au pouvoir en Prusse.
Important par le nombre de groupuscules, mais peu par celui de ses adhérents, le mouvement völkisch s’est trouvé face à de nouveaux défis, imposant une nouvelle définition de la nation, de la nature et de l’individu. Pour les uns, le courant völkisch découle d’une vocation raciste permanente, liée aux apports de la biologie et du « darwinisme social ». Pour d’autres, il représente un courant foncièrement antisémite, ravivant un passé germanique largement mythifié dans un cadre de pensée en lutte constante contre le christianisme, et plus généralement contre les monothéismes. Le courant völkisch joua un rôle important lors de la révolution conservatrice sous la république de Weimar et certaines de ses idées furent reprises par le nazisme. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[4] Antifa est le nom collectif utilisé par différents groupes autonomes et souvent informels revendiquant une appartenance au groupe antifasciste. La plupart de ces groupes s’affirment comme antiautoritaires voire anticapitalistes, et s’inscrivent dans des courants d’extrême gauche, principalement anarchistes, mais pouvant également être issues de rangs communistes ou socialistes.
Les groupes Antifa sont connus pour leur recours à l’action directe afin de s’opposer frontalement à l’extrême droite et aux mouvements prônant la suprématie de la race blanche. Cela peut inclure la destruction de biens matériels et la confrontation physique lorsqu’ils jugent ces moyens nécessaires.
Le terme Antifa trouverait son origine dans l’Action antifasciste, appellation employée par des mouvements politiques de la gauche européenne des années 1920 et 1930, engagé contre le fascisme en Italie, en Allemagne et en Espagne. En réponse à l’essor du néonazisme après la chute du Mur de Berlin et l’effondrement de l’idéologie soviétique, des militants antifascistes sont réapparus en Allemagne (d’après Wikipédia). Pour en savoir plus, voir ==> ICI