« Neige » du Prix Nobel Orhan PAMUK. L’auteur nous entraîne, comme à son habitude, dans une littérature tourmentée et dépressive. Où s’entremêlent plusieurs niveaux de récits : politique, amoureux, policier, historique, religieux, artistique… Nous avons déjà connu cela avec son roman « Mon nom est rouge »…
Retour au pays de Ka, poète raté, ancien exilé politique
Avec « Neige », nous pénétrons dans la tristesse de Ka, un poète raté, ancien militant de la gauche laïque turque. Pourchassé par la répression dans son pays, ancien réfugié politique en Allemagne. Ka retourne dans son pays natal et va se perdre dans le froid de la ville frontière de Kars, près de la Russie. Tandis que tombe la neige sans interruption sur cette ville du bout du monde. Une neige qui enveloppe tout. Qui devient sale et triste comme le héros du roman.
Des poèmes qui « descendent » en Ka, le poète
Ka vit une histoire d’amour avec une femme d’une immense beauté, Ipek, qu’il a connue avant de partir dans son exil européen. Il n’a pu ramener avec lui Ipek en Allemagne. Alors qu’il est en panne d’inspiration depuis des années, 18 poèmes « descendent » en Ka pendant son séjour à Kars. Délaissant femme et amis, il les écrit fébrilement. On pense aux versets du Coran qui sont « descendus » sur le Prophète.
Un imbroglio dans l’intrigue. A la mesure de la confusion du personnage
Ka est venu à Kars pour le compte d’un journal laïque et républicain d’Istanbul pour enquêter sur une vague de suicides de jeunes femmes voilées. Il tombe dans un imbroglio politico-religieux. Coup d’Etat et assassinat réels en pleine représentation théâtrale… Meurtres, tortures policières, fanatisme islamiste, filatures, dévoilement des femmes, trahisons, ivresse de raki, manipulations de tous ordres… Dont il est partiellement l’acteur.
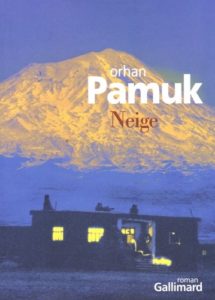
Neige, roman d’Orhan Pamuk, une histoire de mépris ! Le mot-clé du livre
La narration de cet improbable récit est tendue sur la trame d’un des profonds ressorts qui structurent la société turque, le mépris. C’est le mot clé du livre. Mépris qu’éprouvent les athées occidentalisés envers la masse de la population prise dans la religion. Envers une population pauvre « aliénée par des croyances aveugles« , auquel renvoie l’humiliation de cette population qui trouve dans l’Islam un recours, un secours contre ce mépris. Non pas comme ressource spirituelle, mais comme entrée dans une communauté, la communauté solidaire des méprisés.
Pour l’élite laïque et républicaine, se revendiquer comme ‘athée’, c’est « s’élever au rang des occidentaux« . C’est se sortir du peuple. Symétriquement, la masse des croyants rejette hors du peuple ces athées qui singent les occidentaux : « Comme ils croient aux mêmes choses que les Européens, ils se considèrent supérieurs au peuple« . Ces « athées à cravate, orgueilleux qui se moquent des croyances de leur peuple… « .
Sur le thème du mépris, on consultera avec profit les travaux d’Axel Honneth, qui a travaillé sur le désir de reconnaissance, sur l’humiliation et le mépris. Pour en savoir plus sur Axel Honneth ==> ICI
L’Islam, obstacle au développement ?
Pour les laïques, l’Islam est obstacle au développement. Obstacle à l’affranchissement des hommes, à la modernisation du pays. L’occidentalisation est vécue comme un rempart contre le glissement vers les croyances religieuses. Croire en Dieu, c’est être sans éducation, comme le sont les pauvres, tant les savoirs et comportements traditionnels sont objet de mépris.
Tout est dit dans les citations qui suivent !
Dialogue entre un vieil athée de gauche et un jeune islamiste (p 399). Le premier : « L’Europe, c’est notre futur au sein de l’humanité« . Le jeune islamiste : « Les européens ne représentent pas notre futur. Je ne pense jamais à les imiter ou à me rabaisser parce que je sais que je ne leur ressemble pas. (..) On n’est pas idiots ! On est seulement pauvres !« . Plus loin : « Il règne ici une sorte de honte à ne pas être européens, comme si on avait à s’en excuser. » ; « Eux [les européens], ce sont des êtres humains, et nous, eh bien nous, nous ne sommes que des musulmans.«
Commentaire de JOA
Le livre de Pamuk montre combien athées et religieux ont tous deux une vision fausse de l’Occident. Idéalisé par les premiers, diabolisé par les autres. Dans un aveuglement commun, les uns et les autres n’imaginent que des occidentaux acharnés à mépriser les croyants. A associer croyance et archaïsme. A utiliser leur athéisme comme accès à un statut supérieur. Comme un instrument identitaire de différentiation sociale et de mépris des classes pauvres. Aucun d’entre eux (y compris ceux qui se pensent « progressistes ») ne voit les valeurs qui ont fait la force et le succès de l’Occident. Egalité des droits, valorisation du travail, respect de l’individu, pensée critique… Même si ces valeurs reculent actuellement en Occident.
Un roman qui renvoie à toutes les sociétés de culture musulmane
Un roman qui déborde largement de la société turque. Qui concerne l’ensemble des sociétés de culture musulmane du pourtour méditerranéen dans leurs ressorts profonds. Une oeuvre qui anticipe les résultats des élections qui ont suivi les poussées démocratiques de 2011 sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Des résultats globalement favorables aux partis islamistes. Ainsi en Tunisie, au Maroc, en Egypte, dans les Territoires Palestiniens, en Algérie… Un roman qui explique l’incontestable popularité des dirigeants AKP en Turquie. Une popularité faite de revanche sur les laïcs qui ont confisqué à leur seul profit les avantages que leur procurait une occidentalisation superficielle.
Un ouvrage qu’il faudrait mettre dans les mains de tous les dirigeants de ces pays, qui maintiennent d’une main de moins en moins assurée un verrou sur l’évolution des sociétés.
& & &
Voir aussi « Réflexions à partir du cas turc » ==> ICI
Orhan Pamuk, est un écrivain turc, né en 1952 à Istanbul. Issu d’une famille cultivée de la bourgeoisie stambouliote, Orhan Pamuk envisage d’abord des études de peinture et de journalisme, avant de se consacrer entièrement à la littérature. Son premier roman (Cevdet Bey et ses fils, 1982) s’inspire en partie de son histoire familiale et place au cœur du récit les bouleversements de la Turquie contemporaine et les métamorphoses de sa ville natale, thèmes que l’écrivain n’aura de cesse d’explorer tout au long de son œuvre. En 1983, Le Château blanc, premier roman de Pamuk à être traduit en anglais, marque une étape dans sa carrière d’écrivain et une évolution vers des recherches narratives et formelles proches du postmodernisme et du réalisme magique. L’ouvrage apporte une renommée internationale à son auteur, amplifiées au fil des années par de nouveaux grands succès : Le Livre noir (1990), Mon nom est Rouge (1998), Neige (2002), Le Musée de l’innocence (2008) ou Cette chose étrange en moi (2014). Il a aussi publié plusieurs ouvrages sur Istanbul et un livre de souvenirs, D’autres couleurs (2011).
Traduit dans plus de soixante langues, lauréat de nombreux prix littéraires internationaux, Orhan Pamuk est souvent considéré comme l’écrivain turc le plus célèbre dans le monde. Ses romans ont rencontré un succès planétaire depuis leur parution et l’on estime qu’ils se sont vendus à plus de onze millions d’exemplaires. En 2006, il obtient le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier Turc à recevoir cette prestigieuse distinction.
Pour en savoir plus sur l’auteur ==> ICI
2 Commentaires
Add comment Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

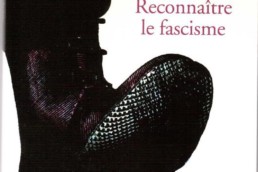


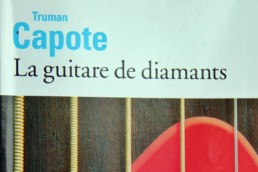
[…] Sigrun exprime ici le sentiment d’être l’objet d’un mépris de classe. On retrouve cette même idées dans le roman d’un auteur turc, dans un contexte totalement différent : « Neige » d’Orhan Pamuk. Dans cet ouvrage, on assiste au dialogue entre un intellectuel turc ancien militant de la gauche laïque, et un jeune islamiste marginalisé. Ce dernier, humilié par l’intellectuel, trouve dans l’Islam un recours, un secours contre ce mépris. Non pas comme ressource spirituelle, mais comme entrée dans une communauté, la communauté solidaire des méprisés. Avec le raidissement raciste qui l’accompagne. L’islamisme se rattache vraiment l’extrême droite. Le jeune crache sa rage d’être humilié : « On n’est pas idiots ! On est seulement pauvres ! » Voir la note de lecture de l’ouvrage ==> ICI […]
[…] La lecture de ce roman évoque pour moi celle de « Neige », d’Orhan Pamuk. On en trouvera une note de lecture ==> ICI […]