« Marie-Antoinette » de Stefan ZWEIG. Une des plus belle biographies qu’a écrite l’auteur. Celle d’un personnage traversant dans le drame les bouleversements qui vont déchirer la France. Durablement. Une période hautement singulière dont on sent, encore aujourd’hui, les traces profondes dans les fractures de la société.
Au fil de cette biographie, nous cheminons tout au long du processus révolutionnaire qui va embraser la société. Et ébranler l’Europe entière ! Un cheminement dans l’intimité d’une actrice majeure de ce bouleversement.
Marie-Antoinette a maintenu ses convictions royalistes jusqu’au bout. Avec une constance et une force reconnues. Habitée jusqu’au plus profond par sa conviction d’être à sa place de souveraine des Français selon le droit divin. Une croyance qui faisait de son statut de reine une disposition absolument intouchable par les êtres humains. Puisque accordée par Dieu lui-même.
Une formule de pouvoir que presque toutes les sociétés humaines ont inventé pour légitimer le maintien des dominants. La force n’est pas suffisante. Il faut aussi une légitimité transcendantale ! Zweig montre combien Marie-Antoinette est pénétrée par cette certitude. Jusqu’au bout.
Cet ouvrage résulte d’une nouvelle traduction en français
Celle-ci met magnifiquement en valeur l’écriture puissante de Stefan Zweig. Une écriture qui allie sensibilité, profondeur et beauté. Le plaisir tiré de la lecture de cette biographie très richement documentée qui couvre plus de 600 pages se combine avec l’intérêt politique de ces connaissances. Des connaissances utiles pour comprendre les grandes fractures qui continuent de structurer la société française et sa vie politique en ce début du XXI° siècle.
A l’origine de l’histoire, un revirement diplomatique
A la fin du XVIII° siècle, la France est la puissance dominant en Europe. Elle a face à elle des Etats émiettés : l’Allemagne, l’Italie. L’Angleterre dans son île regarde le monde entier. Elle digère difficilement l’indépendance de sa principale colonie. Celle qui va devenir en Amérique du Nord, les Etats Unis. Une indépendance acquise avec l’appui de la France ! Dans un bon esprit de rivalité sur la scène européenne. Mais l’Angleterre déploie progressivement son empire sur le monde.
La France, continentale par essence, a face à elle un empire central. L’empire Austro-Hongrois. Ce qui reste de la lente décomposition du Saint Empire Romain Germanique [1]. Mais qui demeurera puissant jusqu’à son agonie au début du XX° siècle avec la première Guerre mondiale.
De nouvelles poussées se manifestent sur l’échiquier européen. En Prusse. En Russie. Ces menaces poussent la France et l’Empire central, au début du XVIII° siècle, à cesser leur hostilité historique et à passer alliance.
Et cette alliance va se sceller dans le mariage d’un héritière autrichienne avec un héritier français promis au trône.
Marie-Antoinette est désignée par sa mère l’impératrice Marie-Thérèse comme l’objet de cette transaction diplomatique. Le Dauphin de France, le futur époux, deviendra le roi Louis XVI.
Un mariage à l’étiquette hautement contrôlée
Le protocole du mariage doit répondre à une multitude de contraintes pour sauvegarder l’égalité en dignité des deux puissances qui s’allient. D’où une étiquette d’une complexité qui n’a d’égale que sa somptuosité. Les deux pays, aux finances lourdement affaiblies, ne lésinent pas sur le luxe des fêtes qui vont consacrer cette union.
Marie-Antoinette a quinze ans
Elle est encore une enfant. Son mari, le Dauphin, futur Louis XVI, également [2]. Il a un an de plus. Et une humeur contrariée par une impuissance sexuelle qu’il mettra sept ans à dépasser. Marie-Antoinette, vivra ces sept années à Versailles sans avoir consommé son mariage.
Versailles. Ce palais, œuvre de Louis XIV, le Roi soleil. En une formule, Zweig trace le bilan de ce roi. (p 51) « Autocrate résolu, homme de pouvoir, (Louis XIV) avait su impose son désir de centralisation à un pays divisé. Les mœurs à la société. L’étiquette à la cour. L’unité à la religion. La pureté à la langue. »
Quand Marie-Antoinette arrive à la Cour, Louis XV[3] est le roi régnant C’est l’arrière-petit-fils de Louis XIV. Le grand palais de Versailles ne connait plus la vie que lui avait insufflé son créateur.
Le roi Louis XV dans la débauche
La vie à Versailles se déploie dans la médiocrité des conflits de cour. Entre intrigues et basses manœuvres. Une opposition farouche va opposer la Dauphine Marie-Antoinette à la maitresse du roi, la comtesse du Barry.
Marie-Antoinette prend de l’assurance, y compris face au roi. Depuis Vienne, sa mère l’impératrice, veille. Elle s’inquiète et cherche à canaliser l’énergie de sa fille.
« Le Roi est mort, vive le Roi »
Louis XV meurt de la petite vérole en 1774. Les luttes se déchainent à la cour. Chacun pour conserver ses privilèges. Marie-Antoinette et devenue Reine. Avec son mari devenu Roi, ils prennent le dessus. Ils sont accueillis avec une immense joie par le peuple de Paris. La reine se sent encore plus confiante.
Elle et son mari vivent dans des mondes séparés, mais trouvent le moyen de s’entendre. Lui est décrit comme timide, balourd, préférant la chasse et la forgerie à toute autre activité. Elle, tout au contraire, aime les sorties le soir. Va à l’Opéra à Paris. S’amuse. Elle a tout juste 20 ans. Et ne s’intéresse qu’à elle-même et à ses plaisirs. Aucune réflexion sérieuse, aucune lecture…

Au grand désespoir de sa mère. Cette dernière assume, dans la difficulté, la direction d’un empire fragile des disparités de sa composition. Et des ambitions de ses voisins, Prusse et Russie.
A Versailles, ni Louis XVI ni Marie-Antoinette ne sont prêts à affronter les séismes que la société française prépare, en son plus profond.
La Reine du rococo : une frivolité ruineuse
Un chapitre de la biographie décrit la journée de la Reine.
- D’abord, choisir sa tenue. Parmi une immense garde-robe, qu’elle augmente régulièrement par ses achats auprès d’une habilleuse habile. Celle-ci sait monnayer ses services en faisant miroiter tissus, dentelles, coupes, couleurs… Des tenues différentes pour chaque moment de la journée, bien sûr.
- Ensuite, choisir sa coiffure. C’est un débauche de créativité, avec des constructions qui s’élèvent de plus en plus haut sur la tête. Au point qu’on relève les linteaux des portes pour permettre le passage de ces délires de décors en architecture, en fleurs, en fruits, en bateaux… que le coiffeur de la Reine compose.
Et cette mode que l’impératrice d’Autriche, la mère de Marie-Antoinette juge ridicule, s’étend aux autres femmes de la cour. Jusqu’au jour où le coiffeur change de proposition. Ce sont désormais les plumes d’autruche qu’il convient de porter ! Ce sera alors d’autres constructions à faire tenir sur ces têtes aristocrates bien légères !
- Vient ensuite le temps de choisir ses parures de bijoux. Là, rien n’est assez beau. Ni assez cher pour la souveraine qui achète à tour de bras et à grands frais de nouveaux apparats.
- Il faut ensuite penser à se divertir. Mais quoi faire ? Balades à cheval. En âne, c’est plus amusant. Jeux de cartes. Puis jeux d’argent. Enfin, le plus amusant est certainement les moments masqués où la Reine peut s’affranchir d’une partie de l’étiquette. Et les sorties nocturnes à Paris, dans les concerts, les opéras, les fêtes…
Un petit monde futile de jeunes tourne autour de la Reine
Une Reine qui sait si bien se faire aimer en distribuant pensions, terres, titres. La reine s’amuse, mais c’est la reine. Par-dessus son frugal de mari, elle a le pouvoir de répandre les fonds de l’Etat sans compter. On s’amuse… et on fait fructifier ses revenus au contact de cette belle jeune femme qui aime tant s’amuser… Et qui a tant de moyens dans sa main.
S’éloigner de l’étiquette pesante de Versailles : le petit Trianon
Elle demande et obtient de son mari le petit palais du Trianon. A quelques pas du lourd palais de Versailles « aux mille fenêtres ». Là, dans ce refuge, se déploie la petite cour de ses amusements. Le roi ne vient presque jamais dans ce lieu. Lourd et complexé, il n’a aucune envie de rivaliser avec les jeunes amuseurs de sa femme.
Celle-ci incarne ses rêves de plaisirs dans le jardin et la campagne miniature qu’elle reconstitue autour du Trianon. Fini les jardins à la Française, avec leur composition symétrique, solennelle et rigide. Jean-Jacques Rousseau a popularisé les jardins naturels. Là où la nature est reconstituée à grands frais de « naturel » reconstruit.
Petites fermes reconstituées. Champs cultivés. Potagers soigneusement travaillés. Moutons et vaches dans les champs… Et des paysans pour animer ce décor. Cette « comédie champêtre ». Pendant que dans le pays, la misère frappe durement les paysans, écrasés par l’impôt.
Tout ce décor est facturé au prix fort sur des billets que Marie-Antoinette signe sans hésitation. « A payer » par le Trésor du royaume. Sans compter ! Ces folies vont accroitre la ruine du pays. Elles pèseront lourd lors de son procès quand le vent de la Révolution va venir décoiffer ces belles têtes insouciantes.
Isolée dans ses rêves artificiels
Marie-Antoinette au centre de son monde de frivolité, s’est coupée de la cour. Des grandes familles établies qui structurent par le haut la société française. Mais une cour qui se morfond. Dans Versailles, devenu un palais sans vie. Avec un roi sans ambition ni présence.
La reine s’est coupée de la cour comme elle s’est coupée du peuple de France. Celui-ci ne l’intéresse que quand il crie son admiration le long des routes qu’emprunte son carrosse quand elle va à Paris de jour.
Dans tout ce gâchis, la reine est toujours « imaculée » !
Son frère, Joseph II, vient à Versailles
Il vient pour resserrer les liens entre la maison Habsbourg et la maison de France. Et cela passe par la résolution de l’impuissance du Roi. Voilà ce qui occupait essentiellement les dirigeants royaux d’Europe. Alliances matrimoniales et « production d’héritiers » du trône ! En vue de constitution de coalitions d’Etats pour des guerres et conquêtes. D’abord en Europe. Vont s’ajouter les motifs de guerre pour l’extension de ce qui vont constituer les possessions outremer, avec la formation des grands empires coloniaux.
Voilà de quoi était constitué la « politique » à cette époque
Joseph II, qui attend la fin du règne de sa mère pour accéder au trône, vient en service commandé. Par l’impératrice, sa mère. Il a pour mission de convaincre Louis XVI de soigner, par une opération légère, son impuissance. Il y réussit.
Quelques semaines après son départ, le roi honore, enfin, son rôle de mari. La reine a attendu sept ans ce moment ! L’impératrice, informée au jour le jour de la vie à Versailles, est soulagée.
Marie-Antoinette est heureuse de ce changement
Elle en connait l’enjeu. Produire un héritier pour le trône n’a pas que des conséquences diplomatiques. C’est aussi son statut de Reine qu’elle va pouvoir assoir et consolider à la Cour. Rapidement, elle est enceinte. Grande joie à la Cour. Mais aussi dans le pays.
En public….
Dans la chambre où ont pris place les principaux dignitaires de l’aristocratie, la Reine accouche. Ces personnes qui se pressent dans la pièce sont là pour attester, pour témoigner !
Mais… c’est une fille ! On se met quand même en joie. Ce sera 21 coups de canon. Seulement. Car si cela avait été un garçon, on aurait eu droit à 101 coups de canon. On peut mesurer sur ces chiffres l’importance relative d’un héritier à l’aune d’une héritière. Cinq fois mieux.
La population est associée à l’exploit
Des fêtes sont organisées dans tout le royaume. De fontaines publiques, coule du vin. On distribue du pain et de la charcuterie aux pauvres. Les corporations viennent à Versailles honorer le nouveau-né… Les cloches sonnent dans tout le royaume…
A Vienne, Marie-Thérèse la grand-mère impératrice meurt. Nous sommes en 1780. Elle n’aura pas vécu pour voir arriver l’héritier mâle si désiré.
Peu de temps après, la Reine est de nouveau enceinte
Fausse couche. Puis de nouveau son ventre grossit. Et c’est un garçon ! Enfin, un Dauphin est né ! Les festivités sont organisées dans leur plénitude. Dans tout le pays.
Mais rapidement, Marie-Antoinette revient à ses frivolités. A ses jeux à Trianon avec sa petite cour. Tandis qu’à Versailles, le roi taciturne règne sur une aristocratie qui a compris que le véritable pouvoir lui échappe. C’est la reine qui nomme les ministres. Attribut les titres, les pensions. Sans aucune connaissance des réalités du pays, de la noblesse, du peuple. Un seul mot au roi suffit.
Une faisceau de cabales se constitue
Il y a d’abord les « anciens ». Ceux qui voient la dérive joyeuse s’autonomiser par rapport aux grandes familles aristocratiques sous l’impulsion de « l’Autrichienne ». « L’atelier des calomnies » fonctionne à plein régime.
Il y a aussi, et c’est plus grave, les nouvelles couches sociales qui ont connaissance des idées nouvelles qui circulent. Jean-Jacques Rousseau et son regard nouveau sur la nature. Sur les droits et les privilèges. Diderot et son Encyclopédie. Voltaire, la liberté de conscience… Il y a enfin le frère cadet du Roi, le comte de Provence qui deviendra Louis XVIII bien longtemps après, qui attend son heure pour s’assoir sur le trône. Et ne ménage ni la reine, ni, sournoisement, le roi.
En Angleterre, et plus encore en Amérique, d’autres façons de gouverner attirent l’attention.
Des libelles commencent à circuler. De plus en plus nombreux. De plus en plus virulents contre la reine. Celle-ci se passionne pour le théâtre de Beaumarchais. Elle prend un rôle dans une de ses pièces. Sans s’alarmer de son caractère subtilement subversif. Et surtout, sur l’interdiction que son mari le roi avait lancé contre la représentation de la pièce !
Pour l’instant, le roi est épargné. Mais on connait sa faiblesse.
Insouciance
Marie-Antoinette demeure insouciante. Elle reste dans son orgueil habsbourgeois et sa désinvolture. Dans sa bulle d’absolutisme. Face aux libelles insolents à son égard, elle n’imagine en aucun cas que ces égratignures sur le papier peuvent avoir des conséquences sur le pouvoir royal séculaire.
Un pouvoir qu’elle imagine total, incontestable puisque fondé sur une légitimité religieuse. Donc, hors de portée des êtres humains ! Pendant ce temps, elle continue activement à vider les caisses de l’Etat.
Pour l’instant, c’est dans la noblesse de cour, dans les nouvelles couches bourgeoises, que s’accumulent les griefs.
Les libelles se font de plus en plus audacieux, de plus en plus précis. La reine concentre le plus fort des attaques dans son intimité. (p 211) « Ses amies Lamballe et Polignac seront clouées au pilori pour être des maitresses dans l’art des pratiques lesbiennes. Marie-Antoinette sera qualifiée d’érotomane perverse et insatiable. Le roi de pauvre cocu. Le Dauphin de bâtard. En témoigne ce petit quatrain qui volait alors de lèvres en lèvres :
Louis, si tu veux voir
Bâtard, cocu, putain,
Regarde ton miroir,
La reine et le Dauphin.
En 1785, le concert de calomnies bat déjà son plein…»
Marie-Antoinette, souriante et légère, reste aveugle sur le danger qui monte dans le pays. Nous ne sommes que 4 ans avant la prise de la Bastille !!
Survient l’affaire du collier
L’aveuglement frivole et vorace de la Reine a favorisé le montage d’une machination financière qui la rend débitrice de l’achat d’un collier de somptueux diamants qu’elle ne verra jamais [4]. Le Cardinal de Rohan est un haut dignitaire de l’église et membre d’une des grandes familles aristocratiques. Par orgueil, il va faire preuve d’une naïveté coupable. C’est lui qui est pris dans cette manigance, aveuglé par son désir de reconnaissance de la Reine. Celle-ci a reporté sur cet homme la détestation que lui voue l’impératrice Marie-Thérèse du temps ou de Rohan était ambassadeur de France à Vienne. Des faux ont été établis à la signature de la Reine.
Une fois le scandale éclaté, celle-ci se montre intraitable. Mais sans analyser et comprendre l’étendue et la complexité de l’intrigue. Elle va faire prendre au roi des décisions hâtives qui vont embrouiller encore plus cette sombre affaire. Et diminuer encore le crédit moral de la famille royale. De la royauté, en fait.
Une escroquerie qui tient au mythe du crédit royal
C’est une femme, autoproclamée Comtesse de la Motte, qui a conçu tout l’édifice aussi intelligent que crapuleux. Une montagne de mensonges qui tient sur la croyance en la parole de la Reine. Une parole usurpée. Avec le paradoxe d’une « parole » émanant d’une personne dont on connait l’inconsistance. La faible loyauté vis-à-vis du roi son mari. Son mépris tranquille vis-à-vis de ses créanciers que ses dépenses inconsidérées multiplient…
Le procès qui s’ouvre devant le Parlement ajoute un chapitre supplémentaire à cette funeste mascarade. Quoi que l’on fasse, c’est le procès de la reine qui est fait, même si elle n’a pas été directement complice de la machination.
C’est tout son style de vie, fait de dépenses somptueuses pour le plaisir de Madame, que vient couronner, si l’on peut dire, cette triste affaire du collier.
Cette fois, ce n’est plus seulement la grande noblesse et le haut clergé qui sont spectateurs du désastre. Le peuple de Paris est témoin. Par milliers, dans les rues autour du Palais de Justice, il participe au procès. Au supplice au fer rouge de la pseudo Comtesse de la Motte. A son évasion de la Salpêtrière. A ses publications vengeresses depuis Londres où elle s’est réfugiée. Elle devient la victime et Marie-Antoinette la coupable. Son suicide en 1791 évitera à la République d’en faire une héroïne.
Le roi assiste, impuissant, à cette mascarade de procès qui porte pourtant un élément de vérité. Le Parlement, depuis longtemps méprisé par le pouvoir, se venge. Son acquittement du Cardinal de Rohan en 1786 vaut condamnation morale de la reine.
La royauté a tout perdu dans cette affaire. Alors que l’immense majorité de la population, rurale, se débat dans la misère voire la faim, on trouve en Marie-Antoinette le parfait bouc émissaire. On l’appelle « Madame déficit ». Et la Révolution qui va éclater dans quelques mois va se mener avec en mémoire cette déchéance.
La question de la dette reste de plus en plus présente
Il y a d’un côté les dépenses inconsidérées de la reine. Mais surtout, le maintien d’un système où seuls ceux qui travaillent paient l’impôt. Le clergé et la noblesse en sont totalement exonérés. Et considèrent cela comme faisant partie de l’ordre des choses.
C’est cet « ordre des choses » qui va bouger sous les coups de boutoir du peuple. La Révolution va bouleverser cet ordre. En faisant avancer l’idée, le principe d’égalité. A l’extrême opposé du principe monarchique de droit divin et de son absolutisme.
Les officiers qui ont combattu en Amérique aux cotés de La Fayette reviennent émerveillés. (P 276) « Les volontaires et les soldats revenus de la guerre d’Amérique vont vanter jusque dans les village les plus reculés un pays démocratique. Où il n’y a ni cour, ni roi, ni noblesse. Rien que des citoyens et encore des citoyens. Et où règnent l’égalité et la liberté. »
[JOA] On remarque, dans cette citation, que Stefan Zweig ignore totalement une partie de la population américaine. Une partie qui n’est en rien « citoyenne ». Les populations premières sont totalement effacées de cette pensée. De même les esclaves noirs qui ont commencé à peupler les exploitations agricoles du Sud des Etats Unis. Ce trait forme une constante de la pensée occidentale. Y compris progressiste, comme on peut classer celle qui anime Zweig. Voir sur ce point : « L’angle mort depenseurs du Nord sur le Sud » ==> ICI
Marie-Antoinette cherche à s’amender
Elle perçoit directement le désamour du peuple. Qui s’ajoute au rejet de la haute noblesse et du clergé qu’elle a toujours repoussés. Elle semble avoir compris la gravité de la situation. Et amende son train de vie. Se consacre à ses enfants, de santé fragile. Elle aspire au calme. Ses « amis » la quittent, maintenant qu’elle ne distribue plus rentes et titres.
Devant la gravité de la situation financière, le roi convoque les Etats Généraux
Mai 1789, s’ouvrent, à Versailles, en grand apparat, les Etats Généraux. (P 285) « (…) pour la première fois, Versailles n’est plus seulement la résidence d’un roi. Mais la capitale, le cerveau, le cœur et l’âme de tout le royaume de France. »
Le roi y est fêté par l’ensemble des députés de la noblesse, du clergé et du Tiers Etat. La reine est accueillie dans un silence glacial.
Une grande ébullition agite Paris
D’innombrables brochures sont publiées. L’idée d’égalité, d’abolition des privilèges, y compris ceux de la monarchie, enflamme les débats. Elle représente un saut qu’on a peine à imaginer aujourd’hui.
Une révolution au sens géométrique du terme : on renverse l’ordre radicalement, de haut en bas, avec ce principe nouveau. Dans la confusion, mais aussi dans une remarquable qualité intellectuelle. Les écrits de Voltaire, Diderot et Rousseau ont été lus, réfléchis, discutés. Un cadre conceptuel se forme qui donnera lieu à des droits consignés par des lois.
Alors que les courtisans autour de la Reine s’éloignent, un homme apparait
C’est Axel de Fersen, de la noblesse suédoise. Il est depuis longtemps l’ami de Marie-Antoinette, par-dessus les agitations de la petite cour qui s’active autour de la Dauphine puis de la Reine. C’est elle, dans son agitation de jeune Dauphine, qui se serait approchée de lui lors d’une nuit de fête masquée à Paris.
Stefan Zweig nous décrit un amour profond, véritable, qui va lier jusqu’à la mort ces deux êtres. Une fidélité qui s’étend delà plaisirs et prébendes de la vie de Marie-Antoinette. Une femme non honorée sept ans durant, par son « mari » Dauphin puis Roi.
Surtout, par-delà le terrible poids des conventions, puisqu’il s’agit d’un point des plus important du concept dynastique. La transmission du pouvoir par le sang. La capacité de la lignée royale à « produire » un descendant authentique. Incontestable. Un héritier qui, par-delà les aléas biologiques, va symboliser la continuité du pouvoir. Un pouvoir absolu et d’essence divine. On voit là que la légitimité religieuse pèse moins que la légitimité biologique.
Fersen et Marie-Antoinette ont-ils été amants ?
Stefan Zweig fait dans cet ouvrage œuvre de biographe de la reine. Il ne peut éviter cette question qui a pris, tout au long du XIX° siècle une importance particulière. Car ses enjeux portent sur le principe même de la « royauté de droit divin ».
Oui, ils se sont aimés. Personne ne peut le nier. Mais comment ? Cette question, Stefan Zweig la traite en enquêteur. Car elle divise nombre de ceux qui s’intéressent à cette période de l’histoire de France. Notamment les historiens. Il y a ceux qui plaident pour la « pureté » de la reine. Une reine immaculée en quelque sorte. Qui se serait réservée sans faille à la procréation des héritiers. Ceux qui défendent cette thèse, ce sont les Royalistes qui ne peuvent imaginer une autre situation.
Stefan Zweig, de son coté, cherche une vérité dans les témoignages de Napoléon, de Talleyrand. Et dans les preuves écrites de la correspondance (chiffrée) entre les deux amoureux. Une partie de ces preuves a été détruite ou brouillée. Mais le faisceau d’indices converge. C’est ce qui fonde l’opinion de Zweig.
L’auteur réponde oui
Au terme de sa recherche, Stefan Zweig nous propose une réponse positive. Marie-Antoinette et Fersen ont été amants.
Il est conduit à cette conclusion non pour accabler la femme. Tout au contraire, pour reconnaitre sa sincérité. Celle de mettre en accord son élan d’amour avec sa vie concrète. Après tout, elle a donné au royaume deux héritiers mâles. Elle a rempli sa mission de Reine. Elle prend, après ce devoir accompli, sa place de femme. Si peu honorée par son mari.
Le cours de la Révolution avance, dans le chaos, inexorablement
La population de Paris a faim. Elle manque de farine, donc de pain. Les révolutionnaires ne supportent plus que le roi soit si loin de la capitale. C’est une escouade de femmes qui va conduire la marche vers Versailles pour obtenir du pain et faire venir le roi et sa famille à Paris. Stefan Zweig marque ici sa profonde peur de la violence qui peut émaner d’une population plus ou moins manipulée par des leaders déterminés.
Avec sa belle écriture, Zweig fait une pause. Prend quelques lignes de recul. Et nous livre son impression quelques mois après le déclenchement révolutionnaire. (p 338) « Jamais, dans la France millénaire, semence n’a germé aussi vite qu’en cet été 1789. Jamais blé n’a poussé aussi dru et aussi haut. Et bien plus encore, après que les semis impatients de la Révolution se sont vus engraissé de sang. Des décennies d’abus, des siècles d’injustice sont éradiqué d’un seul trait de plume… »
La famille royale revient et s’installe dans le Palais des Tuileries. Au cœur de la capitale. C’est une défaite pour Marie-Antoinette. Le peuple acclame le roi. Moins la reine. La famille royale se retranche dans la peur au sein de cet immense palais qui n’est plus occupé depuis Louis XIV. Elle s’y installe avec la détermination de la femme courageuse et déterminée qui émerge avec le malheur qui s’abat sur elle et ses enfants.
La reine s’installe et s’engage dans la conduite de ce qui reste du royaume
Elle organise ses relations secrètes avec les autres cours d’Europe. Maitrise l’écriture cryptée. Etablit des liens avec des acteurs de la scène politique du moment. Notamment avec ce noble sulfureux, Mirabeau [5]. Un noble criblé de dettes. Il va jouer double jeu, en sollicitant des fonds de la royauté alors qu’il est un des députés les plus engagés dans la Révolution.
Mirabeau, double jeu et fin grotesque
Cette personnalité hors du commun, ce lutteur infatigable va jouer pour le Roi et contre la Révolution. (P 387) « Avec toute la fougue qui est la sienne, il se jette dans les évènements et tente, seul contre des millions, de manœuvrer à reculons la colossale roue de la Révolution qu’il avait lui mise en branle. L’époustouflante intrépidité de ce combat engagé dans deux directions opposées… » Selon Zweig, sa tactique brouillonne vise à accroitre le chaos pour provoquer un besoin d’ordre qui favorisera le retour en faveur de la royauté.
Il meurt brutalement en mars 1791. Il est porté au Panthéon solennellement. C’est le premier à y être inhumé. Deux ans plus tard, son double jeu est découvert ! Son corps est arraché à sa tombe pour être jeté à la voirie.
La fuite
Quitter Paris apparait comme la solution, alors que l’étau se resserre autour de la famille royale. Fersen s’emploie à régler la délicate opération qui doit demeurer secrète. Mais l’étiquette s’impose contre toute logique. Elle transforme une évasion discrète, légère et rapide en lourde échappée au sein d’un convoi trop chargé qui avancera avec lenteur. Il fait horriblement chaud. Nous sommes au solstice d’été, les 20 et 21 juin 1791.
On reconnait le roi. Retour à Paris
C’est une humiliation supplémentaire pour Marie-Antoinette. De plus, elle sent la menace du peuple sur elle et sa famille. Non seulement du peuple de Paris. Mais aussi du peuple des villes et villages que le cortège traverse, escorté par une foule hétéroclite. Ce peuple de France qu’elle n’a jamais voulu connaitre.
Dans le lourd carrosse qui la porte, elle partage l’espace avec trois députés de l’Assemblé nationale qui la protègent d’éventuelles agressions.
Une étape de la Révolution est franchie
Les lignes de fracture se précisent, douloureusement. Au cœur du processus de révolution au sens propre du terme. (P 439) « Jusque-là, jusqu’au 21 juin 1791, l’Assemblée nationale était unanimement royaliste. Parce que composée exclusivement de nobles et de bourgeois. Mais, en vue des élections à venir, derrière le tiers état bourgeois, se profile déjà un quatrième état, le prolétariat. L’imposante masse sauvage et tapageuse qui effraie autant la bourgeoisie que celle-ci effrayait le roi. »
Des fractions croissante de la société commence à envisager, à oser envisager, une solution sans le roi. Sans la royauté. Le « quatrième état » évoqué par Zweig pousse fortement dans ce sens. Avec Marat, Hébert.
Cette évolution constitue un pas immense dans la formation progressive de la conscience républicaine. Qui mettra un siècle, tout le XIX°, à se former et se consolider, au prix de luttes incessantes.
Divisions au sein de la noblesse
Face à un tel bouleversement, il n’y a pas que le camp de la Révolution qui hésite et cherche une voie. Le camp de la royauté est profondément divisé. D’abord par les frères du roi qui espèrent accéder au trône si Louis XVI disparait. En poussant pour un affrontement guerrier contre la France.
Ensuite par les princes et rois d’Europe qui sont horrifiés par la remise en cause du principe même du pouvoir royal de droit divin. Mais qui, pour autant, cherchent tirer parti de la situation pour augmenter leur pouvoir et même leur territoire, par des annexions.
Les nobles de France, émigrés à Coblence ou Bruxelles, vont-ils entrainer les cours d’Europe dans une guerre de reconquête contre la Révolution ? L’idée de nation n’est pas encore installée dans les imaginaires des aristocrates comme dans ceux des sociétés. On reste dans des logiques dynastiques. Où des alliances matrimoniales décident des alliances militaires. Par-dessus les peuples.
Marie-Antoinette souhaite une guerre de la coalition contre la République. Et elle souhaite la défaite des armées françaises. Clairement. C’est, pour elle, la seule solution pour que soit rétabli la royauté de droit divin. Que soit restauré son statut. Et que soit assuré sa propre sécurité. Pour elle, pour son fils le Dauphin et le roi. Elle écrit (p 447) « Et tout état de cause, les puissances étrangères peuvent seules nous sauver. »
La situation politique est confuse
Louis XVI a accepté la Constitution qui constitutionnalise la royauté. Mais les ambiguïtés ne sont pas levées. (P 463) « En acceptant la Constituions, Louis XVI a rabaissé le statut de la royauté tout en la maintenant. » Pour les royalistes, la Révolution allait prendre fin avec ce texte. Mais chacun sent que rien n’est clair. Et anticipe une issue plus tranchée. La guerre des émigrés et princes d’Europe apparait comme un moyen de clarifier la question. Mais, Marie-Antoinette (et le roi) se trouve devant une impasse. (P 464) « (…) si la France est victorieuse, ils [la famille royale] perdront le trône. Et si les puissances extérieurs sont victorieuses, ils perdront la vie. »
La guerre
Du côté de la Révolution, les Girondins, qui dominent l’Assemblée nationale poussent à la guerre. Alors que se préparent les hostilités, Marie-Antoinette transmet à l’ambassadeur d’Autriche ce qu’elle sait des préparatifs militaires de l’armée française !
Dans la pensée d’aujourd’hui, c’est une haute trahison. Pour Marie-Antoinette, c’est une façon de restaurer ce qui compte le plus : le maintien de la souveraineté royale. S’affrontent d’un côté la liberté, avec l’armée française. De l‘autre la souveraineté de la cause despotique. Le maintien d’un pouvoir de droit divin. Cette trahison lui sera reprochée lors de son procès.
La journée du 10 aout 1792
La population investit les Tuileries, pourtant défendus par la garde suisse. Le roi, comme à son habitude, n’a rien su décider. Défendre le palais ? Ne pas le défendre ? Le palais est pris d’assaut.
C’est une lourde défaite pour le roi, une marche vers l’abîme. Selon Zweig, Marie-Antoinette a assisté, impuissante dans sa rage, à cet effondrement.
Le couple royal, vaincu, est transféré au Temple. Il est de fait en état d’arrestation. Et est mis sous la responsabilité de la Commune de Paris. L’institution qui rassemble une bonne partie des éléments les plus radicaux de la Révolution.
Dehors, les forces anti-révolutionnaires s’agitent
Les Prussiens et les Autrichiens ont fait mouvement vers Paris. La Vendée se soulève. La peur et le spectre de la trahison envahissent l’espace. Danton vote pour l’instauration de la Terreur. Début septembre 1792, il fait massacrer les suspects emprisonnés. On compte deux mille victimes.
Le 21 septembre 1792, la Convention abolit la royauté
Les députés viennent au Temple informer le roi de sa destitution. Il n’est plus que « Louis Capet ». Mais l’élan de la Révolution pousse à aller plus loin. Juger le roi. Et « juger le roi », c’est le condamner à mort. (P 511) « (…) l’édifice de la République ne peut être consolidé que s’il est cimenté avec du sang royal. » Le procès commence en décembre. Le roi est isolé dans sa prison.
Marie-Antoinette sans information, car tout contact avec l’extérieur lui est interdit, ne va voir le roi que pour lui dire adieu la veille de son exécution, le 21 janvier 1793. L’archiduchesse d’Autriche, reine de France, devient désormais « la veuve Capet ».
Marie Antoinette est désormais seule
Pendant un temps, les dirigeants révolutionnaires à Paris espèrent l’utiliser comme monnaie d’échange avec l’Autriche. Pour éviter une agression militaire. Mais le jeune empereur des Habsbourg qui vient d’accéder au trône après la mort de Joseph II d’Autriche, frère de Marie-Antoinette, n’a aucunement l’intention de s’engager vraiment pour sauver sa tante, pourtant Habsbourg comme lui.
Enfermée au Temple, elle tente deux évasions, avec l’appui de fidèles qui parviennent à corrompre les geôliers. Mais les tentatives échouent.
La pression sur Marie-Antoinette augmente. On la sépare de ses enfants. Puis, on la transfère à la Conciergerie. C’est signifier à toute l’Europe qu’elle est désormais menacée de mort. (p 545) « Ce transfert à la Conciergerie, véritable provocation, est d’abord censé donner un coup de fouet à cette Autriche, trop lente à agir. » Mais c’est sans beaucoup d’effets sur les rois et princes du vieux continent.
A la Conciergerie, les conditions de détention pour Marie-Antoinette sont encore plus sévères. Son isolement s’accroit. Elle est impliquée pourtant dans une tentative (illusoire) d’évasion. Ce qui a pour conséquence d’accroitre encore la dureté de ses conditions d’incarcération.
L’émotion du biographe
Dans son écriture, Stefan Zweig est pris d’une immense émotion pour cette femme qui s’approche de la mort, après avoir été isolée de tout son monde. Il décrit avec beaucoup d’emphase l’immense pouvoir de séduction de celle qui n’est plus reine. Séduction auprès de ses gardiens et gardiennes. Des gendarmes qui ont la charge de la surveiller en permanence…
Pour les personnes qui sont autour d’elle, ce n’est pas seulement de la séduction. Car Marie-Antoinette incarne, par-delà de sa personne, un pouvoir d’essence divine. Être responsable de la « reine » ainsi réduite relève d’un immense impensé pour le personnel d’origine populaire qui en a la charge.
Mais cette émotion, Zweig y succombe à mesure qu’approche la fin de celle qui fut reine. Il s’insinue dans ses pensées les plus intimes. Il décrit les derniers instants de son incarcération : elle s’habille avant de monter dans la charrette fatale. (p 610) « (…) ce dernier parcours la trouvera donc proprement et décemment vêtue. Mais ce n’est plus du tout la vanité féminine qui la guide[6]. Plutôt l’envie d’être pleinement digne de cette heure historique. » Cela pourrait être une déduction de l’auteur. Mais pas une affirmation assénée avec un tel aplomb.
Les sources
Dans la postface à sa biographie, Zweig s’étend sur la question des sources de son récit. Il explique qu’il a très peu puisé dans les sources écrites, notamment les prétendues lettres que Marie-Antoinette aurait rédigées. On sait maintenant que la majorité d’entre elles a été écrite par un habile faussaire qui en faisait commerce.
De même les témoignages oraux de ceux qui ont approché la reine dans ses temps d’incarcération. Ils ont fait l’objet d’un tel intérêt que des centaines de « témoignages » ont émergé. Laissant planer un grand doute sur l’authenticité de la majorité d’entre eux.
Avec ces précaution de biographe, émises par Stefan Zweig lui-même, on se demande comment il a pu approcher la reine de si près pour délivrer des lignes qui font preuve d’une totale empathie avec elle. Surtout dans ses derniers instants.
Les élans de l’auteur font penser à un texte en béatification de Marie-Antoinette. Cette dérive, sur le fin du texte, limite la rigueur historique de cet immense travail mené tout au long du texte. Une biographie qui reste d’un grand intérêt pour qui veut comprendre, au-delà du cours historique de la Révolution, les bouleversements qui ont agité la société française en y créant des lignes de fractures profondes. Des fractures encore à l’œuvre au début du XXI° siècle. Pêché véniel, face à l’immense talent dont Zweig a fait preuve, comme écrivain, comme historien, comme psychologue.
L’accusation
Zweig juge étrange que l’instruction du procès tarde à se mettre en route. Fouquier-Tinville, le grand accusateur de la Révolution, ne se presse pas. C’est alors que surgit une terrible accusation : l’inceste. Marie-Antoinette aurait eu des pratiques prohibées avec son fils ! Selon les propres déclarations du Dauphin, âgé de 9 ans[7].
Cette accusation ne sera pas, heureusement, retenue contre elle. C’est bien de complicité avec les puissances étrangères et intérieures qui veulent liquider la Révolution et restaurer la Royauté qu’elle est accusée.
Zweig écrit que l’accusation est fondée. Mais sans preuve matérielle. Marie-Antoinette n’a conservé aucun courrier. Et les archives à Vienne, qui prouvent le crime de haute trahison, ne sont pas accessibles pour ce procès. Ainsi, on se trouve devant un procès où la dimension politique l’emporte sur le droit. Mais, compte tenu de la personne en question. Compte tenu de la situation de grand péril que vit la France à cette période, pouvait-il en être autrement ? L’urgence politique a bousculé le droit. C’est une situation dangereuse car porteuse de toutes les dérives !
Le dernier voyage
Marie-Antoinette est conduite en charrette de la Conciergerie à la Place où est dressée la guillotine. L’actuelle Place de la Concorde.

Elle fait ce chemin qu’emprunteront peu de temps après Madame Rolland, Danton qui a déclenché la Terreur et ne parvient pas à en arrêter le cours, Fouquier-Tinville son accusateur, Hébert qui n’a cessé de colporter sur elle les pires infamies… Puis bien d’autres encore. Jusqu’à Robespierre.
Sur le trajet, le peintre Jacques-Louis David. Lui qui a peint Marat assassiné dans sa baignoire. Et qui fera dans quelques années le tableau du couronnement de Napoléon. Ce jour du 16 octobre 1793, il fera d’elle un rapide croquis qui deviendra célèbre.
Henri Sanson, le bourreau attitré, fait son travail.
PHOTO DE LA GUILLOTINE DU JARDIN DES TUILLERIES
Photo prise au Jardin des Tuileries. Une évocation discrète et macabre de la guillotine !
Stefan Zweig laisse transparaitre son immense admiration pour la reine
Marie-Antoinette n’est plus l’insouciante et légère femme qui passe sa vie dans les fêtes et les futilités, aux frais du Royaume. Elle a pris conscience de la gravité de la situation. Surtout, elle sait qu’elle ne peut compter sur le roi, son mari. Toujours indécis dans les épisodes violents de la Révolution qui exigerait autorité et fermeté.
Zweig se laisse prendre par l’émotion devant les efforts surhumains de cette femme qui tente le tout pour le tout pour sauver son statut de reine. Et, finalement, sa vie.
Il laisse transparaitre sa peur de la « populace ». Il redoute les réactions violentes et incontrôlées du peuple des faubourgs. Les « sans-culottes ». Ceux-là même qui ont été à la pointe des mouvements les plus décisifs de la Révolution. Sans lequel aucune étape dans la marche de la Révolution n’aurait été franchie.
On imagine la difficulté pour un biographe de garder sa distance vis-à-vis de son sujet, tout au long d’un si important travail qui va se dérouler sur plus de 600 pages de texte. Il comprend profondément, au travers de son texte, l’impossible rôle que la révolution a laissé à la reine. Il est en empathie totale avec elle.
& & &
Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne en Autriche Hongrie et mort en 1942, au plus sombre de la guerre, à Petrópolis au Brésil, est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien.
Ami de Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Romain Rolland, Richard Strauss, Émile Verhaeren, Stefan Zweig a fait partie de l’intelligentsia viennoise. Il quitte son pays natal en 1934, en raison de la montée du nazisme et de ses origines juives, pour se réfugier à Londres, puis au Brésil où il se suicidera avec sa femme Lotte. Son œuvre est constituée essentiellement de biographies (Joseph Fouché, Marie-Antoinette, Marie Stuart, Magellan…), mais aussi de romans et de nouvelles (Amok, La Pitié dangereuse, La Confusion des sentiments, Le Joueur d’échecs). Dans son livre testament, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Zweig se fait chroniqueur de l’« âge d’or » de l’Europe et analyse ce qu’il considère comme l’échec d’une civilisation. D’après Wikipédia. Pour en savoir plus sur l’auteur, voir ==> ICI
On trouvera sur ce sites d’autres notes de lecture sur des ouvrages de Stefan Zweig. Par exemple, sur la biographie de « Magellan » voir ==> ICI
[1] Le Saint-Empire romain germanique, est un État d’Europe ayant existé de 962 à 1806. Cet État, issu de la décomposition de l’Empire carolingien, a joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe au Moyen Âge, notamment du fait du conflit entre les empereurs et les papes. Sa disparition aboutit à l’établissement de l’empire d’Autriche (empire d’Autriche-Hongrie à partir de 1867) et de l’Empire allemand (1871).
Né à la même époque que le royaume de France capétien (987), l’Empire connaît une évolution très différente en ce qui concerne le pouvoir du souverain. Les rois de France parviennent, au bout de plusieurs siècles, à créer un État centralisé en luttant sans cesse contre les droits et pouvoirs des princes féodaux. Dans l’Empire, plusieurs centaines d’entités restent souveraines au XVIe siècle, dont certaines minuscules (par exemple la principauté d’Orange). Les victoires de Napoléon en 1805 et la création de la confédération du Rhin en 1806 démontrent l’impuissance de l’institution impériale, qui disparaît le 6 août 1806 lorsque François II dépose la couronne impériale, ne gardant que son titre d’empereur d’Autriche. D’après Wikipédia. Pour en savoir plus sur l’histoire complexe de cette entité impériale, voir==> ICI
[2] Louis XVI, né en 1754 à Versailles, est roi de France et de Navarre du 10 mai 1774 au 13 septembre 1791, puis roi des Français jusqu’au 21 septembre 1792. Alors appelé civilement Louis Capet, il meurt guillotiné le 21 janvier 1793 à Paris.
Fils du dauphin Louis de France et de Marie-Josèphe de Saxe, il devient dauphin à la mort de son père. Marié en 1770 à Marie-Antoinette d’Autriche, il monte sur le trône en 1774, à dix-neuf ans, à la mort de son grand-père Louis XV.
Héritant d’un royaume au bord de la banqueroute, il lance plusieurs réformes financières, notamment portées par les ministres Turgot, Calonne et Necker, comme le projet d’un impôt direct égalitaire. Mais ces réformes échouent toutes face au blocage du clergé, de la noblesse et de la cour. Il fait évoluer le droit des personnes (abolition de la torture, du servage, etc.) et remporte une grande victoire militaire face à l’Angleterre, à travers son soutien actif aux indépendantistes américains. Mais l’intervention française en Amérique achève de ruiner le royaume.
Louis XVI est principalement connu pour son rôle dans la Révolution française. Celle-ci commence en 1789 après la convocation des Etats généraux pour refinancer l’État. Les députés du Tiers, qui revendiquent le soutien du peuple, se proclament « Assemblée nationale » et mettent de facto un terme à la monarchie absolue de droit divin. Dans un premier temps, Louis XVI semble accepter de devenir un monarque constitutionnel. Mais avant la promulgation de la Constitution de 1791 qui fait de lui le dernier roi de France de la période dite de l’Ancien Régime, la famille royale quitte la capitale et se voit arrêtée à Varennes. L’échec de cette fuite a un retentissement important dans l’opinion publique, jusque-là peu hostile au souverain, et marque une fracture entre conventionnels.
Devenu roi constitutionnel, Louis XVI nomme et gouverne avec plusieurs ministères. Il contribue activement au déclenchement d’une guerre entre les monarchies absolues et les révolutionnaires, en avril 1792. La progression des armées étrangères et monarchistes vers Paris provoque, lors de la journée du 10 août 1792, son renversement par les sections républicaines, puis l’abolition de la monarchie le mois suivant. Emprisonné puis jugé coupable d’intelligence avec l’ennemi, celui qui est appelé par les révolutionnaires « Louis Capet » est condamné à mort et guillotiné sur la place de la Révolution à Paris le 21 janvier 1793. La reine et la sœur du roi Élisabeth connaissent le même sort quelques mois plus tard.
Néanmoins, la royauté ne disparaît pas avec lui : après s’être exilés, ses deux frères cadets règnent sur la France sous les noms de Louis XVIII et Charles X, entre 1814 et 1830. Le fils de Louis XVI, emprisonné à la prison du Temple, avait été reconnu roi de France sous le nom de « Louis XVII » par les monarchistes. Avant de mourir dans sa geôle en 1795, sans avoir jamais régné. D’après Wikipédia. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[3] Louis XV, dit « le Bien-Aimé », est né en 1710 à Versailles et mort en 1774 dans la même ville. C’est le roi de France et de Navarre. Membre de la maison de Bourbon, il règne sur le royaume de France du 1er septembre 1715 à sa mort. S’il est surnommé le « Bien-Aimé » en début de règne, l’appréciation du peuple évolue par la suite. À la fin de son règne, il reste aimé dans la plupart des régions de France mais est très impopulaire à Paris.
Orphelin à l’âge de deux ans, duc d’Anjou puis dauphin de France entre 1712 et 1715, il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l’âge de cinq ans. La régence est exercée par le duc d’Orléans. Il est sacré roi en 1722.
À partir de 1743, Louis XV gouverne seul. Seul arrière-petit-fils de Louis XIV vivant en France, marié à la fille d’un roi de Pologne détrôné, Louis XV est isolé à la tête de l’État. Intelligent mais très secret. Progressivement, l’image du souverain se désacralise et sa gestion de l’État est contestée. Sur un plan religieux et moral, n’étant pas philosophiquement un libertin, le roi se sent coupable de ses infidélités conjugales.
De plus, sur le plan diplomatique, le royaume voit sa situation s’affaiblir, ce qui entraîne un coût militaire et fiscal important. D’abord attaché à la paix, le roi doit faire face à la montée de la Prusse de Frédéric II et à celle de la Russie qui s’affirment comme des puissances européennes. Face à une Autriche qui doit lutter pour conserver sa place. Enfin, la Grande-Bretagne devient une puissance maritime et coloniale rivale de la France.
Cela vaut au royaume d’être impliqué dans deux conflits majeurs : la guerre de Succession d’Autriche qui est militairement bien conduite mais ne débouche sur aucun gain diplomatique. Et la coûteuse guerre de Sept Ans. Le royaume aide parfois la République de Gênes pour contrer les rebelles durant la Guerre d’indépendance corse. Les engagements ont lieu dans les Pays Bas, en Allemagne ou sur mer. Sur les océans, l’Angleterre déploie une flotte alors sans égale. La France connaît quelques succès militaires sur le continent européen et parvient à conquérir la Corse. En revanche, elle perd le contrôle d’une grande partie de son empire colonial (Nouvelle-France en Amérique, Indes).
Le roi doit alors faire face aux remontrances fiscales des parlements. Cette opposition et celle d’une partie de la noblesse de la cour, sa relation avec Madame de Pompadour, puis l’hostilité du nouveau dauphin envers sa dernière maîtresse Madame du Barry, sa difficulté à se faire valoir à une époque où l’opinion publique (essentiellement alors parisienne) commence à compter, ses hésitations entre fermeté et laisser-faire, qui donnent lieu à des changements de stratégie brusques finissent par le rendre très impopulaire. Sa mort provoque des festivités dans Paris, comme il y en avait eu à la mort de Louis XIV.
Sous une apparente stabilité, son règne est celui d’une mutation silencieuse. Les arts sont florissants, notamment la peinture, la sculpture, la musique et les arts décoratifs. L’architecture française atteint un de ses sommets. Tandis que les arts décoratifs (meubles, sculptures, céramiques, tapisserie, etc.) appréciés, tant en France que dans les Cours européennes, connaissent une forte expansion. Mais, c’est surtout en philosophie et en politique que les mutations des Lumières s’affirment et entraînent de profonds changements à partir de 1750. D’après Wikipédia. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[4] L’affaire du collier de la reine est une escroquerie qui s’est déroulée de 1784 à 1786 à la cour de France. Montée par Mme de La Motte, une noble sans fortune, elle a eu pour victime l’un des plus hauts prélats du royaume, le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. La Motte parvient à faire croire au cardinal, qui cherchait à gagner les faveurs de Marie-Antoinette, que la reine désire un collier de diamants exceptionnel de plus d’un million et demi de livres. Rohan achète le collier pour la reine et le remet à La Motte.
L’achat n’ayant pas été payé et le collier ayant disparu, le scandale éclate le 15 août 1785. Le cardinal de Rohan est le dupé plutôt que le coupable. Mais il est arrêté au château de Versailles en présence de la cour. Car le roi considère comme insultant pour la reine que le cardinal ait pu croire qu’elle le chargeait d’une opération clandestine. Louis XVI refuse d’étouffer l’affaire. Il fait embastiller Rohan et confie son jugement au Parlement de Paris.
Marie-Antoinette n’est pour rien dans cette affaire. Mais étant donné son style de vie frivole et dispendieux, l’opinion croit qu’elle y a trempé d’une manière ou d’une autre. Abusée par toute une littérature de libelles et de calomnies, l’opinion prend le parti de Rohan et vilipende Marie-Antoinette. On l’accuse d’avoir réellement commandé le collier par l’intermédiaire du cardinal. Le Parlement de Paris condamne le 31 mai 1786 Mme de La Motte au fouet, à la flétrissure (marque V au fer rouge sur la poitrine) et à la prison mais, sous la pression du clergé et de la grande noblesse, acquitte le cardinal de Rohan sans lui infliger aucun blâme. Le jugement apparaît comme un camouflet pour la reine.
L’affaire révèle la solidarité clanique de la noblesse et du clergé, capables de s’unir dans leur opposition à l’autorité royale. En jetant le discrédit sur la reine, elle aggrave la faiblesse politique de la royauté française. Les écrits haineux dirigés contre Marie-Antoinette en 1785-1786 annoncent la violence politique dont elle fera l’objet pendant la Révolution française. D’après Wikipédia.
[5] « Comte » de Mirabeau, plus communément appelé Mirabeau, né en 1749 dans le château de Bignon-Mirabeau, dans le Loiret, et mort en 1791 à Paris, est un écrivain, diplomate, journaliste et homme politique français, figure de la Révolution.
Après une jeunesse marquée par le libertinage, plusieurs années de prison, une liaison adultérine, et des pamphlets, il embrasse l’idée de réformer la société française dans son ensemble. Il est l’un des pères fondateurs de la Révolution française, partisan d’une monarchie constitutionnelle.
Surnommé « l’Hercule de la liberté », « l’Orateur du peuple » et « la Torche de Provence », il reste le premier symbole de l’éloquence parlementaire en France. Bien que membre de la noblesse, il se distingue en tant que député du tiers état aux États généraux. Après que la noblesse l’a rejeté. Fort aimé par les révolutionnaires, son corps est transporté au Panthéon à sa mort. Mais la découverte de ses relations secrètes avec la royauté retourne l’opinion. On retire alors sa dépouille du mausolée, dont il était le premier occupant. D’après Wikipédia. Pour en savoir plus, voir ==> ICI
[6] C’est moi qui souligne.
[7] Cette accusation du jeune Louis fera couler beaucoup d’encre. Notamment pour les Royalistes qui vont défendre mordicus la mémoire de cet enfant qui représente la lignée dynastique légitime. Dans sa biographie de Marie-Antoinette, Stefan Zweig fait une démonstration sur la base d’arguments psychologiques très convaincants pour valider ce témoignage d’enfant et en montrer le mensonge probable.
Articles similaires
« Erasme » de Stefan ZWEIG (note de lecture)
16 juin 2025
« Magellan » de Stefan ZWEIG (note de lecture)
13 octobre 2024
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
1 Commentaire
Add comment Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

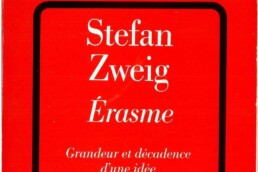
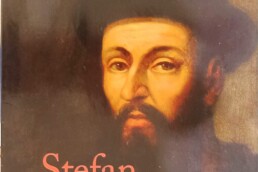
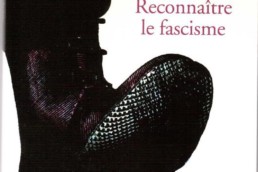
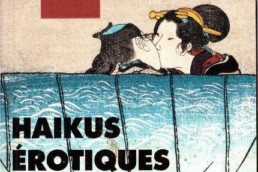
[…] Voir la note de lecture sur l’ouvrage de Stefan Zweig ==> ICI […]