« Anna Karénine » de TOLSTOÏ. Comment rédiger une note de lecture sur un tel monument de la littérature ? Un texte, un auteur, sur lesquels tant d’intellectuels se sont penchés, ont écrit des milliers de textes, commenté, critiqué, encensé cet auteur et ses œuvres ?
Nous tentons cependant ici d’ajouter notre voix à ces innombrables expressions savantes. En posant notre regard sur cette œuvre, en ce qu’elle révèle de profond sur la société russe de la fin du XIX° siècle. Et notamment sur la société aristocratique qui a sombré, ici et ailleurs. Remplacée par des élites économiques et politiques toujours étroitement mêlées, comme à l’époque décrite par le roman. Mais d’une autre façon.
Une période où le monde occidental construit les institutions qui vont façonner le XX° siècle, avec ses progrès et ses régressions démocratiques. Avec ses deux Guerres Mondiales menées entre ces pays d’Occident qui dominaient le monde… Tolstoï est à l’écoute de ces bouleversements intellectuels qui agitent cette fin du XIX° siècle dans son pays. Notamment dans la Russie rurale qui regroupe plus de 90% de la population du pays. Et qui a abolit le servage des millions de serfs quelques années auparavant.
Une manière d’apprendre sur l’histoire du monde, mais aussi sur notre présent. Un présent qui donne toutes les impressions de sombrer dans le gouffre de l’argent, du cynisme, de l’aveuglement, de l’injustice, de la haine de l’autre portés au paroxysme. Et du repli autoritaire, du recul de la démocratie des pays du Nord, face à un Sud en ordre dispersé mais conquérant.
« Anna Karénine », un livre d’amour et d’agriculture ?
LE GRAND ROMAN DE TOLSTOÏ, ANNA KARENINE. D’ENTREE, IL EST QUESTION D’AMOUR ET DE MARIAGE
Amour et mariage, et les relations complexes entre ce sentiment et une institution tutélaire de la société forment les premières pages de ce long roman. Un roman de 1000 pages en un seul volume dans l’édition De Poche dans laquelle nous lisons cet ouvrage.
Le roman commence par planter longuement le décor social qui va servir de terrain à l’héroïne du roman, Anna Karénine. Celle-ci n’apparait dans le récit qu’au bout d’une centaine de pages, en débarquant dans la lecture du texte comme elle le fait à la Gare de Moscou en provenance de St Pétersbourg. A son arrivée en gare, elle assiste à un accident qui coûte la vie à un cheminot, écrasé par un train.
« Anna Karénine » de TOLSTOÏ nous plonge dans la vie de l’aristocratie russe
La principale obsession de ses acteurs tient aux relations, à leur rang. Tout faire pour s’élever dans la hiérarchie qui prévaut au sein de cette fine couche de la population, l’aristocratie. Bien sûr, c’est aussi le terrain de l’expression des sentiments. Surtout ceux qu’on ne peut avouer et qui courent sous les apparences. Les jeux de l’amour se mêlent aux jeux des conventions et des pouvoirs.
Dans le champ des joutes sociales au sein de ces élites, toutes les stratégies sont de mise. Mensonges, dénonciations, médisances, mesquineries. Mais l’important est de le faire avec la distinction qu’impose, précisément, son rang. Rien de pire que d’en manquer ! La moindre défaillance par rapport à cette jauge est immédiatement sanctionnée par de nouvelles médisances et railleries.
L’auteur situe ses scènes en quelques lieux que fréquentent l’aristocratie russe. Pétersbourg, la capitale. Moscou, au centre du pays. Un coin de la Russie rurale où se confrontent la noblesse active avec la paysannerie dans son immensité démographique. Une ville d’eaux en Allemagne où l’on vient se reposer, refaire sa santé et nouer des relations avec des aristocrates d’autres pays d’Europe.
Le bal joue un rôle crucial. Comme une « bourse des valeurs » en temps réel, révélant le niveau des statuts, mais aussi des réputations
Dans ce jeu des apparences, le bal est un moment clé. Pour fixer et modifier à la marge ces hiérarchies. Mais aussi vérifier les penchants, pour les jeunes en âge et situation de se marier. Les désirs, les sentiments amoureux exprimés par les regards… Les invitation ou non à danser… viennent perturber ces rigides scénarios de prestance.
Tolstoï traduit avec grand soin les tenues des hommes et des femmes, où chaque détail compte. Car chacun d’eux prend, dans ce contexte, une signification particulière. Qui envoie un message, qui signe un relation au rang de chacun. Un véritable « marché » des statuts qui s’observent, s’évaluent, se valorisent ou se perdent.
Bien évidemment, le mariage est l’occasion majeure de confronter son statut avec celui de l’autre. L’alliance va-t-elle améliorer son rang ? Les parents sont sensés veiller sur leurs enfants, et particulièrement sur leurs filles, qui pourraient être tentées de s’affranchir de cette dictature du rang sous le prétexte de sentiment amoureux.

La trame du roman est bien l’amour
L’amour va prendre une place éminente dans le déroulé du récit. Il se confrontera aux normes sociales dans une société où ces normes vacillent sous les assauts de la modernité. Avec l’enjeu, classique, de l’importation des valeurs des puissances dominantes d’alors (Angleterre, France, Allemagne) versus la défense des valeurs indigènes, « authentiquement russes ».
Anna sera la femme qui engage toute sa vie pour l’amour d’un homme qui n’est pas son mari. Elle en paiera le prix, celui de sa vie. Tout l’appareillage des normes sociales se met en place pour réduire jusqu’à zéro les espaces où son amour pour cet homme peut se vivre. Elle en sortira vaincue.
Au début du récit, le jeune et brillant officier Vronskï, a brisé le cœur tendre de la jeune Kitty. Celle-ci se met à dépérir. Elle a sacrifié un amour solide, celui de Lévine, à cette folle attirance pour un jeune homme qui prend son suprême plaisir à tourner la tête des jolies femmes, dans son bel uniforme.
Mais l’entrée en scène d’Anna, Anna Karénine, va changer le jeu
Vronskï se laisse irrésistiblement attiré par son allure de femme décidée, solide. Pourra-t-il jouer de sa séduction facile avec elle ? Tolstoï décrit ainsi l’arrivée d’Anna dans une soirée mondaine à Pétersbourg où elle sait qu’elle va trouver Vronskï : (p 180) « Anna marchait très droite, comme toujours, sans changer la direction de son regard. De son pas rapide, ferme et léger, qui distinguait son allure de celle de toutes les autres femmes, elle franchit le court espace qui la séparait de la maitresse de maison, lui serra la main, sourit, et, avec ce même sourire, regarda Vronskï. »
Lors de leurs rencontres sous les feux de la scène de la société pétersbourgeoise, les mots et les regards tiennent chacun un discours différent. Différent ? Non, opposé.
Les paroles et les regards
Avec les mots, nous sommes dans les convenances. Anna Karénine est l’épouse d’un très haut fonctionnaire, péremptoire et ennuyeux mais très respecté. Le mot « amour » ne peut être prononcé entre elle et Vronskï.
Mais les regards, les attitudes, écrivent une autre histoire qui n’est pas moins visible. La cour que mène Vronskï passionne au plus haut point cette haute société de Pétersbourg. Quel sujet croustillant pour animer les discussions mondaines !
La jalousie
Le mari assiste impuissant aux élans entre son épouse et Vronskï, de moins en moins dissimulés. Les salons de Pétersbourg bruissent de cette idylle qui nait à la barbe du mari. Mais la jalousie est un sentiment dégradant, et le brave mari est bien démuni. D’autant qu’Anna oppose « une incompréhension amusée » à ses tentatives d’aborder le sujet.
Le thème de la jalousie va se retrouver en d’autres moments du récit. La vie de Lévine s’empoisonne de sa jalousie quand un jeune bellâtre invité à la campagne tourne autour de son épouse Kitty. Mais c’est surtout Anna qui va être rongée par le doute sur l’amour de son amant, jusqu’à en perdre la raison.
On comprend que la relation entre Vronskï et Anna s’est nouée autour de l’amour
L’auteur évoque l’amour du jeune officier comme sentiment sincère, profond. Les deux amants affrontent de puissantes impressions contradictoires. Ils sont totalement heureux de s’être trouvés et de vivre cet amour mutuel. La sincérité de leur lien les fait sortir du jeu qu’hommes et femmes de la haute société ont l’habitude de pratiquer en contournant les conventions. Inextricablement lié à leur bonheur, la peur, la honte, la culpabilité se sont également installées en eux.
Amour et conventions
Vronskï ne joue pas le jeu social de la séduction et d’un libertinage léger qui ne mettent pas en cause fondamentalement les statuts. Ainsi, sortant de ses obligations sociales, il néglige ses devoirs d’officier de haut rang, comme une mutation de prestige, pour rester près d’Anna à Pétersbourg.
La mère de Vronskï, qui s’était félicitée de la relation de son fils avec une femmes parmi les plus haut placée de la ville, commence à s’inquiéter. L’amour est alors vécu comme un obstacle possible au grand jeu social qui anime ses « élites » russes.
Vronskï et Anna
Anna a rejoint sa maison de campagne, à côté du palais de Peterhof, près du champ de course où vont se dérouler des épreuves auxquelles va participer Vronskï. Celui-ci la rejoint avant la course.
Anna annonce à son amant qu’elle est enceinte. Elle guette sur son visage l’effet de cette nouvelle qui va bouleverser leur vie. Vronskï prend cette annonce avec gravité, Anna est rassurée. Il lui propose de tout quitter. De partir ensemble. Où ? Comment ? « Fuir ! Devenir votre concubine et perdre tout ? » Anna a peur. Elle a un fils d’une dizaine d’années qu’elle ne peut ainsi abandonner.
Ce dialogue arrive alors que le temps de la course approche. Vronskï accorde à cet exercice d’équitation une très haute importance, en tant qu’homme, mais surtout en tant qu’officier qui a son rang à tenir parmi les siens, au sein de l’armée.
La course, la chute
Il rejoint le champ de course, retrouve sa jument Froufrou et l’homme qui s’en occupe, un entraineur anglais. Celui-ci lui donne ses derniers conseils. Surtout, ne pas stimuler le cheval avant l’obstacle ! Le laisser « négocier » le saut, en s’adaptant à sa difficulté, aux formes de l’obstacle à franchir (rivière, haie, barres…). Faire confiance à sa jument.
Toute la cour est là. Dans les tribunes entourant l’Empereur. Une cour qui bruisse des rumeurs tout en observant les épreuves. Anna est présente aux côtés d’une amie, comtesse. Son mari, le Prince, est présent également dans les tribunes. Il serait inconvenant de n’y point paraitre ! De ne point participer à ce grand jeu social ! Comme le sont les bals que la noblesse organise régulièrement, à grands frais.
La dernière course est lancée. C’est la plus difficile. Celle où les obstacles à franchir sont les plus dangereux. Plus de la moitié des chevaux et de leurs cavaliers tombent. Seule une poignée d’entre eux est sur le point de terminer la course, tout près de la ligne d’arrivée. Vronskï est en tête juste avant le dernier fossé plein d’eau de deux archines de large, le dernier saut à effectuer.
Ah ! Il fait un « mouvement maladroit ». Son cheval chute lourdement. Vronskï a juste le temps d’échapper au poids de la jument qui s’écroule, les reins brisés.
Tolstoï évoque clairement la reconnaissance par Vronskï de sa propre responsabilité
Après un bref instant de colère, Vronskï comprend que sa jument est définitivement condamnée. Et ce, pour une « faute honteuse, impardonnable » de sa part. « Ah, qu’ai-je fait » se dit-il. Tout au drame qu’il vient de provoquer, la culpabilité l’étreint : « A son grand regret, il se sentait sain et sauf ». Il quitte l’hippodrome, hagard. « Il se sentait malheureux, pour la première fois de sa vie. Le chagrin qu’il éprouvait était plus vif que tout était de sa faute. » (pages 254-255)
Léon Tolstoï décrit là une conduite exemplaire de réflexivité. Mais, dans ce passage, il ne fait pas le lien avec la nouvelle bouleversante que Vronskï vient d’apprendre, quelques minutes avant la course. Anna attend un enfant de lui !
Comment le lecteur, plus d’un siècle après, peut-il ignorer ce lien ? Comme une évidence à peine dissimulée entre les lignes. Comment ne pas voir la relation entre ce geste de mise en échec, cette « faute honteuse », et la gravité de ce qu’il vient d’apprendre. Qui touche à ce qui compte le plus pour lui, son amour pour Anna.
Dans les tribunes, Anna …
Anna ne peut cacher son immense émotion. La scène de la chute, au loin, est confuse. Des personnes viennent et entourent le cavalier et le cheval à terre. Elle craint le pire pour son amant. Elle est bouleversée. Le Prince, son mari, est resté de glace. Il a observé l’émoi d’Anna.
Dans la voiture qui les reconduit à leur maison, il interroge Anna. Celle-ci se redresse et proclame la vérité, avant de s’effondrer en larmes. Oui, elle aime Vronskï. Et elle est sa maîtresse. Le mari ne bronche pas. Il annonce qu’il prendra les mesures qui s’imposent. Il rentre à Pétersbourg.
Le souci de réputation, les convenances, le mensonge d’un côté. L’amour, la vérité de l’autre. Des deux côtés, la souffrance. En une vision romantique que Tolstoï maitrise avec art.
Cet aveu fait basculer l’histoire. Ce qui pouvait, selon les convenances, être vécu dans l’hypocrite discrétion, ne peut plus l’être. Désormais, les trois acteurs de cette scène vont chercher, chacun, à trouver un équilibre impossible. Et l’issue en sera fatale.
Tolstoï nous fait partager les questionnements de chacun des deux amants
L’amour peut-il subvertir les conventions et dessiner une solution viable pour chacun des protagonistes ?
Le mari, de son côté, pense, un moment au duel. Mais il y renonce : pourquoi risquerait-il la punition d’une blessure ou la mort alors qu’il n’est coupable de rien ? Dans sa main de mari, le pouvoir, l’argent, les règles dominantes. Mais aussi le risque de réputation qu’il place tout en haut de sa vie sociale et personnelle.
Dans celle de Vronskï, son amour, bien sûr. Mais aussi sa carrière, ses amis officiers, sa rente annuelle.
Enfin, Anna. Elle a peu de cartes en main. L’amour qu’elle porte à Vronskï est sa force. C’est aussi sa faiblesse. Comme son fils. Cet enfant représente pour elle son point d’appui inconditionnel. Mais un appui que son mari peut lui arracher.
A l’exact milieu du livre, Tolstoï nous plonge dans la tempête des émotions
Anna, son mari, Vronskï sont pris dans une situation d’une grande violence qui ne comporte, à vrai dire, aucune solution. Anna a accouché d’une petite fille, fruit des amours défendus avec son amant. Son mari s’est résolu à entamer une procédure de divorce qui suppose l’humiliant recours à la preuve par flagrant délit d’adultère. Anna sombre dans le désespoir et son état de santé se dégrade. Rendue vulnérable par son accouchement récent, elle ne voit aucune issue à sa situation que la mort, qu’elle finit par souhaiter.
L’état d’Anna a fait fondre la carapace de son mari. Par un retournement total, il pardonne à son épouse. Et met en scène, sincèrement, son absolution. D’autant que ce pardon lui procure l’immense satisfaction d’avoir fait preuve de générosité. De son côté, Vronskï se sent abandonné. Il retourne son pistolet contre lui… Mais échoue à se donner la mort. Il survit à cette tentative.
Au fond, rien n’est résolu. Une fois l’émotion passée, le mari retrouve toutes ses raisons de haïr son épouse infidèle. L’impossible équilibre entre Anna, son mari et Vronskï est une nouvelle fois, révélé.
Anna va sacrifier son fils qu’elle abandonne à son mari. Vronskï a renoncé à sa promotion comme colonel et démissionne de l’armée.
Le couple, quitte la Russie et voyage en Europe
Nous le retrouvons en Italie avec la petite fille bébé, très peu présente dans le texte, à ce stade. Avec la domesticité qui les accompagne, la nourrice, les rares amis. Vronskï s’ennuie. Il veut revenir en Russie, renouer avec son milieu de l’aristocratie.
Alexis, le mari trahi, sombre dans la religion
Il a pardonné à Anna. Et il l’a fait savoir. Ce qui lui donne une nouvelle identité que celle de mari bafoué, trahi et humilié. C’est devenu un homme magnanime. Cela lui apporte également un grand soulagement. Mais ensuite ? Son désarroi demeure. Il commence à s’intéresser à son fils Serge, à son éducation assurée par un précepteur, à domicile.
Une comtesse proche de la famille jette son dévolu sur lui. Elle prend en main la conduite de la maison, comme une femme doit le faire.
Surtout, elle entraine le Prince dans un mouvement religieux où l’extrême expression de la dévotion prend le dessus. Lui qui était croyant sans excès, se tourne vers la foi, l’étude attentive des textes, l’exaltation des comportements dévots. En fait, ce mouvement s’est emparé de la haute société de Pétersbourg.
Anna et Vronskï sont retournés à Pétersbourg
Ils logent dans l’hôtel le plus luxueux de la ville, avec domestiques et nourrice pour la petite fille. Une enfant dont Tolstoï ne nous a pas encore livré le nom ! Les deux amants ne s’affichent pas ensemble dans le monde. Anna est même vue comme une personne auprès de qui il ne faut pas se montrer. Elle en est profondément blessée.
Elle profite d’un moment pour tromper la vigilance de la comtesse qui « garde » le mari, et retrouve, un court moment, son fils Serge. Celui-ci n’avait jamais cru à la mort de sa mère. Fils et mère s’étreignent en une scène émouvante.
Anna décide, contre l’avis de Vronskï, d’aller au théâtre pour une représentation. Elle sait que le tout Pétersbourg y sera présent. Elle se met dans sa plus belle tenue, et sa beauté illumine la loge qu’elle occupe. Un incident éclate alors. Une femme l’insulte. C’est un scandale. Anna, provoquante et magnifique, est humiliée, mais elle fait front. Tandis que Vronskï reste impuissant à la défendre. Quelque chose lui échappe de la douleur que ressent Anna. D’une façon générale, ce sont les femmes qui sont ulcérées par sa présence.
De fortes tensions se font jour entre les amants. Mais la crise passe. Ils quittent la grande ville pour passer l’été dans la propriété de Vronskï. Dans la région de Kachine, entre Moscou et Pétersbourg.
Le nom de l’enfant
De par la loi, la petite fille porte le nom du mari d’Anna, Karénine, puisque les liens du mariage ne sont pas légalement rompus. C’est pourquoi l’enfant est à peine évoquée jusqu’aux trois quarts du roman. Anna n’aime pas cette enfant.
Vronskï veut qu’Anna demande le divorce à son mari, pour pouvoir donner son nom à cette fillette, se marier avec Anna et envisager d’autres enfants avec elle. Mais celle-ci sait qu’elle ne peut plus avoir d’enfant. C’est ce qu’elle a appris au moment de son accouchement de cette fille qu’au détour d’une page on nomme, par son prénom, Annie.
L’inquiétude d’Anna
Mais Anna a d’autres pensées que de demander le divorce. Comment garder l’amour de Vronskï ? Elle n’est protégée par aucune institution, puisqu’aucun mariage n’a scellé leur union. Leur relation ne tient que par l’amour, ce fil à la fois fort et si fragile !
Vronskï a besoin de libertés, de mouvement. Anna s’inquiète de chacune de ses sorties. Notamment lors des élections locales du Maréchal de la noblesse à Kachine, près de la propriété de Vronskï, où ils vivent. Celui-ci se pique au jeu politique et manifestes ses qualités sociales en jouant un rôle majeur dans l’élection. De quoi lui faire penser à s’impliquer plus avant pour les prochaines joutes politiques.
La souffrance d’Anna
Elle et Vronskï ne parviennent pas à trouver une solution pour sortir du carcan douloureux que leur milieu a jeté sur de leur relation. Le divorce dépend du mari. La petite fille qu’ils ont eu porte le nom de Karénine, le père ne peut la reconnaitre. Peu de personnes de leur milieu se risquent à fréquenter ce couple sulfureux. Surtout Anna. Elle se sent isolée, vouée à l’opprobre. Chacun des amants a perdu dans cette relation impossible, la confiance en l’autre. Anna sombre dans une jalousie maladive.
On sent, dans le récit, qu’Anna court vers l’abîme. Entre disputes et réconciliations, ses rapports avec Vronskï se dégradent. Oscillant entre soumission et révolte, détruisant peu à peu la bienveillance qui les lie. Elle connait des phases de confusion où la haine, la tendresse, la culpabilité, la jalousie, le remord, les pensées suicidaires se bousculent.
Engagée dans une autodestruction, elle s’approche de ces moments de folie où tout vacille en une ronde de pensées destructrices qu’elle ne contrôle plus. Le parcours d’Anna dans les méandres de sa souffrance est d’une grande intensité littéraire.
Jusqu’à l’issue fatale
Anna se jette sous un train. En lointain écho à la scène qui l’avait bouleversée, racontée au tout début du récit.
Loin de là, la Serbie s’est soulevée contre le joug ottoman
Des jeunes russes s’enrôlent comme volontaires en soutien avec aux Serbes. En solidarité avec des Slaves. Vronskï, qui ne se remet pas de la mort d’Anna, s’est engagé dans ce mouvement. Prêt à donner sa vie pour cette cause, pour oublier son malheur.
La fin du roman : les états d’âme de Lévine. La foi au bout du doute ?
En écho aux tourments de Tolstoï lui-même, le récit se termine par les pensées erratiques de Lévine. Bien public contre égoïsme privé, avenir de l’agriculture russe… les sujets d’angoisse ne manquent pas pour Lévine. Mais surtout, pensée rationnelle et ses tromperies contre transcendance…
Dans les dernières lignes de cet ouvrage monumental, à l’occasion de la rencontre avec un paysan, Lévine, homme en perpétuel doute, semble trouver une issue en la foi. Non en l’église et ses rituels. Mais dans la croyance en une force surnaturelle.
NOUS QUITTONS LES SALONS MONDAINS POUR LES PROPRIETES RURALES
Nous y retrouvons Lévine qui est retourné sur ses terres, après l’échec de sa demande en mariage auprès de Kitty. L’homme est plongé dans une infinie tristesse que la nature et son réveil au printemps vont peu à peu atténuer.
Tolstoï nous livre là une ode à la nature. Au printemps qui, délicatement, avec la fonte des neiges, éveille les plantes, fait pousser les bourgeons… De très belles pages montrent l’intérêt de l’auteur pour la terre, pour le travail, pour la considération des hommes, les paysans, qui œuvrent, au service des propriétaires, les « maîtres ». Mais aussi qui opposent une grande inertie face au poids de la domination de classe qu’ils subissent.
La résistance des dominés selon le sociologue James C. Scott
Nous empruntons à Scott ses outils d’analyse pour extraire des pages de Tolstoï les connaissances de la société qu’il décrit.
Du côté des paysans, la désobéissance aux consignes, les retards et les détournement des ordres relèvent parfaitement de ce que James C Scott identifie comme la résistance des dominés . Une résistance qui ne se fait pas frontalement, mais par la ruse, l’énoncé de demi-vérités, l’inertie… Scott le fait en opposant « récits publics » et « récits cachés ».
Récits publics et récits cachés
Les dialogues que Tolstoï rapporte dans son roman traduisent bien cette distinction entre les deux types de « récits ». Les « récits publics » sont ceux qui s’échangent entre dominants (Lévine) et dominés (son régisseur qui dirige, sous ses ordres, les travaux dans la ferme, ses ouvriers agricoles). Tandis que les « récits cachés » sont ceux que chacun d’eux entretien par de vers lui et avec ses semblables.
Ici, les dialogues relèvent de l’échange de « récits publics », tandis que le texte nous met dans la tête de Lévine pour nous révéler son « récit caché ». De leur côté, les paysans invoquent la religion dans leur récit public. C’est « comme Dieu voudra ». Une façon de se protéger d’avance pour la non-réalisation des espoirs productifs de Lévine, et pour les comptes qu’il faudra lui rendre.
Scott l’anthropologue a étudié le phénomène de domination sur trois cas. Celle des « Intouchables » en Inde, des esclaves aux Etats Unis. Et celle de serfs sous la férule des propriétaires terriens dans la Russie tzariste. Voir ==> ICI la note de lecture faite sur un des ouvrages fondamentaux de Scott : La Domination et les arts de la résistance.
La scène de chasse, l’organisation des travaux sur sa vaste propriété (labourages, semailles, fumure…) alors que le printemps libère la nature de sa chappe de glace, la vente d’une forêt à un ami de Moscou, sont autant de tableaux qui nous donnent de précieuses indications sur la vie rurale dans la société russe d’avant la Révolution bolchevique. Et sur l’intérêt de Tolstoï pour l’organisation sociale de son pays.
Léon Tolstoï manifeste une attention particulière pour les débats qui agitent sa société
Nous sommes au moment où, en Europe, se forment les institutions qui vont structurer le monde occidental au XX° siècle. Les élites russes sont de la partie, eux que les voyages d’agrément et les cures font visiter régulièrement les villes d’Allemagne, de France, d’Angleterre… L’idée de République se répand, tout du moins l’idée de l’intérêt général, de la nation… La notion de « peuple » percute les visions aristocratiques de la société. Les syndicats, les partis politiques se forment, le droit du travail s’échafaude. Les droits tout court se font jour…
Nous avons déjà rencontré ces problématiques dans la Russie tzariste avec « Le fou du tzar » de Jaan KROSS dont on trouvera ==> ICI une note de lecture.
Surtout, nous sommes dans la période qui a suivi l’abolition du servage en Russie , en 1861
Cette réforme rompt avec plusieurs siècles de relations entre maîtres et serfs, qui structuraient l’organisation sociale dans l’immensité rurale de la Russie. L’abolition entraine de profonds bouleversements dans toute la société russe. Tolstoï nous montre que leur mise en mots est très imparfaite. La confusion règne dans les nouvelles relations qui peuvent s’établir entre anciens serfs et maîtres.
Ces bouleversements portent ainsi sur une dimension fondamentale de l’organisation d’une société : le mode de « mise au travail » de la population. La période de servage multiséculaire ne s’efface pas d’un trait.
Tolstoï met dans les échanges entre ses personnages ces grands débats qui accompagnent les bouleversements au sein de la société. Débat sur la place des paysans dans le paysage social. Ceux-ci sont portés aux nues par les uns, profondément critiqués par d’autres. Pour leur inertie, leur refus du progrès, leur défiance vis-à-vis des « maîtres ». La place même du travail est questionnée. Comment mettre au travail productif les 23 millions de paysans libérés du servage ?
Le fauchage des foins et la tentative de fraude
Lévine décide de participer, aux côtés des ouvriers recrutés pour l’occasion, au fauchage des vastes champs de sa propriété. Toute une journée dans l’odeur de l’herbe coupée, dans la chaleur de l’été. Dans l’effort physique et le rude maniement de la faux. Sa description de l’opération montre la maitrise du sujet par Tolstoï, comme pour les courses hippiques, la chasse, les bals…
Lévine est enthousiaste à l’idée de se soumettre à cette épreuve physique. Mais aussi d’écouter les propos, les rires des ouvriers avec qui il effectue ce dur travail qui nécessite une adresse et une expérience certaines. Il est fasciné par la vigueur des hommes et des femmes qui s’activent autour de lui. La gaité, les chants de ce monde paysan l’enchantent. Il écoute avec grand intérêt les propos des vieux paysans qui manifestent leur savoir sur les choses de la nature et de la culture. Une vision idéalisée d’un monde qui semble simple et joyeux, empli d’harmonie et de sagesse.
Mais dans le même temps, lors d’un échange avec un ami, propriétaire terrien comme lui, il se plaint de l’inertie de ces ouvriers, incapables d’accueillir le progrès des machines, toujours à l’affut d’en faire le moins possible. Voire de tenter de le gruger.
Une scène décrit la tromperie dont il a été l’objet à propos du partage du foin fauché en rémunération du travail accompli. Il comprend que chacune des meules ne fait pas les 50 charrettes convenues, mais seulement 32. Il refait effectuer le travail. Les jeunes ouvriers ne prennent pas ombrage de cette rectification. Là encore, nous sommes dans la résistance des dominés, qu’ils considèrent comme tout à fait naturelle.
Les grands questionnements de l’avènement de la modernité
Mais l’ouvrage nous entraine dans d’autres interrogations, le plus souvent en référence à ce qui se passe en Europe de l’Ouest : Allemagne, France, Angleterre. Ainsi de l’éducation. Et notamment l’éducation des femmes. Sont-elles capables de prendre des responsabilités ? Ne risquent-t-elles de s’émanciper par trop ? Autre sujet : comment trouver l’équilibre entre intérêt général et intérêt individuel ? Où situer les nobles ruraux qui travaillent à l’organisation de leur domaine agricole, comme le fait Lévine ? Il est solidaire de la noblesse dans son ensemble, et il en défend le principe. Mais il sent que les aristocrates des villes qui vivent de rente, de bal et de course à cheval, ne suivent pas les mêmes buts que lui…
La modernité
En termes qui peuvent nous sembler aujourd’hui maladroits, confus, Tolstoï évoque, au travers des échanges entre ses personnages, les grands bouleversements qui feront la modernité du XX° siècle. Avec les espoirs qu’elle suscite. Avec les craintes qu’elle soulève.
Lévine sombre dans la mélancolie, mais l’amour est le plus fort
Obsédé par la marche de son domaine, ruminant son échec amoureux, il ne pense qu’aux solutions pour mettre à l’ouvrage les paysans d’une façon productive. Il s’est même mis en tête d’écrire un livre sur le sujet. Mais il ne peut résoudre son problème sur le terrain, tandis que Kitty continue de dominer ses pensées.
Au cours d’un séjour à Pétersbourg, il revoit Kitty et l’amour redevient possible entre eux. Le cheminement douloureux qu’il suit pour retrouver le chemin de cette relation, par-delà son humiliation passée, est décrit avec grande sensibilité par l’auteur.
Ils se retrouvent. Lévine surmonte ses doutes : l’aime-t-elle ? Va-t-elle accepter son athéisme ? Leur entourage les aide à surmonter ces obstacles. La cérémonie à l’église est un grand moment du roman. Là encore, apparences et convenances religieuses et sociales se mêlent aux sentiments exaltés des deux mariés.
La mort de Nicolas, frère ainé de Lévine
Ce frère est l’enfant raté de la famille. En révolte, engagé depuis toujours dans des entreprises d’autodestruction, il a mené une vie de misère et de récrimination contre le monde entier.
Tolstoï nous montre ici la force des liens familiaux. Lévine aime ce frère déchu. Il répond à son appel au secours, alors qu’il est au bord de la mort. Il se précipite chez lui non sans avoir tenté, sans succès, de dissuader Kitty de l’accompagner. Celle-ci n’est pas rebutée par la misère de la chambre où Nicolas agonise, à coté d’une femme que la bonne société réprouve.
Pendant que Lévine se perd dans ses pensées sur la mort, rongé par l’angoisse, Kitty prend en main le nettoyage de la chambre, le lavage des habits de Nicolas. Prenant soin du moribond, elle installe quelque chose d’humain, de réaliste, de concret, aux antipodes du comportement de son mari. Lévine hésite entre l’admiration de l’œuvre de Kitty qui a tout fait pour atténuer la souffrance de son frère, et sa profonde humiliation de lui montrer la déchéance de cet homme décharné, dans une situation sordide.
Nicolas expire. Tolstoï nous décrit l’évolution des sentiments de Lévine devant la lente agonie de Nicolas dans l’extrême souffrance. Jusqu’au moment où sa mort est désirée par tout l’entourage.
Les chevaux
Comme il l’a de la nature, Tolstoï a une connaissance profonde du monde de l’équitation. Il partage cette connaissance et cet intérêt avec toute la noblesse russe. Avec tous les officiers qui se doivent de monter. Et de monter avec brio.
La cavalerie joue un rôle majeur dans les batailles, et le souvenir du grand conflit avec Napoléon est encore vif au sein de la société russe. Les cavaliers y avaient tenu une place éminente, notamment pour harceler l’armée napoléonienne qui reculait en désastre après avoir triomphé dans sa phase offensive vers Moscou.
La domesticité
Tous les personnages du roman, princes et princesses, sont en permanence accompagnés par des domestiques, cochets, cuisiniers, jardiniers, gouvernantes (pour les enfants), valets…. Ils agissent, en coulisse, avec discrétion, docilité et un respect affiché. Là encore, on ne voit d’eux que leur « récit public ». Mais que pensent-ils ? Comment vivent-ils réellement ? Quels sont leurs « récits cachés » ? Très peu d’éléments filtrent de ces récits dans le roman.
La confiture
Faut-il mettre de l’eau avec les fruits dans la grande marmite où les fraises, les framboises, cuisent pour faire une confiture ? Deux écoles d’affrontent. Et la vieille bonne n’apprécie pas ces nouveautés qui viennent des villes avec ces femmes qui passent quelques semaines à la campagne pendant les longues journées d’été. Et surtout, mettre une papier imbibé de rhum sous le couvercle pour éviter que la confiture ne se gâte !
La dette
Cette société aristocratique s’ébroue sans compter, batifole en grand appareil dans les salons de Pétersbourg, de Moscou… Dans les maisons des propriétés rurales. Sans compter ? Bien plus ! En manifestant à chaque occasion la magnificence de son train de vie. Signe de son rang, de sa puissance.
Un des fils de la trame du récit est formé par cette dimension. Cette classe vit au-dessus de ses moyens. Mais le recours à l’endettement est naturel. Il fait partie des solutions admises comme allant de soi. On est encore à quelques années de la déroute de l’aristocratie qu’Anton Tchekhov immortalisera dans « La cerisaie » (*) . Une pièce de théâtre qui met en scène la décadence d’une famille aristocratique obligée de vendre des parties de sa propriété pour continuer à mener grand train. Cette partie, c’est « la cerisaie » du domaine, qu’un paysan arriviste et avisé va racheter.
« ANNA KARENINE » DE TOLSTOÏ PARTICIPE DE LA FASCINATION POUR LA FIN DES EMPIRES
Nous sommes là dans les dernières années de vie de l’Empire russe. A la fin du XIX° siècle. Les idées nouvelles de refus de la soumission des larges masses paysannes transparaissent dans le roman, alors que le fin du servage marque encore les esprits. La Révolution bolchevique va arriver quelques années après. Tolstoï ne vivra pas ce bouleversement. Il va mourir en 1910.
Mais cette fin de siècle a été également celle des empires chinois et ottoman. Autant d’écroulements d’édifices centenaires.
La littérature a accompagné ces effondrements, surtout par des récits décrivant ces élites aveugles sur la fragilité de leur domination. Aveugles sur les grandes évolutions du monde et de leur propre société. Nous pensons ici au roman fleuve « Un moment à Pékin » de LIN Yutang (voir la note de lecture de ce roman ==> ICI), mais aussi à l’ouvrage d’ASADA Jirô : « Le roman de la Cité Interdite » dont on trouvera ==> ICI une note de lecture.
Côté Ottoman, nous pensons au roman d’Ahmet ALTAN : « Comme une blessure de sabre ». Voir ==> ICI la note de lecture qui en a été faite.
Aveuglement des élites
Amours, frivolités et luttes pour le pouvoir forment les trames de ces récits où l’inconscience la situation réelle caractérise le comportement des couches dirigeantes. En une « danse sur un volcan » que nous retrouvons dans les trois cas cités, chacun dans son contexte.
Des œuvres littéraires qui nous renseignent en profondeur sur les mouvements qui agitent les sociétés. Voir sur ce point « Beaux seins, Belles fesses et l’académisme » ==> ICI.
UNE ECRITURE POUR PEINDRE LES EMOTIONS
L’écriture de ce roman est fluide, avec son découpage en paragraphes de 2 à 3 pages qui viennent rythmer le récit, en aérer la lecture.
De très nombreuses pages du roman sont consacrées à l’évocation des sentiments dans l’extrême expressivité des personnages. Les émotions connaissent des manifestations puissantes, plus ou moins dissimulées sous les bonnes manières et les convenances que leur impose leur rang.
Tolstoï insiste sur l’écart entre ce que ses personnages pensent et ce qu’ils disent, souvent en totale contradiction. Encore une fois, les conventions brident fortement les propos des personnages dans l’aristocratie. Ainsi, même entre eux, les puissants peuvent être pris dans des « récits cachés », non pas pour des motifs de domination, mais pour respecter des codes sociaux d’appartenance à la classe des puissants.
L’écriture de Tolstoï nous décrit les circonvolutions des émotions, les hésitations, les pensées contradictoires qui agitent un même personnage. Avec, fait singulier, une attention soutenue aux traces qu’ils laissent sur les visages, sur les mouvements du corps des héros du roman. Ce corps reste corseté par les gestes convenus, comme les mille façons de se saluer, avec autant de significations sur le type de relation qu’on doit ou qu’on veut exprimer à l’autre. Mais, au total, les gestes, la « communication non verbale » restent moins susceptible d’être contrôlé, d’être mis sous l’emprise des conventions. Un corps qui peut trahir les pensées, les émotions profondes. Les lèvres qui tremblent, une rougeur subite qui monte au visage, des larmes qui mouillent les yeux, la voix qui tremble… L’auteur ponctue ses récits des échanges entre ses héros, surtout quand il est question d’amour, de ces évocation.
Les regards
La scène où Anna, Vronskï et un ami vont visiter l’atelier d’un peintre russe exilé dans une ville italienne est remarquable par le jeu des regards que Tolstoï décrit avec une immense précision et sensibilité. Il y a donc trois visiteurs, le peintre, et les tableaux, objets explicites de ces regards. Objets des commentaires dits, et de « commentaires » exprimés par les attitudes non dites, les regards échangés…
Le sentiment amoureux est traduit avec une finesse toute particulière
Ainsi, des échanges entre Lévine, Kitty, Vronskï et bien sûr Anna Karénine. La description est aussi profonde pour les héros que pour les héroïnes. Le passage d’un état émotif à un autre, l’effet d’une rencontre, la remontée d’un souvenir, les pensées et arrières pensées supposées chez l’interlocuteur sont traduits avec une immense précision.
La montée des émois, ses reflux. Les doutes, les espoirs… Les émotions les plus bouleversantes comme les plus tenues, leur traces les plus subtiles, les plus éphémères… sont capturés par Tolstoï avec précision, sensibilité. Surtout quand il s’agit des femmes. L’inconscient n’est pas sexué !
Léon Tolstoï, un auteur foncièrement positif
L’auteur accompagne tous ses portraits, toutes ses descriptions des situations, d’une touche bienveillante et optimiste. L’auteur ne dépeint jamais ses paysages, même les plus sombres, sans ajouter une touche de lumière, un rayon de soleil dans la brume. Aux moments les plus dramatiques, un sourire, un mot d’humour, un geste amical, un regard bienveillant viennent colorer les dialogues.
Tolstoï, l’écrivain de la nuance
Les personnages principaux sont tous présentés dans leurs contradictions, jamais dépeints tout en sombre ou tout en lumière. Ils le sont dans leur complexité, leurs contradictions, les nuances qui se forment dans leurs impressions profondes, dans l’expression de leurs sentiments. Dans l’écart entre ce qu’ils imaginent (Lévine et sa vision idéalisée de la vie en couple) et ce qu’ils vont vivre (Lévine, encore, se rendant compte que Kitty imprime sa marque sur la vie quotidienne). Les contrastes, ambiguïtés, les questionnements sont présentés longuement, sans détours. Tant dans les sentiments amoureux que dans les réflexions sur l’organisation de la production dans les domaines agricoles.
Ces contrastes rompent avec la gravité du propos. Introduisant un élément contradictoire dans le cours du récit. Tout n’est jamais entièrement sombre pour l’auteur.
Cela donne à la lecture une touche légère qui ponctue l’interminable déroulement du récit tout au long de ses 1000 pages de texte.
AU TOTAL, TOLSTOÏ NOUS LIVRE UNE SERIE DE TABLEAUX DE LA VIE ARISTOCRATIQUE DANS LA RUSSIE DE LA FIN DU XIX° SIECLE
Dans les salons de Moscou et de Pétersbourg. Au cours de bals que le grand monde organiser régulièrement. Lors des repas prestigieux où les mets, le décorum, le service, la vaisselle, les tenues sont l’objet d’infinies attentions. Au théâtre où il faut se montrer, où l’on jauge la beauté, la magnificence des tenues… Aux courses hippiques où toute la cour se retrouve autour de l’Empereur. A la campagne à la rencontre avec les paysans, les propriétaires terriens, les contremaitres. A la chasse à la bécasse dans les marais… Dans les stations thermales d’Europe où l’on rencontre des étrangers de son rang…
A l’église lors du mariage de Kitty et Lévine, dans le lourd rituel orthodoxe. Dans un hôtel minable au chevet de Nicolas mourant, frère ainé de Lévine. Chez un peintre russe exilé en Italie, totalement infatué par sa propre œuvre. Avec Serge le fils d’Anna, aux prises avec son précepteur pendant ses leçons de grammaire. Lui qui, du haut de ses 9 ans, ne croit pas à la mort de sa mère et espère la retrouver lors de ses promenades dans les jardins publics de Pétersbourg.
Avec Vronskï accompagnant un prince étranger à la recherche des « plaisirs russes ». Au cœur des interrogations de Lévine confronté à son athéisme devant un prêtre qui lui fait passer une sorte d’examen prénuptial. Dans les combinaisons d’une assemblée locale pour l’élection du « Maréchal de la noblesse », au cœur des manœuvres politiciennes aussi subtiles qu’incompréhensibles pour Lévine… et pour nous même. Avec les volontaires qui partent soutenir les Serbes dans leur lutte de libération contre les Turcs. On y retrouve Vronskï qui s’engage dans ce combat pour oublier l’atroce disparition d’Anna.
Chacune de ces scènes est autant de prétextes pour éclairer les facettes de la vie aristocratique. Formant un riche tableau de la société russe, vue du haut.
& & &
Léon Tolstoï, nom francisé de Lev Nikolaïevitch Tolstoï (en russe : Лев Никола́евич Толсто́йa), né en 1828 à Iasnaïa Poliana, et mort en 1910 à Astapovo, est un écrivain russe. Il est célèbre pour ses romans et ses nouvelles qui dépeignent la vie du peuple russe à l’époque des tsars. Mais aussi pour ses essais, dans lesquels il condamne les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Il est excommunié par l’Église orthodoxe russe. Après sa mort, ses manuscrits sont détruits par la censure tsariste. Il entend mettre en lumière dans ses œuvres les grands enjeux de la civilisation.
Guerre et Paix, qu’il met cinq ans à écrire, est considéré comme son œuvre majeure. Dans ce roman historique et réaliste, paru en 1869, il dépeint surtout les classes supérieures, du fait de sa propre origine, au moment de l’invasion de la Russie par les troupes de Napoléon en 1812. C’est une vaste fresque des complexités de la vie sociale et de la psychologie humaine. Il s’en dégage une réflexion profonde et originale sur l’histoire et sur la violence (d’après Wikipédia). Pour en savoir plus, voir ==> ICI
(*) La Cerisaie (en russe : Вишнёвый сад) est une pièce de théâtre d’Anton Tchekhov créée en 1904.
Cette histoire se retrouve presque à l’identique dans « Le Guépard » (en italien : Il Gattopardo) unique roman de l’écrivain et aristocrate italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa, paru en 1958 à titre posthume et récompensé par le prix Strega l’année suivante. Tomasi di Lampedusa y trace la vie de don Fabrizio Corbera, prince de Salina, un aristocrate sicilien, au milieu des tourments révolutionnaires italiens du Risorgimento. Mais c’est surtout une histoire de la Sicile et de la transition entre un ordre ancien et un nouvel ordre.
Articles similaires
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
« Clameur » de Hocine TANDJAOUI (note de lecture)
27 janvier 2022
« Notre histoire » de Rao PINGRU (note de lecture)
22 juillet 2017
3 Commentaires
Add comment Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

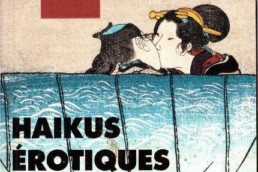

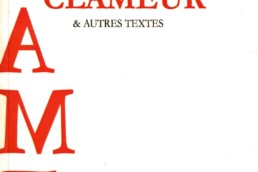

[…] Sur la Russie du XIX° siècle, on lira avec intérêt la note de lecture sur Anna Karénine de Léon Tolstoï ==> ICI […]
Cher Jacques, si ce n’est. pas déja fait, je te conseille vivement la lecture de Au loin la liberté, Essai sur Tchekov, de Jacques Rancière. Eblouissant.
Merci Hocine, je vais commander cet ouvrage. Cela fait longtemps que j’ai envie de lire Jacques Rancière. Merci encore, ami.