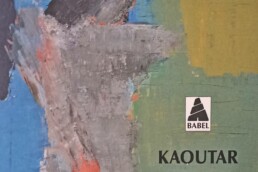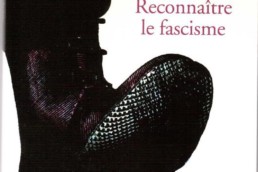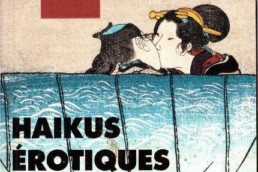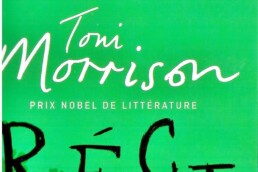« L’Ampleur du saccage « de Kaoutar HARCHI. L’auteure nous entraine dans l’horrible histoire d’hommes ayant accompli l’acte le plus monstrueux que l’on puisse imaginer. Des hommes liés par un drame qui mêle les pires atteintes à la vie, à la dignité, au respect. Meurtre, viol, inceste composent la trame de ce récit accablant de vérité sur la face sombre de l’être humain. S’ajoutent le mensonge, la dissimulation, l’amitié, la frustration. Une immense frustration de ces jeunes hommes à la dérive, privés du contact féminin par le poids des interdits qui écrase les corps, les cœurs, les esprits. Jusqu’à la folie. Jusqu’au saccage.
Il y a Si Larbi
Lui qui a assisté et participé au viol collectif de Nour, sa propre mère, dans un quartier à la marge d’Alger. Il a fait cet acte horrible avec le visage « protégé » par un bandeau noir pour cacher son identité. Il était à peine adolescent.
Avec Riddah, il a enlevé et élevé son tout petit frère Arezki, fruit de ce viol, après l’avoir pris à sa mère. C’était un tout jeune nourrisson. Si Larbi scellera sa parole sans révéler à Arezki son origine fatale. Fruit du saccage collectif. Mais en le prenant en charge, le protégeant… Si Larbi étouffera ses remords en devenant chauffeur routier. En s’épuisant au volant de son lourd camion à errer sur les routes et chemins d’Europe.
Il y a Riddah
Lui aussi a fait partie, aux côtés des hommes déchainés, de cette cohorte folle. Imbibé d’alcool, de frustration porté à incandescence, il a violé la mère de son ami. Nour, cette femme ensanglantée, étendue sur le sol de sa maison.
Quittant l’Algérie, il a débarqué avec Si Larbi à Marseille. Avec le petit Arezki dans les bras. Sur les bras. Ils se laissent happer par le travail sur un chantier. Aux cotés de ces immigrés embauchés avec le labeur et la misère de la « reconstruction de la France ». Et toujours, l’enfant Arezki avec eux. A nourrir, à s’occuper de lui.
Un jour, Riddah s’en est allé. Il ne voulait pas finir comme les autres à s’abrutir de travail. Dans le goudron à étendre sur les routes. Il est parti tenter sa chance ailleurs, autrement. Et cet autrement, c’est par les études qu’il va chercher à l’atteindre. Pour quitter sa classe, son monde. Il va s’acharner. Riddah va réussir. Il va franchir un pas dans cette société avec son instruction acquise chèrement. Au bout de ce dur chemin, il deviendra directeur de prison.
Il y a Ryeb
Il n’en croit pas ses yeux ! Le directeur de la prison où il travaille marche au loin avec un détenu qu’il a aidé à s’enfuir. Comment est-ce possible ?
Le détenu en fuite, c’est Arezki. Il a été jugé et incarcéré pour avoir tué une jeune femme. Une jeune femme arabe violée et tué en marge d’une fête de mariage, quelque part dans une banlieue d’une ville de France.

Il retrouve Arezki en fuite et décide de l’aider. Le fugitif est seul, sans amis, vulnérable. Il va rapidement avoir la police à ses trousses. Ryeb l’accueille chez lui, l’aide. Arezki ne se laisse pas aider facilement. Désormais, Ryeb devient également un fugitif, en devenant complice d’un criminel évadé.
Arezki et Ryeb décident de retourner en Algérie pour échapper à la police. La mère de Ryeb, Monique, lui a fait promettre qu’une fois morte, il porterait ses cendres à Alger pour les disperser dans le puits où son mari s’est jeté il y a longtemps de cela. Son mari, Khaled le Kabyle, dont elle est toujours amoureuse. Lui, Ryeb, ne se souvient pas de ce père qui s’est enfuit en retournant en Algérie pour s’y suicider.
Enfin, il y a Arezki
Lui, c’est l’enfant conçu lors de la monstrueuse agression de sa mère. Depuis ses premiers jours, il a été porté et protégé par Si Larbi. Un homme qui partait si loin avec son camion, mais qui revenait toujours vers lui. Sans jamais rien lui dire de son origine.
Arezki une première fois meurtrier. D’abord de la jeune femme arabe raptée et violée un soir de fête en France. Dans la rage de son désir immense et impossible. Pour ce meurtre, il est condamné et arrive en prison. D’où le directeur va le faire évader. Ce directeur, Riddah, n’est autre qu’un des protagoniste du viol collectif, avec son ami Si Larbi.
Un pacte scellé par le silence et l’impossible oubli
(p 91) « Nous avons rêvé de connaitre la sensation de prendre une femme contre nous et de la serrer jusqu’à ce que l’air ne puisse plus circuler entre nos deux corps. Et, pour cela, nous avions bravé tous les interdits, niant l’amour, ne recherchant que son expression la plus bestiale. Au terme de cette quête folle, nous avions perdu notre âme, note innocence et pénétré, pour toujours, dans le monde de la honte. »
Cet acte de démence emmure ces quatre hommes dans le drame. En premier, Si Larbi qui a violé sa propre mère. Riddah qui l’a accompagné dans son geste d’alors et qui organise l’évasion d’Arezki. Ryed, le gardien, qui a caché Arezki quand il s’est enfuit de prison et qui doit s’acquitter de sa promesse à sa mère, à la recherche des traces de ce père suicidé. Et Arezki, meurtrier en cavale, fruit du viol collectif.
Tous ont d’impérieuses raisons de fuir. Et c’est à Alger, d’où ils sont venus, qu’ils vont s’échouer. Brisés par le remord. Par le poids de la faute. Le regret, la honte. L’impossible réparation. Le silence qui cache le secret des origines, en cette monstrueuse « scène primitive » qui n’a pas été qu’un fantasme. Une scène qui s’est inscrite dans le sang de cette femme flétrie à jamais.
Le meurtre ultime
A la fin du récit, trente ans après, ces hommes retrouvent, aux marges de la ville, la femme violentée. Elle reconnait Si Larbi, et découvre Arezki son fils enlevé. Mais reste de marbre devant l’explosion de détresse de ces hommes qui se jettent à ses pieds. Pour un impossible pardon.
L’auteure s’introduit, et nous introduit, dans la conscience de Nour, la mère meurtrie. (p 108) « Qui ai-je face à moi ? Mes bourreaux ou mes fils ? Dois-je leur arracher les yeux ou les prendre dans mes bras ? Ce soir-là, on avait toqué à ma porte. Une nuée noire d’hommes… Des visages menaçants… La mort me souriait… Pute ! Mon corps n’était qu’un territoire qu’il fallait envahir. J’ai supplié. Ils m’ont frappée. Je fixais leurs yeux pour qu’ils sachent que, à jamais, je garderai leur visage en mémoire. Deux ombres saoules se tenaient à l’écart… (…) Vous m’avez fait entrer dans le cercle de la haine. »
Arezki comprend. Il était peut-être lui-même le fruit de ces « ombres saoules ». !l se retourne vers Si Larbi. Lui plante son couteau dans son cou. Si Larbi s’est laissé tuer. Avec le sentiment de soulagement. Lui qui avait élevé l’enfant. Qui l’avait aimé, protégé. Mais qui lui avait caché l’acte monstrueux de sa conception. Dans la violence, le sang de Nour, cette femme martyrisée, qui continue à hanter ces hommes, trente ans après.
L’écriture puissante et pleine de finesse de Kaoutar Harchi
« L’ampleur du saccage », ce noir récit, est porté par un style puissant et à la fois d’une grande délicatesse. Où le sens des formules nous entraine avec sobriété dans l’expression de l’horreur. Une sobriété qui nous touche bien plus que ne pourrait le faire l’emphase.
Et des phrases insolites, inattendues. Incompréhensibles. Qui témoignent du trouble total à pénétrer les cœurs et les âmes de ces mâles perdus dans l’impossible rapport à la femme.
& & &
Kaoutar Harchi, née en 1987 à Strasbourg, est une écrivaine et sociologue de la littérature française. Elle est élevée à Strasbourg par des parents d’origine marocaine. Son père est agent d’entretien et sa mère travaille dans une maison de retraite. Elle y suit des études secondaires dans un établissement privé, avant de s’inscrire à l’université.
À 22 ans, elle publie son premier roman, Zone cinglée, chez Sarbacane. Elle publie ensuite deux autres romans, L’Ampleur du saccage en 2011 et À l’origine notre père obscur en 2014, chez Actes Sud.
Sociologue de formation, elle soutient en 2014 sa thèse dirigée par Bruno Péquignot, à l’université Sorbonne-Nouvelle. Celle-ci s’intitule La formation de la croyance en la valeur littéraire en situation coloniale et postcoloniale. Elle y étudie les trajectoires individuelles en France, entre 1950 et 2009, de quatre écrivains algériens francophones, Kamel Daoud, Rachid Boudjedra, Boualem Sansal, Kateb Yacine et une écrivaine, Assia Djebar.
Sa thèse devient un essai, publié chez Fayard en 2016 sous le titre Je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne. Il est traduit en anglais sous le nom I Have Only One Language, and It Is Not Mine: A Struggle for Recognition chez Liverpool University Press, en 2023.
Elle est chercheuse associée au Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux), laboratoire dépendant de l’université Paris-Descartes, l’université Sorbonne-Nouvelle et le CNRS. Elle enseigne la sociologie à Sciences Po Paris et Reims. En 2019, elle est professeure invitée à l’université de New York et en 2021, elle enseigne à l’université Paris 13 de Villetaneuse.
En 2021, elle publie Comme nous existons chez Actes Sud : l’autrice raconte son enfance et son adolescence. Celles, ordinaires, d’une jeune femme issue de l’immigration et des classes populaires. Kaoutar Harchi explique avoir rompu, définitivement, avec le travail de fiction et la forme romanesque (d’après Wikipédia). Pour en savoir plus, voir ==> ICI
Voir la note de lecture du récit autobiographique de Kaoutar Harchi « Comme nous existons » ==> ICI
Articles similaires
« Haïkus érotiques » (note de lecture)
17 février 2019
« Récitatif » de Toni MORRISSON (note de lecture)
28 février 2024